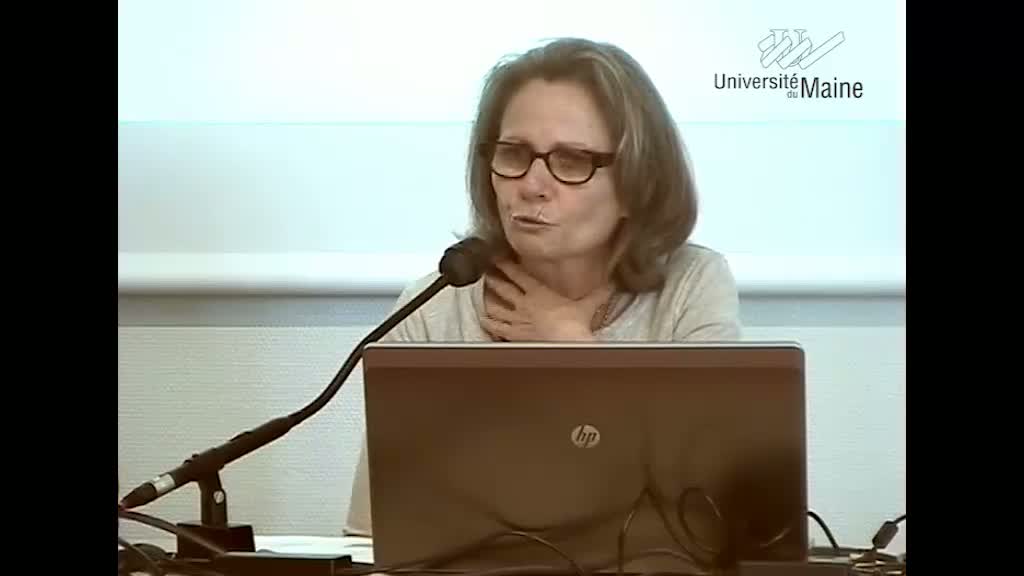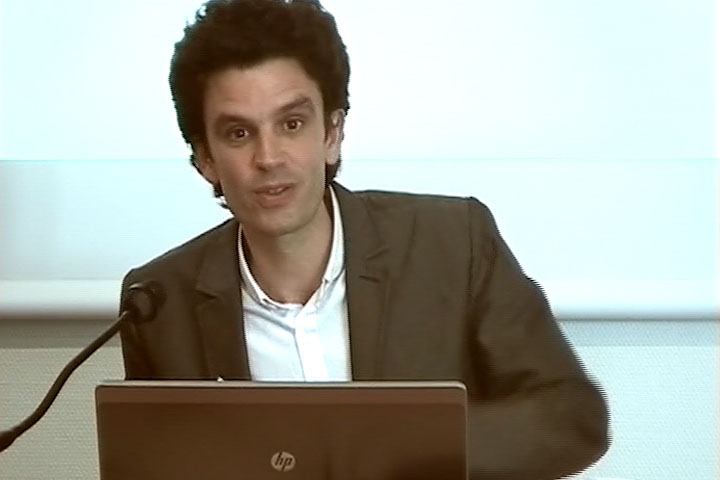Notice
Le docteur Boissarie et les 'guéris' de Lourdes face aux experts de la Salpêtrière et de l'école de Nancy (1890–1914)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Lorsque Lourdes devient un sanctuaire thérapeutique (années 1870) après avoir fait son entrée dans l'actualité comme lieu d'apparitions (1858), le monde médical évoque volontiers la manipulation. Il faut attendre le début des années 1890, avec le développement du Bureau médical de Lourdes et le best seller de Zola (Lourdes) pour que les guérisons de Lourdes deviennent sujet à discussion médicale (Charcot, 1892, « La foi qui guérit »).
Le docteur Boissarie, président du bureau médical des constatations à Lourdes, ainsi que les « guéris » de Lourdes entament une bataille inégale pour tenter de prouver le caractère réel, extraordinaire et surnaturel de leurs guérisons. L'administration de la preuve se fait bien souvent par l'exhibition du miraculé et de son témoignage. Mais les arguments des tenants de l'hystérie comme ceux des tenants de l'hypnose ou de la suggestion sont pris en compte et influent à la fois sur le choix des spécimens de guérison, sur les récits de ces guérisons et sur l'administration de la preuve. De l'autre côté, comme l'a montré Hervé Guillemain, ce qui se passe à Lourdes peut influencer la définition du périmètre de l'hystérie, tandis que la contestation du miracle semble favoriser la vulgarisation des travaux du Dr Bernheim et de ses disciples, renforçant ou infléchissant les hypothèses naturalistes de Zola.
Pour étudier la manière dont la quête de légitimité de la « clinique de Lourdes » fournit matière à penser aux tenants de la psychothérapie, ainsi que la manière dont la psychothérapie à ses débuts influence la mise en scène et la médiatisation des miraculés de Lourdes, on travaille sur deux types de publications : celles du Dr Boissarie et de quelques autres défenseurs de la possibilité du miracle dont certains font des thèses de médecine sur le sujet (Bon, 1908, Van der Elst, 1912) tandis d'autres se chargent de la vulgarisation (Bertrin) ; sur la production médicale extérieure à Lourdes qui s'intéresse à ces guérisons pour résoudre de manière rationnelle les énigmes posées à la science et, parfois, les utiliser dans la construction de théories médicales. On veut également s'intéresser à la manière dont les uns et les autres se citent et s'interprètent, construisant un espace de controverse qui contribue à installer Lourdes comme la capitale du miracle.
Le Dr Boissarie et les « guéris » de Lourdes veulent contraindre le monde médical à prendre en compte la thérapeutique surnaturelle ; on peut y lire une revendication, pour les femmes, de leur pleine santé mentale (refus de l'hystérie), de la réalité de la maladie et de la guérison, ainsi qu'une revendication de l'autonomie et de la lucidité des sujets (contre l'hypnose et la suggestion, qui fascinent et inquiètent).
On peut considérer, également, que l'œuvre du Dr Boissarie vise à installer de force la possibilité d'une thérapeutique religieuse à un moment où la médecine devient capable de fournir des explications naturelles jugées satisfaisantes par beaucoup.
Cette étude, centrée sur la production écrite, scientifique ou pseudo-scientifique sur Lourdes, permet également de réfléchir à la construction d'un savoir social de la guérison qui utilise le lexique scientifique tout en simplifiant voire en dénaturant les thérapeutiques auxquelles il fait référence.
Intervention / Responsable scientifique
Dans la même collection
-
Le rôle de la littérature dans la constitution d'une science ornithologique (1760–1850)
WeberAnne-GaëlleL'objet de cette intervention est d'observer la part prise par des écrivains ou par des notions poétiques et littéraires dans l'émergence de l'ornithologie comme science étudiée par Paul Lawrence
-
La Société d'horticulture de Saint Germain–en–Laye sous le Second empire
VivierNadineA partir du Bulletin de la Société d'horticulture de Saint Germain-en-Laye, il semble possible de conduire une réflexion sur le rôle d'une société qui est en réseau avec de nombreuses autres sociétés
-
Figurer le territoire au niveau local : tension entre cartes et plans et affirmation d'une professi…
VerdierNicolasLa question de l'histoire de la production de cartes au XVIIIe siècle est complexe est relève dans les faits de toute une série de processus. Le premier est celui de la diffusion matérielle de ces
-
L'Aufklärung, les périodiques savants et les discours sur la pédanterie
GantetClaireS'il existe une caractéristique commune aux divers courants et mouvements rassemblés dans le terme d'Aufklärung, ce fut le souci de propager le savoir et par là extirper préjugés et superstitions.
-
Une astronomie théorique « par en bas » ? Les auteurs de théories cosmogoniques français entre 1860…
FagesVolnyDurant le second XIXe siècle, la question de l'origine des astres, la cosmogonie, est l'objet d'un nombre important de publications scientifiques, sous des formes et dans des lieux variés. Alors qu
-
La mélancolie dans les consultations adressées au Dr Tissot (1728–1797)
Louis-CourvoisierMichelineMon exposé portera sur l'expression de la mélancolie dans 46 consultations épistolaires envoyées au dr Tissot entre 1760 et 1797. Les historiens ont déjà montré qu'à une époque où il n'était pas
-
-
La protection des oiseaux (1880–1930). Les relations complexes entre scientifiques, amateurs et cit…
LugliaRémiChansigaudValérieL'ornithologie est, comme d'autres disciplines naturalistes, une science qui mobilise un grand nombre de praticiens dont la plupart œuvre bénévolement, souvent sans autre formation qu'un apprentissage
-
Savoirs du corps, savoirs du nombre. Le contrôle de naissances et les savoirs de la population
PaltrinieriLucaL'émergence soudaine de la catégorie de « population » au milieu du XVIIIe siècle en France ne correspond pas à une modification profonde des savoirs proto-démographiques : l'arithmétique politique
-
Anne Berman (1889–1979), une « simple secrétaire » du mouvement psychanalytique français
AmourouxRémyLes historiens de la psychanalyse française ne se sont pas réellement intéressés à la personne d'Anne Berman. Certes, elle fut la secrétaire personnelle de la célèbre et controversée Marie Bonaparte[1
-
L'apport des archéologues amateurs du XIXe siècle à l'histoire des origines du christianisme en gau…
WachéBrigitteOn sait la place prise par l'archéologie dans le cadre des sociétés savantes en France au XIXe siècle. Elle fut souvent le fait d'archéologues amateurs qui n'inspirèrent pas que condescendance ou