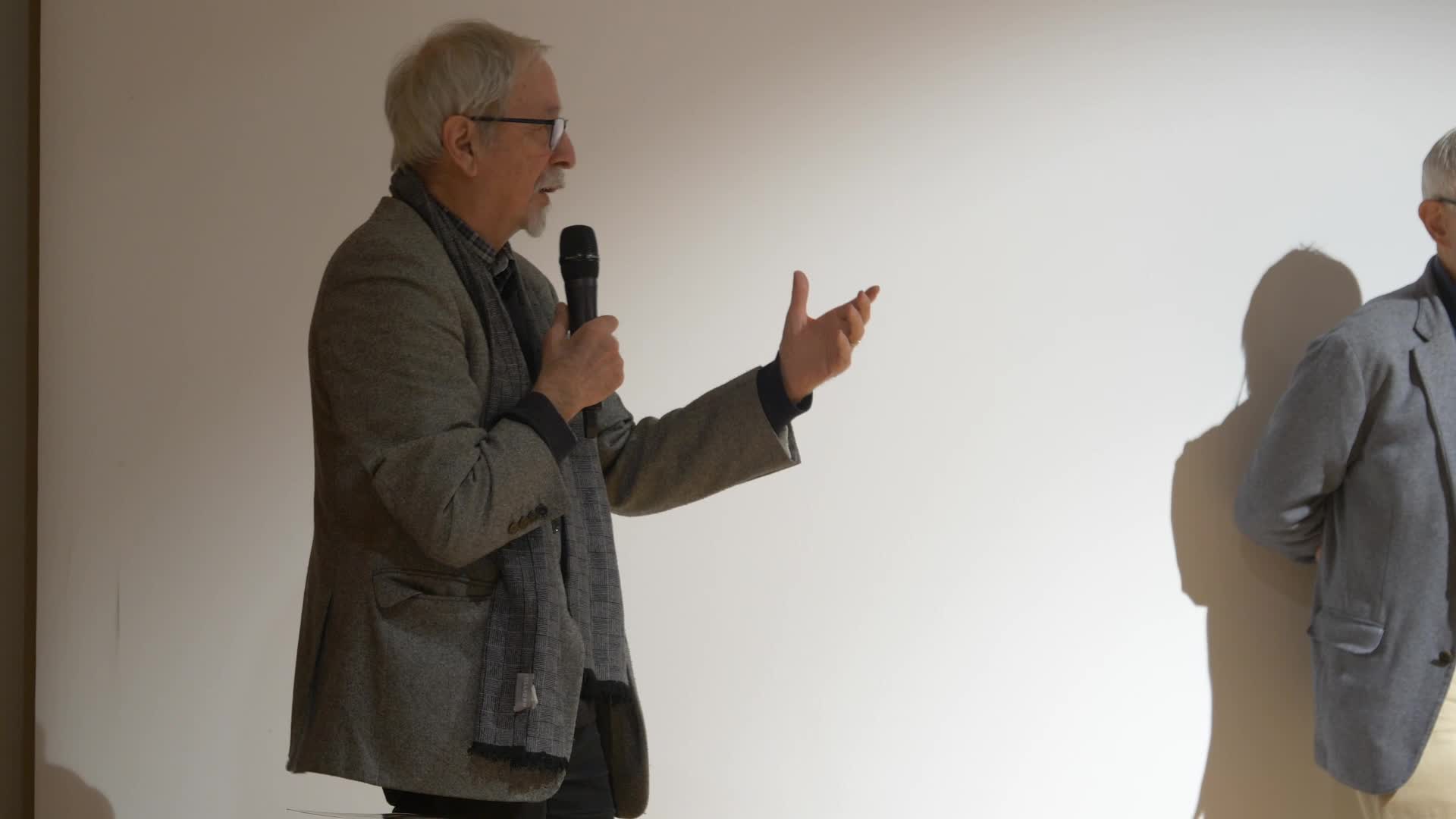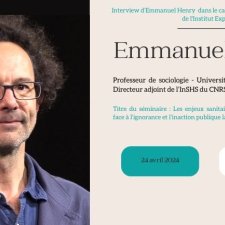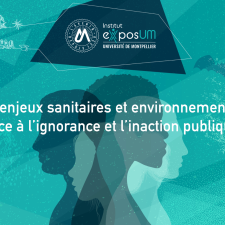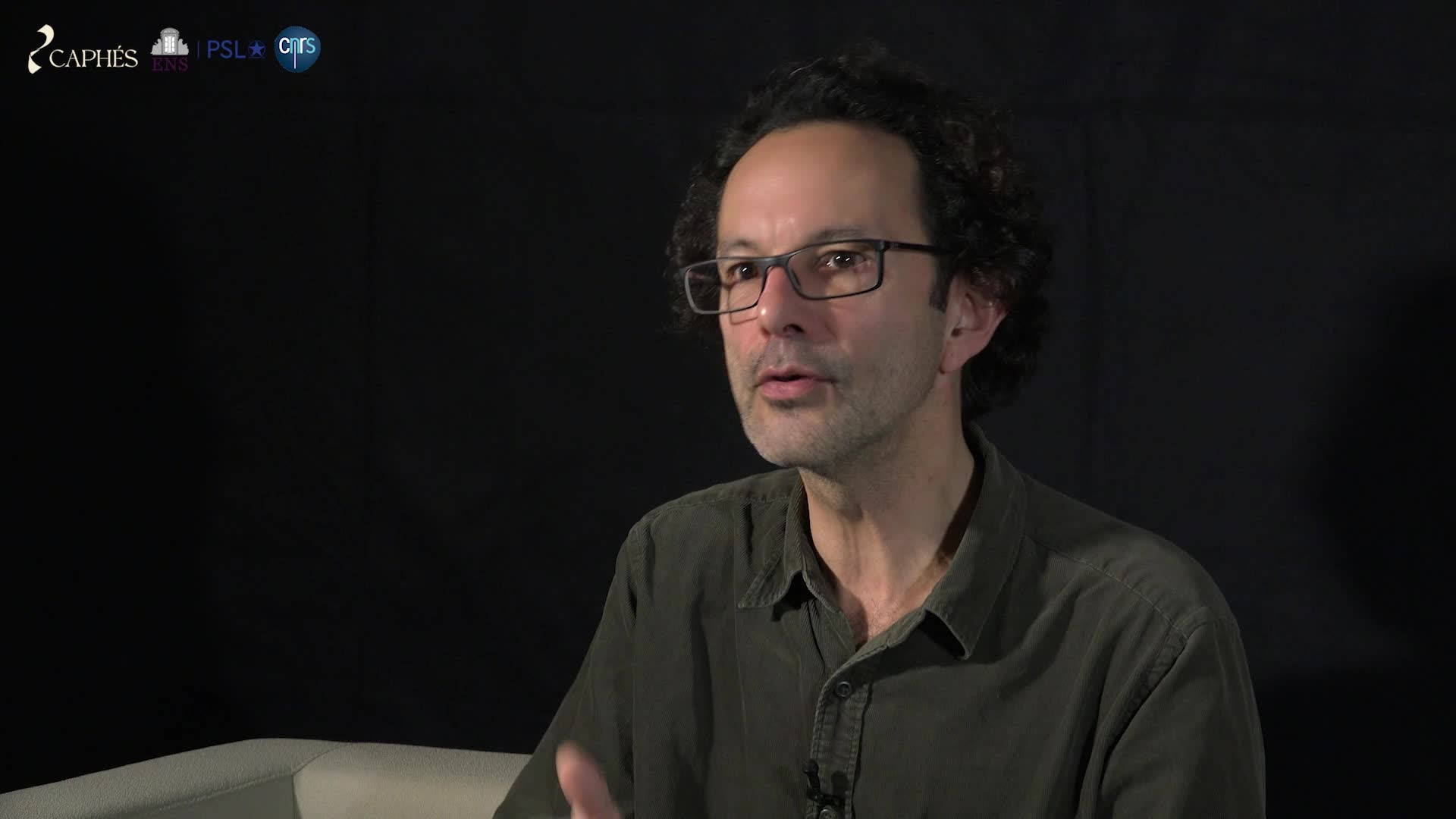Notice
Science et territoires de l'ignorance
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- Dossier
Descriptif
Un courant récent d’histoire des sciences, qui s’est parfois donné le nom d’« Agnotologie », a contribué à instruire un regard nouveau sur l’ignorance. Ces travaux ont montré qu’elle pouvait être autre chose que la pure absence de savoir (sens absolu) ou que le simple fait d’être privé de connaissances possédées par d’autres (sens relatif). Si la connaissance peut être produite, dans des processus de recherche bien réglée, elle peut également être détruite, qu’il s’agisse de la faire disparaître du champ public, comme le montrent les travaux sur le secret, ou encore d’en saper l’autorité : un savoir rendu douteux ne peut plus aussi facilement servir de prémisses à nos enquêtes, à nos décisions éthiques et politiques; il bloque l’accroissement de nos connaissances. D’autres auteurs, dans une lecture plus positive, ont souligné le rôle de l’ignorance non seulement comme aiguillon de la science, mais aussi, paradoxalement, comme produit de la science: les grandes découvertes ouvrent de nouveaux champs inconnus, posent de nouvelles questions, révèlent des ignorances intéressantes pour la communauté. Deux pôles semblent alors se dégager : d’un côté, une ignorance produite, stratégique, de l’autre, une ignorance comme frontière ou moteur de la science.
Une tâche préliminaire est bien entendu de déterminer s’il y a quelque unité entre ces deux notions, mais elle ne devrait pas masquer une autre question plus fondamentale: les situations ordinaires de recherche, tout comme celles du débat public autour des sciences, ne relèvent en général pas de ce caractère binaire. Entre l’ignorance entretenue à dessein et les « fronts de la science » se dessine tout un paysage complexe: il y a sans doute une ignorance produite par les programmes de recherche, qui conduisent à privilégier certaines recherches au détriment d’autres, une autre induite par la perspective de l’expertise, qui peut conduire à mettre entre parenthèses des éléments que l’expert jugerait pertinents en tant que chercheur mais qui sortent de la commande d’expertise, par les instruments mobilisés dans ce cadre, une ignorance corrélative de la complexité des phénomènes en jeu, dans le cadre par exemple de l’exposition à des toxiques… La présente conférence ne se limitera pas aux cas de création stratégique d’ignorance, qui ont été abondamment illustrés, mais tentera une typologie de ces formes diverses. Quels sont les variétés et les modes de l’ignorance, et pourquoi est-il essentiel d’en tenir compte dans les débats environnementaux et sanitaires ?
Par ailleurs, quand on pense se trouver face à des cas d’ignorance produite, se pose la question de savoir si elle l’est de manière intentionnelle ou non. Il y a des cas où l’on peut trancher nettement, comme cela apparaît à l’examen des 80 millions de pages saisies aux cigarettiers par la justice fédérale américaine, ou de certaines des polémiques autour du climat. Mais les conditions concrètes de la recherche nous exposent à de nombreuses situations où cette distinction n’est pas aussi aisée et qui relèvent de ce que nous proposons d’appeler une « zone grise »: conflits d’intérêt, débats sur les sources de financement de la recherche, concurrence entre acteurs au sein d’instances réglementaires, phénomènes de surenchère (« hype ») dans la communication autour de découvertes scientifiques, manquements à l’intégrité scientifique, crise de la réplication des expérimentations, silence sur les résultats négatifs. Quand et comment peut-on sortir de cette « zone grise » pour qualifier plus nettement les phénomènes en jeu? Si nos enquêtes comme nos actions peuvent réussir ou échouer, échouer de manière épisodique ou persistante, sous l’action d’un tiers ou non, dans quels cas est-il raisonnable de relier ces échecs à des intentions ?
Thème
Documentation
Ressources
Sciences en Questions : http://www6.inra.fr/sciences-en-questions/
INRA - Bordeaux : http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/contents/event/?Home=2449?SearchText=&SearchSpaceL1=233&SearchSpaceL2=2449
Sur le même thème
-
Faire atelier (société, éducation, formation). Entre représentations et pratiques professionnelles …
MouginotOlivierAtelier(s). Ce mot sert depuis longtemps à désigner un mode d’organisation du travail humain, en premier lieu du travail manuel, qu’il soit artistique, artisanal, manufacturier ou industriel.
-
Glozel-Session 3 : Table ronde conclusive
Defrance-JublotFannyShermanDaniel J.NégriVincentSchlangerNathanPailletAntoineKarbovnikDamienDanosFélixTable ronde conclusive de la session n°3 - Glozel au révélateur de l’histoire sociale : sociologie, trajectoires historiques et imaginaires collectifs dans les années 1920 - du colloque Glozel dans l
-
Respiration profonde inspir expir sous Covid-19
TriffauxJean-PierreExpérience théâtrale en confinement
-
Le drame du coronavirus | Essai d'interprétation artaudienne
ChariérasPaulEssai d'interprétation artaudienne de la communication du professeur Jean-Pierre Triffaux (dit Rabanel) par Paul Chariéras, comédien et metteur en scène
-
Le drame du coronavirus
TriffauxJean-PierreRabanel [Jean-Pierre Triffaux], « Le drame du coronavirus », article-appel et documents audiovisuels publiés en ligne, site Université Côte d'Azur-CTELA et site Sceneweb.fr, le 30 mars 2020.
-
Entretien avec Juliette Ferry-Danini
Ferry-DaniniJulietteCet entretien avec Juliette Ferry-Danini, spécialiste de philosophie des sciences et de philosophie de la médecine, a été mené le 22 mai 2024 à distance, à l'occasion de la parution de son ouvrage
-
Interview de présentation de la conférence sur les enjeux sanitaires et ignorances
HenryEmmanuelPrésentation de la conférence d'Emmanuel Henry
-
Les enjeux sanitaires et environnementaux face à l’ignorance et l’inaction publique
HenryEmmanuelAxe du séminaire : « La notion d’Environnement » et « Interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »
-
Entretien avec Emmanuel Henry (IRISSO - Université Paris-Dauphine - PSL)
HenryEmmanuelEntretien avec Emmanuel Henry, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales IRISSO UMR 7170-1427 (CNRS - Univ.
-
andy clark, predictive processing and the materially entangled mind
ClarkAndyTalk by Andy Clark (Philosophie and Informatique, Sussex), as part of the workshop "Memory, Place, and Material Culture", organized by John SUTTON, 2022-2023 research fellow at the Paris IAS,
-
#CocoPySHS 2022/2023 - Séance 5 - La traduction de R vers Python : enjeux pratiques et épistémiques
Gruson-DanielCélyaLemercierClaireSchultzEmilienPrésentation de Célya Gruson-Daniel (Inno3), Claire Lemercier (Sciences Po) et Emilien Schultz (Medialab).
-