Notice
Créole magnifique : enquête sur une disparition
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Créole magnifique : enquête sur une disparition / Noémie Auzas. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) de l'Université Toulouse Jean-Jaurès-campus Mirail, 8-10 octobre 2014.
Thématique 6 : Esthétiques narratives et récits des Amériques.
La question des rapports entre le français etle créole irrigue l’œuvre de Patrick Chamoiseau depuis ses débuts en littérature.En effet, cette double identité linguistique est au cœur de son premier roman Chronique des sept misères : elleen constitue le marqueur principal. L’insertion audacieuse du créole dans lanarration en français est sans aucun doute à l’origine du succès de l’œuvre etde sa visibilité éditoriale. Par ailleurs, Patrick Chamoiseau, qui s’estprêté au jeu du commentaire et du théoricien de sa pratique d’écriture, en estbien conscient lui-même. Ainsi, Eloge dela Créolité tout comme Écrire en paysdominé reviennent sur l’expérience de l’écrivain tiraillé entre seslangues. Une expérience qui met au jour plusieurs étapes : soumission à lalangue française, à la fois voisine et étrangère, puis prise de conscience del’enfermement dans une langue-carcan, ce « français liturgique » quijette ses « filets». Après avoir entendu la petite musique du créole, ilen fait la matière même de son œuvre. Puis, à la suite d’Edouard Glissant,l’écrivain plaide pour le rejet de la logique identitaire des langues au profitd’une vision des langues et des poétiques en Relation. De Chroniquedes sept misères à Neuf consciencesdu Malfini, l’œuvre de Patrick Chamoiseau est imprégnée de cette expérienceévolutive. Une expérience mouvante à l’image insaisissable de la Relationglissantienne.
Nombreux sont ceux à s'être penchés surles rapports entre les langues de Chamoiseau et à avoir cherché les clefs decette organisation narrative si particulière. Cependant, une fois encore, àl’image de la langue créole, Patrick Chamoiseau nous a joué un nouveautour-détour, une nouvelle « ruse de mangouste ». Après avoir placé aucentre de sa pratique créatrice la problématique des langues et des langages,voilà qu’il déclare sans ambages : « Aujourd’hui, pour moi, lesquestions de langage sont, bien sûr, réglées.[…] On ne comprend pas que toutcela est réglé pour moi. Là, c’est libre maintenant ». L’évidence doits’imposer : Patrick Chamoiseau n’est pas un auteur monolithique. Ilchange, son écriture évolue. Et, effectivement, entre Chronique des sept misères et Neufconsciences du malfini, comment ne pas lire-entendre le cheminparcouru ? Mesurer le chemin parcouru depuis la« guerre des langues », l’opposition stérilisante du français et ducréole, jusqu’à la naissance d’une poétique des langues et des imaginaires, tel est l’enjeu de cette contribution.
Noémie Auzas suit pas à pas le cheminement de Patrick Chamoiseau etobserve comment la question des langues française et créole -si sensible, si visible à ses débuts– s’esttransformée pour devenir « moins spectaculaire ». Elle cherche àmontrer qu’il ne s’agit pas là d’une disparition de cette question, mais, bienau contraire, d’un approfondissement. Passant de l’exposition linguistique àl’exploration poétique, l’écriture de Patrick Chamoiseau invite à unelecture sans cesse renouvelée de son œuvre et de son imaginaire des langues.
[Illustration adaptée de "Mystery River", photographie de Mattias Ripp, 2014, publiée sur Flickr].
Thème
Documentation
Bibliographie sélective
AUZAS, Noémie (2009). Chamoiseau ou les voies de Babel. De l’imaginaire des langues, Paris, Éditions Imago, 304 p.
AUZAS, Noémie (2009). Tu, c'est l'enfance : ruses et détours de l'expression du moi dans « Une enfance créole » de Patrick Chamoiseau, in Cécile Lignereux, Julien Piat (dirs), Une langue à soi : propositions, Presses Universitaires de Bordeaux, 321-340.
AUZAS, Noémie (2007). L’imaginaire des langues dans l’œuvre romanesque de Patrick Chamoiseau, thèse de doctorat en Littérature et civilisation françaises, Université Stendhal-Grenoble 3.
AUZAS, Noémie (2004). La créativité verbale dans l’œuvre romanesque de Patrick Chamoiseau : langues et langages, Chronique des sept misères, Solibo Magnifique, Texaco, mémoire de DEA, Université Stendhal-Grenoble 3.
> Voir aussi la bibliographie générale, à télécharger dans l'onglet "Documents" de la vidéo d'introduction au colloque.
Dans la même collection
-
Patrick Chamoiseau et la mer des récits : introduction
GARNIER Emmanuelle
LACROIX Daniel
SOUBIAS Pierre
Patrick Chamoiseau et la mer des récits : introduction / Daniel Lacroix, Emmanuelle Garnier, Pierre Soubias
-
Une poétique de l'inscriptible, Patrick Chamoiseau et le tombeau littéraire contemporain / Oana Pan…
PANAïTE Oana
Une poétique de l'inscriptible, Patrick Chamoiseau et le tombeau littéraire contemporain / Oana Panaïté. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le
-
Écrire en pays dominé. Patrick Chamoiseau et la Pologne : lecture postcoloniale / Tomasz Swoboda
SWOBODA Tomasz
Écrire en pays dominé. Patrick Chamoiseau et la Pologne : lecture postcoloniale / Tomasz Swoboda. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire
-
Chamoiseau et après ? / Jean-Louis Cornille
CORNILLE Jean-Louis
Chamoiseau et après ? / Jean-Louis Cornille. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) de l'Université
-
Le roman comme atelier : la scène de l'écriture dans les romans de Chamoiseau / Lise Gauvin
GAUVIN Lise
Le roman comme atelier : la scène de l'écriture dans les romans de Chamoiseau / Lise Gauvin. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres
-
Nouveaux avatars de l'écrivain / Lydie Moudileno
MOUDILENO Lydie
Nouveaux avatars de l'écrivain / Lydie Moudileno. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) de l
-
L'autorité dans les romans de Patrick Chamoiseau / Joscelin Bollut
BOLLUT Joscelin
L'autorité dans les romans de Patrick Chamoiseau / Joscelin Bollut. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA
-
Entres fables de La Fontaine et contes de zombis, une tracée de survie pour un usage didactique de …
FOURTANIER Marie-José
Entres fables de La Fontaine et contes de zombis, une "tracée de survie" pour un usage didactique de la "sentimenthèque" / Marie-José Fourtanier
-
L'Empreinte à Chamoiseau / Lorna Milne
MILNE Lorna
L'Empreinte à Chamoiseau / Lorna Milne. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) de l'Université
-
Patrick Chamoiseau : écrire avec Édouard Glissant / Romuald Fonkoua
FONKOUA Romuald
Patrick Chamoiseau : écrire avec Édouard Glissant / Romuald Fonkoua. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international organisé par le laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA
-
Jouvence, dormance et paysage : la Sentimenthèque comme genèse scripturale / Aurélie Dinh Van [text…
DINH VAN Aurélie
Jouvence, dormance et paysage : la Sentimenthèque comme genèse scripturale / Aurélie Dinh Van [texte lu par Catherine Mazauric]. In "Patrick Chamoiseau et la mer des récits", colloque international


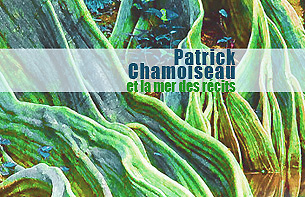
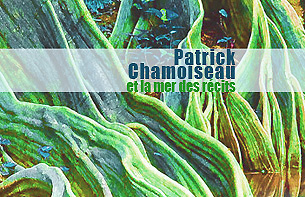
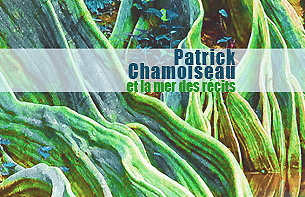
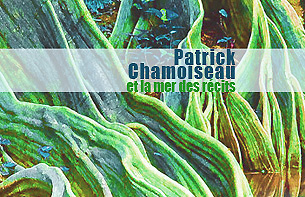
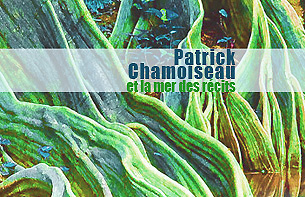
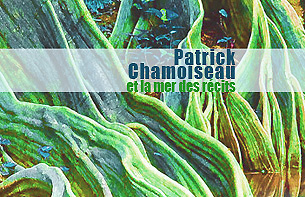
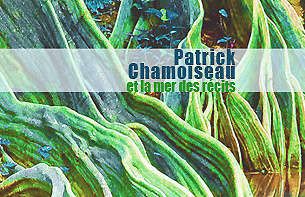
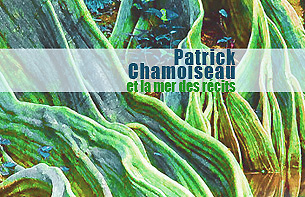

![Jouvence, dormance et paysage : la Sentimenthèque comme genèse scripturale / Aurélie Dinh Van [texte lu par Catherine Mazauric]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/utm/jouvence.dormance.et.paysage.la.sentimenth.que.comme.gen.se.scripturale.aur.lie.dinh.van.texte.lu.par.catherine.mazauric._17095/vignette.chamoiseau.mer.des.recits.005.jpg)