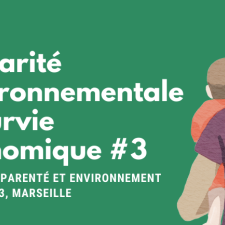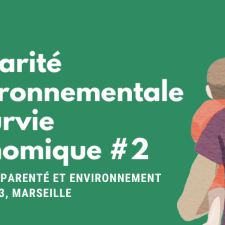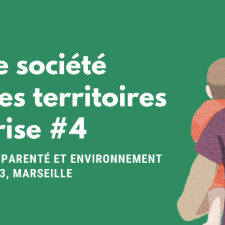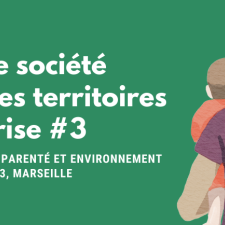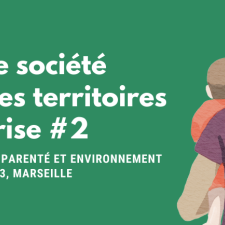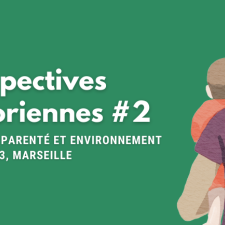Notice
Devenir agriculteur biologique, à distance de sa famille
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Madlyne Samak, Institut national universitaire Champollion
L’agriculture biologique a connu un essor récent dans l’agriculture française : en 2021, elle était pratiquée dans 13% des exploitations françaises, contre 2,6% en 2008. Mais elle reste toutefois une pratique minoritaire : au sein des familles d’agriculteurs, travailler en « bio » est loin d’aller de soi, et suppose dans bien des cas une rupture cognitive avant de se matérialiser dans une transformation des pratiques.
Dans cette communication, il s’agira de s’interroger sur les conditions qui rendent possible cette rupture, en mettant l’accent sur la dimension familiale de celles-ci. La sociologie des professions a montré que dans les groupes professionnels d’indépendants, les ruptures et différenciations professionnelles sont souvent le fait de personnes extérieures au « milieu » (Garcia-Parpet, 2000 ; Leblanc, 2008). Selon ces travaux, des appartenances sociales exogènes feraient le lit de nouvelles manières de faire et de pratiquer le métier parce qu’elles donneraient accès à d’autres ressources culturelles et sociales.
Mes recherches complètent cette perspective en interrogeant la relation entre conversion à l’agriculture biologique et absence ou relâchement de la transmission familiale des pratiques et représentations professionnelles dans les exploitations agricoles. En effet, les travaux qui se sont intéressés aux conditions de la reproduction des exploitations agricoles ont mis en évidence le rôle central joué par la famille dans l’apprentissage du métier d’agriculteur (Bessière, 2010 ; Delbos et Jorion, 1984).
Or les agriculteurs biologiques rencontrés se caractérisent au contraire par une certaine distance à ces formes de transmission familiale. D’une part, les néo-agriculteurs n’ont pas été socialisés au métier de maraîcher dans leur enfance. Et on peut penser que cette absence de transmission a servi leur capacité à rompre avec les pratiques agricoles conventionnelles. D’autre part, les fils et filles d’agriculteurs « repreneurs » d’exploitation ont fait l’expérience d’une mise à distance de la transmission familiale, en allant étudier et/ou travailler dans un tout autre secteur d’activité que l’agriculture avant de revenir s’installer comme maraîcher. Au moment de devenir agriculteur, ils se sont aussi ménagé les conditions d’une rupture avec les pratiques parentales, en changeant l’orientation culturale de l’exploitation, ou en différant le moment de leur installation pour ne plus avoir à composer avec les normes et injonctions parentales. L’enquête menée par entretiens (n=40) auprès de 22 exploitations maraîchères du département des Alpes-Maritimes, montre ainsi le caractère déterminant que joue la distance sociale à la
famille, dans les parcours d’adhésion à l’agriculture biologique.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Dans la même collection
-
Reconfiguration de la famille face à la crise environnementale où comment refuser la parentalité au…
Infécondité volontaire, modes de vie écologiques et autres manières de « faire famille » face à la crise environnementale. Une intervention de Mélanie Bania (GRESCO Limoges).
-
Désirer – ou non – un enfant comme forme d’égoïsme : un enjeu particulier dans le cadre des bouleve…
VialleManonCe que le désir et le non-désir d’enfant disent des normes et représentations de la famille et de la reproduction dans les sociétés européennes, dans le cadre particulier des enjeux environnementaux.
-
« Les petits sauvageons d’ici » : enfance et modes de vie ruraux alternatifs
AutardJeanAlors que les communautés néorurales post-1968 souhaitaient rompre avec la « famille bourgeoise », le mode de vie des alternatifs ruraux actuels s’organise largement autour d’unités familiales ou de
-
Des crises environnementales aux effets sur les maisonnées : stratégies de survie économique auprès…
GoudetJean-MarcA propos des stratégies familiales mises en oeuvre pour surmonter les effets des transformations environnementales au Bangladesh.
-
Familles monoparentales face à la précarité énergétique
CheveignéSuzanne deLa situation des familles monoparentales face à la précarité énergétique en France à partir d'une enquête de terrain menée auprès d’acteurs associatifs, associée à une analyse des données disponibles.
-
Faire familles dans des domiciles aux pieds d’argiles : continuités et changements face à l’adaptat…
NemozSophieUne enquête sur les logements fissurés par le retrait-gonflement terrains argileux en France interroge l'adaptation des familles aux changements climatiques.
-
Famille, genre et changements environnementaux au Burkina Faso
AttanéAnneQuand la régénération du couvert végétal influence les échanges intra-familiaux.
-
Rural families facing environmental degradation in Central Asia’s cotton oases: Soviet legacies and…
TrevisaniTommasoThe importance of past agricultural practices, kinship and family at a time of growing social disparities and environmental vulnerability in Central Asia’s irrigated cotton oases.
-
Les familles rurales de Jendouba face au Code forestier : un Léviathan
BouhdibaSofianeLes conséquences du Code forestier tunisien de 2017 sur la vie des familles forestières de Jendouba : un accès difficile aux ressources naturelles entraînant un exode rural et un désintéressement aux
-
La mangrove et la liberté : faire famille à Bahia (Nord-Est du Brésil)
CabralJoão de PinaPropriété de l’État brésilien, les vastes mangroves de Bahia sont occupées par les populations à bas revenus. Ces dernières années, on assiste à un appauvrissement systémique de ces populations et à
-
Famille et travail dans les missions jésuites du Paraguay (XVIIe-XVIIIe siècles) et dans la communa…
OrantinMickaëlTrois siècles séparent les missions jésuites du Paraguay des communautés indigènes guaranis qui occupent aujourd’hui le même espace. Longtemps pensées comme une utopie concrète, les missions ont
-
Développement économique, famille et environnement dans l’Occident latin au Moyen Age (IXe-XIIIe)
FellerLaurentLa transformation de l'environnement dans l'Occident médiéval, rendue possible par la mobilité de la population et l'évolution de la famille paysanne.