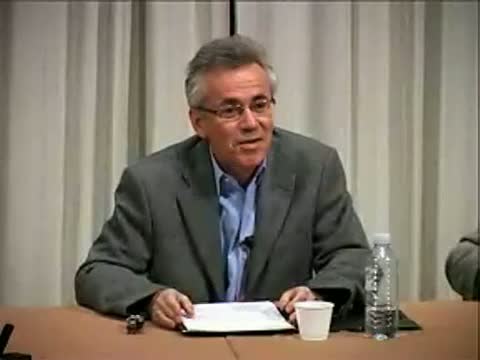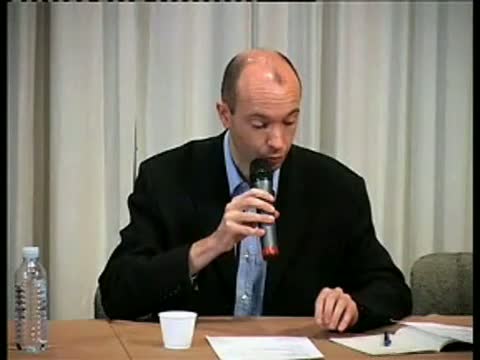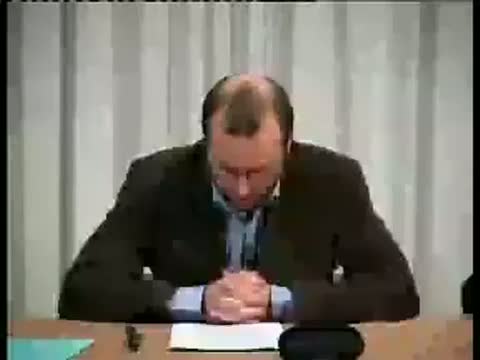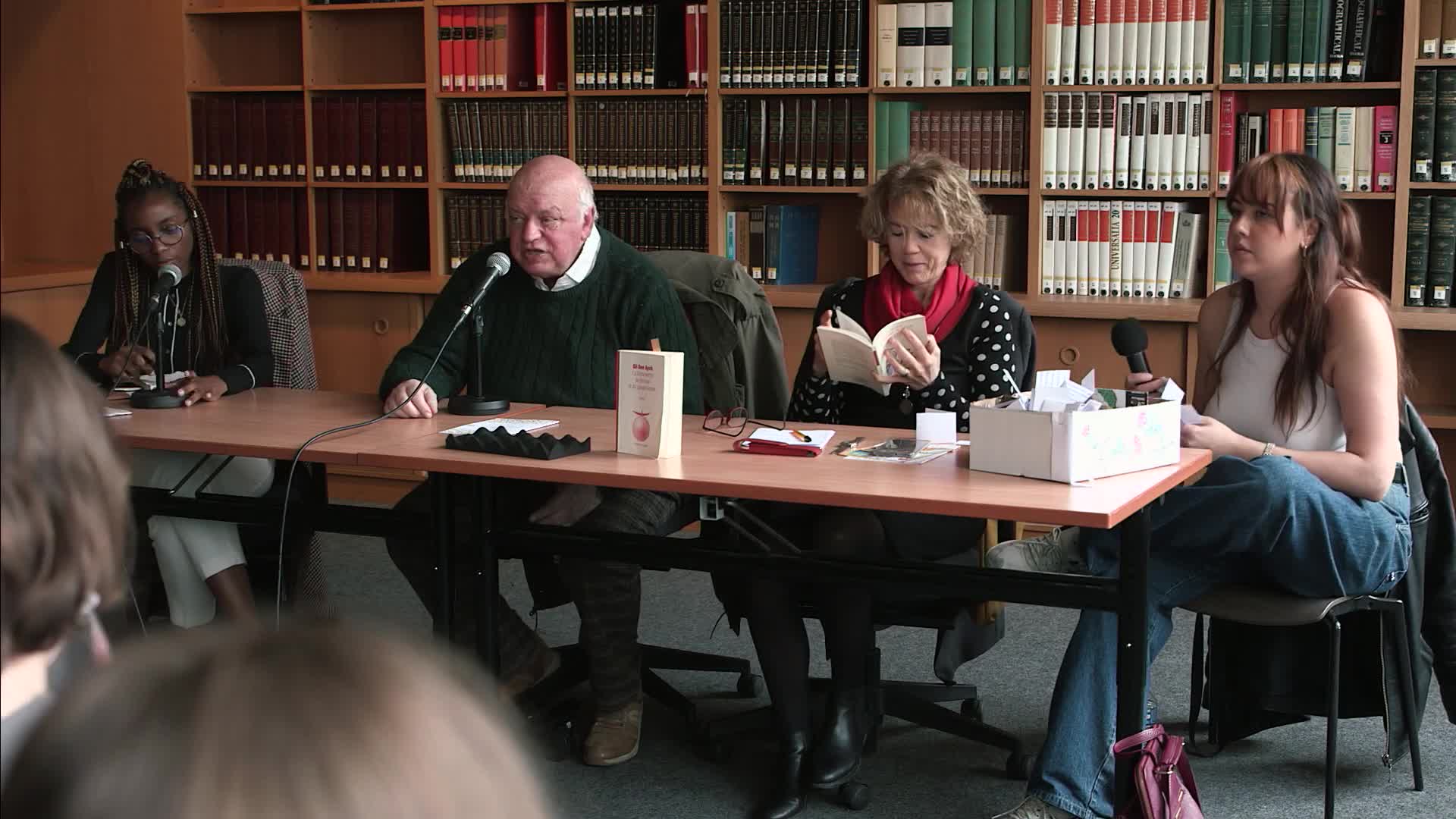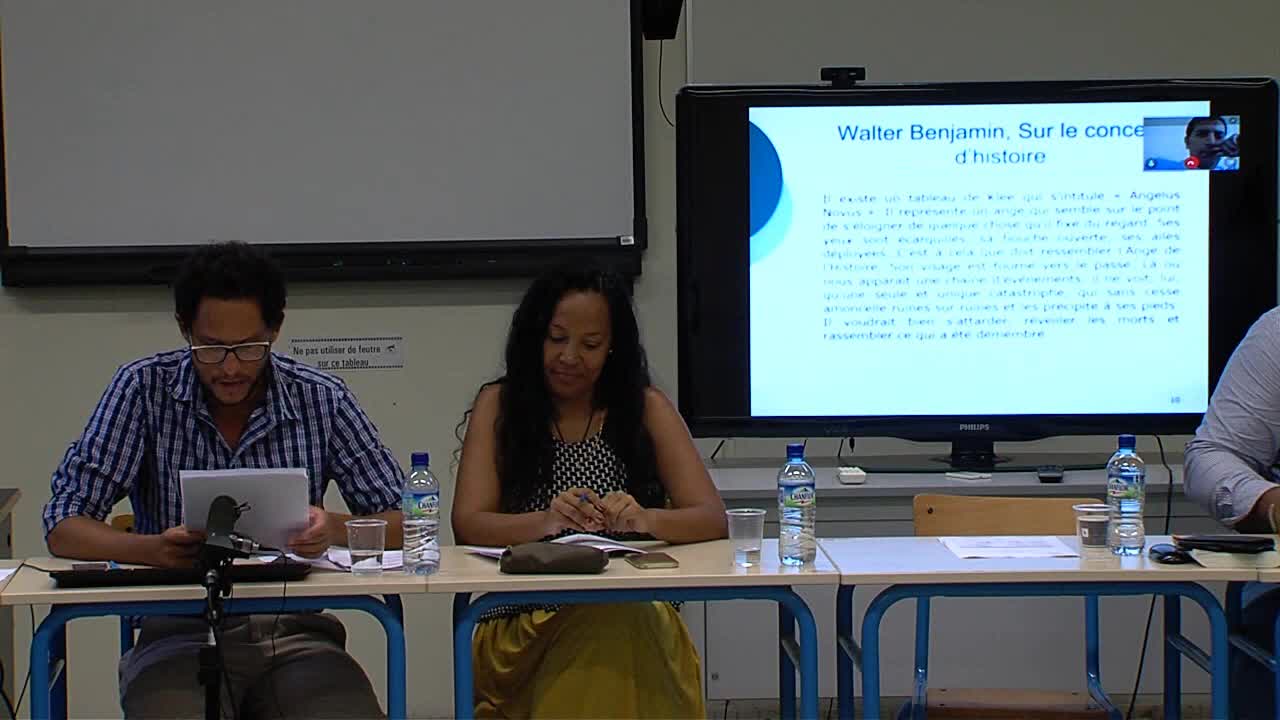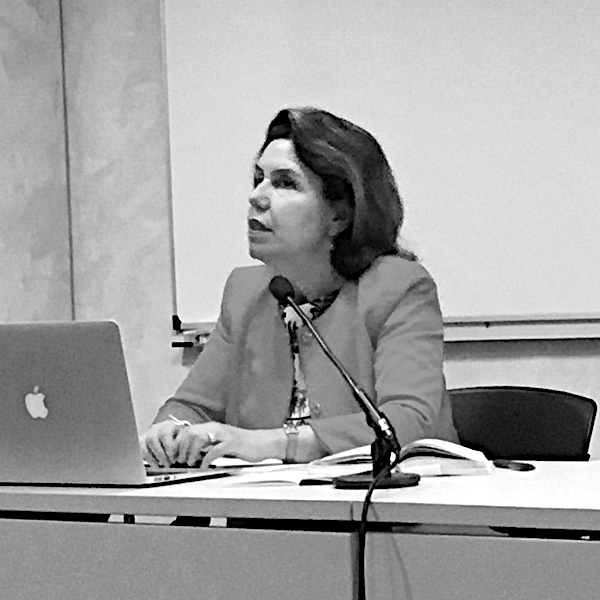Chapitres
- Les morales de Sartre : le Flaubert ou l'Esquisse ?04'17"
- La logique de l’erreur et la tradition française d’une « logique de sentiments » 03'51"
- La morale immédiate entre la Psyché et L’être et le néant06'26"
- Conscience magique et émotion dans l’Esquisse d’une théorie des émotions 05'28"
- Sartre et Alain : l’imagination, l’enfant et le monde social08'00"
- Hyppolite : la logique de l’erreur et l’enfance chez Alain08'17"
- Le temps et le passé social chez Sartre 03'24"
- Merleau-Ponty et l’enfant. Sartre et Alain contra Piaget06'39"
- La généralisation de la psychanalyse chez Lévi-Strauss et chez Merleau-Ponty02'50"
- Trace d’une morale dans le Flaubert ? L’enfant et la mère06'14"
- Worms : l’enfance et le rapport avec Merleau-Ponty02'48"
- Auditeur inconnu : l’inachèvement de la morale et le problème de Dieu01'35"
Notice
Les morales de Sartre, une logique de l'erreur
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
A partir des indications fragmentaires données par Sartre, il est possible de suivre sa tentative d’élaborer une morale à partir d’une « logique de l’erreur » qui n’est autre qu’une « logique des émotions ». De L’Esquisse d’une théorie des émotions au livre sur Flaubert, en passant par la psychanalyse existentielle, cette logique se décline comme une originale théorie de l’enfance qui, reprenant certains nœuds de la philosophie d’Alain, renoue les thèmes de la temporalité, de l’imagination et du social et nous oriente vers une philosophie de la culture.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Bibliographie des ouvrages par ordre de citation :
J.-P. Sartre, Saint Genet : comédien et martyr (1952), Paris, Gallimard, 1988
J.-P. Sartre, L'Idiot de la famille : Gustave Flaubert de 1821 à 1857 (1971-1972), Paris, Gallimard, 1988
J.-P. Sartre, Sartre par lui-même, (éd de F. Jeanson) 1969, Paris, Gallimard, 1955.
J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983.
J.-P. Sartre, « Morale et histoire », in Les temps modernes, Nos 632-634, 2005, p. 268-414.
J.-P. Sartre, « Conférence de Rome » (1961), in Les temps modernes, no 560, 1993, p. 11-39.
T. Ribot, Logique des émotions (1905), Paris, L’Harmattan, 1998.
J.-P. Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions (1939), Librairie générale française, 2000.
P. Cabestan, “Qu’est-ce que s’émouvoir? Emotion et affectivité chez Sartre”, in Alter, n° 7, 1999, p. 91-120.
V. de Corebyter, « Esquisse pour une théorie des émotions », in F. Noudelmann et G. Philippe (éd.), Dictionnaire de Sartre, Paris, Champion, 1994.
J.-P.- Sartre, La Transcendance de l’Ego (1939), Paris, Vrin, 2003.
J.-P. Sartre, Les Carnets de la drôle de guerre, Paris, Gallimard, 1995.
J.-P. Sartre, L’Imagination (1936), Paris, PUF, 1989.
Alain, Les Idées et les âges (1927), Paris, Gallimard, 1961.
Alain, Entretiens au bord de la mer (1930), Paris, Gallimard, 1998.
T. Leterre, La Raison politique : Alain et la démocratie, Paris, PUF, 2000.
J. Hyppolite, « L’existence imaginaire et la valeur chez Alain », « Alain et les Dieux » in Id., Figures de la pensée philosophique, Tome 2, Paris, PUF, 1972.
J. English, « De l'ego à la psyché : une phénoménologie éclatée », in Cités « Sartre à l'épreuve : l'engagement au risque de l'histoire », n° 22, avril 2005.
M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945),
M. Merleau-Pony, Psychologie et pédagogie de l’enfant, Cours de Sorbonne 1949-1952, Paris, Verdier, 1991.
J. Piaget. La Représentation du monde chez l’enfant (1923), Paris, PUF, 2003.
S. Freud, Trois Essais sur la sexualité (1905), Paris, Gallimard, 1989.
C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté (1949), Pari, Pus, 1991.
M. Merleau-Pony, L’Institution, Paris, Belin, 2003.
S. de Beauvoir, J.-P- Sartre, M. Sicard, « Interférences », in Obliques n° 18-19, 1979, p. 325-329.
J. Lacan, « Les complexes familiaux » (1938), in Id. Ecrits, Paris, Seuil, 1966.
J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique (1960), Paris, Gallimard 1985.
M. Merleau-Ponty, « Préface », in Id., Signes (1960), Paris, Gallimard, 2001.
Noms des auteurs cités :
Alain
Bergson, Henri
Comte, Auguste
Deleuze, Gilles
Husserl, Edmund
Freud, Sigmund
Lacan, Jacques
Levi-Bruhl, Lucien
Mauss, Marcel
Mead, Margaret
Piaget, Jean
Ribot, Théodule
Wallon, Henri
Dans la même collection
-
Mourir pour...
CréponMarcLe passage le plus critique de Sartre envers l’analytique existentielle d’Heidegger dans L’Etre et le néant porte sur sa conception de l’être-pour-la-mort. La conception sartrienne de l’absurdité de
-
Sartre à Venise, une palinodie
JennyLaurentL’attachement de Sartre à Venise est profond et durable, mais aussi mystérieux car tout chez Sartre paraît s’opposer à Venise. Sartre trouve à Venise la possibilité de changer radicalement de projet
-
L'éthique de l'existentialisme
CaeymaexFlorenceL’inaboutissement de la morale de Sartre, loin de représenter l’échec de sa propre version de l’existentialisme, peut être envisagé positivement comme l’accomplissement de sa philosophie dans une
-
Une liberté qui change tout ? Sartre et les moments philosophiques du siècle
WormsFrédéricDes premiers romans aux ouvrages biographiques consacrés aux écrivains, en passant par les deux grands moments philosophiques de la guerre et des années soixante, Sartre décline de manière chaque fois
-
Sartre et la mort, l'oubli du corps dans l'Etre et le néant
HowellsChristinaDans le cadre du traitement sartrien de l’incarnation, du corps et de la facticité dans L’Etre et le néant, bien que de longues analyses soient consacrées à des problèmes comme ceux du désir, de l
-
Politique de l'autobiographie chez Sartre
DenisBenoîtEntre le récit autobiographique de Roquentin dans La Nausée et les dernières biographies dialoguées et filmées des années soixante-dix, se profile toute une nébuleuse de textes autobiographiques aux
Sur le même thème
-
00. Des comptables et des conteurs (Présentation avec Jean-Philippe Pierron)
PierronJean-PhilippeIntroduction à la série de podcasts "Aux Grands Remèdes les Petits Mots".
-
-
03. Soignants ou Soi-Niant (Avec Sonia Benkhelifa)
BenkhelifaSoniaAnimation : Romain Poncet, ingénieur de recherche en sociologie.
-
Quelle place pour les arbres dans l'éthique ?
HiernauxQuentinQuentin Hiernaux, professeur à l'Université libre de Bruxelles, discute dans cette vidéo de l'éthique appliquée aux arbres.
-
Portrait de Ryoa Chung, lauréate 2023 des prix de recherche de la Fondation Croix-Rouge française
ChungRyoaRyoa Chung est co-Directrice du Centre de Recherche en Éthique et professeure titulaire au département de philosophie, Université de Montréal.
-
La Bibliothèque francophone reçoit Gil Ben Aych
Ben AychGilAllouacheFerroudjaRencontre littéraire avec l'écrivain Gil Ben Aych organisée par La Bibliothèque francophone.
-
Poétique de l'errance : penser les marges dans la littérature brésilienne contemporaine
Mingote Ferreira de ÁzaraMichelPoétique de l'errance : penser les marges dans la littérature brésilienne contemporaine
-
En résidence à la Maison Suger : Scarlett Marton
MartonScarlettScarlett Marton nous parle de son séjour à la Maison Suger Sous-titres et transcription disponibles en français et en anglais.
-
La désesthétisation de l'art contemporain : les enjeux politiques de la représentation à l'heure du…
Laurent Buffet part du constat fait par les sociologues de l’art d’une esthétisation du monde capitaliste, pour défendre l’idée que les artistes contemporains et actuels les plus intéressants sont
-
L'entre deux mondes de la vie intentionnelle selon Roman Ingarden
Patricia LImido explique dans sa conférence le désaccord philosophique entre Husserl et son disciple polonais. Dans "L’œuvre d’art littéraire", Roman Ingarden fait des entités fictionnelles des objets
-
Le pouvoir de la science comme force, pulsion, désir
Dans sa conférence plénière, Rudolf Bernet explore un autre champ que celui de la vie humaine subjective balisé dans son dernier livre, et déplace sa problématique en la mettant à l’épreuve à la
-
Le bien, le beau, l'art
Dans ses Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du beau, Diderot rompt avec la conception métaphysique du Beau qui, de l'Antiquité à l'âge classique, liait intimement ce dernier au Bien