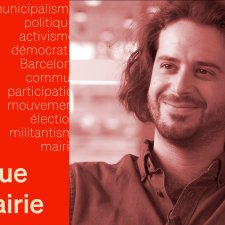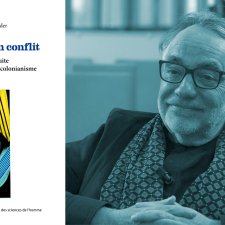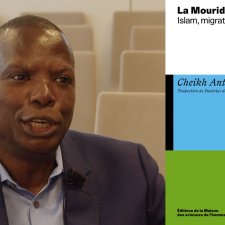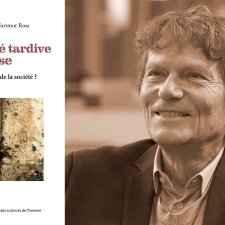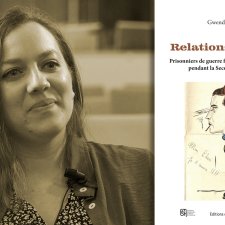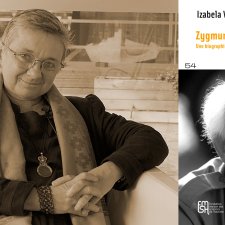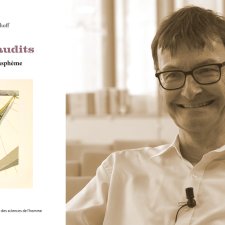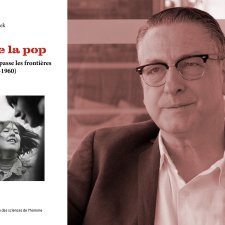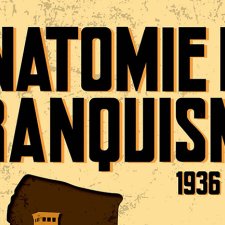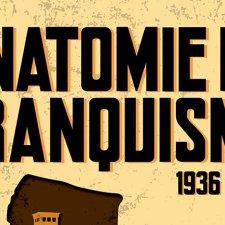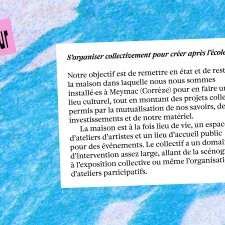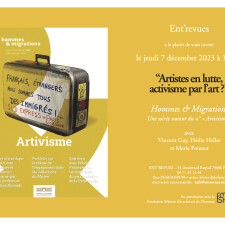Chapitres
- Pourquoi écrire cet ouvrage ?01'11"
- Structure du livre01'41"
- Mahamadou Keita01'27"
- Combat de l'AME01'32"
- Proclamation de l'autonomie des expulsés01'46"
- Expulsés peu entendus01'10"
- Citation commentée02'04"
Notice
Retranscription
Il y a un déséquilibre absolument flagrant entre la place prise par les étrangers à expulser dans les discours politiques et dans la couverture médiatique des migrations et le fait qu'une fois que ces personnes sont expulsées, elles sont tout à fait occultées du débat public, elles disparaissent littéralement de nos discussions et de nos préoccupations politiques. Donc je souhaitais par ce livre rendre visible cette phase qui suit l'expulsion et dans laquelle les expulsés depuis les années 1990, au Mali, puis dans d'autres pays africains, se sont organisés, regroupés au sein d'associations, à la fois pour organiser les conditions minimales d'un accueil pour ceux qui rentrent, mais aussi pour diffuser, depuis l'Afrique, une critique des politiques migratoires ainsi que des États africains que les expulsés considèrent d'une certaine manière complices de ces politiques. Le livre commence par le récit et l'analyse d'un anniversaire, celui de l'Association malienne des expulsés, qui a été créé en 1996 à Bamako et qui a constitué une initiative pionnière en termes d'organisation, de rassemblement des expulsés. Et cet anniversaire, ces 20 ans qui ont eu lieu en 2016, me permettaient de circonscrire une séquence historique, celle qui a permis l'organisation d'un mouvement des expulsés à l'intérieur de l'Afrique, d'analyser l'évolution de ce mouvement, son intrication avec les instances politiques et les ONG partenaires et de montrer comment ces sujets historiquement invisibilisés, oppressés, ont réussi à un mouvement d'auto-organisation en Afrique. Et à partir de cette scène, celle de la célébration de cet anniversaire, j'essaie de dresser une sorte de micro-histoire de la genèse et de l'évolution de différentes associations d'expulsés en Afrique. Au Mali d'abord, puis au Togo, en Sierra Leone et au Cameroun, de montrer comment, en fonction des différents contextes politiques, ces associations se sont structurées et ont, selon les contraintes et les autorisations accordées à leur mobilisation, modulé leur slogan, leur mot d'ordre, leur revendication. Alors Mahamadou Keita, je lui dédie l'avant-propos de cet ouvrage, car c'est un garçon qui est décédé très jeune, qui était lui-même un expulsé, il avait été expulsé de France vers le Mali en 2006. Immédiatement après son retour, il est passé au registre de l'action collective en rejoignant l'Association malienne des expulsés, dont il est devenu le secrétaire général, et c'est lui qui effectuait l'accueil des expulsés à l'aéroport de Bamako, dans un geste d'identification et de solidarité vis-à-vis de ceux qu'il appelait ses frères expulsés. Il me semble que son action était tout à fait emblématique du geste de l'auto-organisation, c'est-à-dire de recréer, au milieu des épreuves que traversent les expulsés, le sentiment d'une communauté, d'une fraternité, d'un entre soi qui permet de surmonter ce moment de l'après-expulsion. Je voulais à travers cet avant-propos aussi montrer comment la vie d'un homme, d'une certaine manière, et la transformation qu'avait représenté pour lui ce passage à l'action collective, faisait écho à la transformation collective qui a permis l'émergence des expulsés comme acteurs politiques et sujets de lutte. Ce qui me semble très important, c'est que le simple fait pour les expulsés d'endosser ce terme d'expulsés, de revendiquer une condition commune est déjà symboliquement un coup de théâtre, d'une certaine manière, parce qu'ils passent de l'invisibilité à une possible in…
Lire l'intégralitéLes expulsés, sujets politiques
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Interview de Clara Lecadet, dans le cadre de la sortie de son ouvrage Les expulsés, sujets politiques.
L'ouvrage :
Les mesures d'expulsion comme les lois sur l’immigration font de fréquents retours sur la scène politique et dans les médias. Pourtant, les principaux intéressés, à savoir les expulsés eux-mêmes, sont trop peu entendus dans le débat public.En retraçant l’histoire de l’Association malienne des expulsés et d’autres associations semblables au Togo, au Cameroun et en Sierra Leone, Clara Lecadet s’intéresse à l’humain derrière la mesure. Quelle est la réalité de l’après expulsion ? Tenant compte de la honte et des difficultés matérielles inhérentes à cette épreuve, l’autrice décrit les luttes menées par les expulsés pour se reconstruire en tant que sujets politiques et imposer une présence collective dans l’espace public. Émergent ainsi de ces personnes historiquement opprimées et longtemps invisibilisées des revendications, des positionnements politiques et des actions d’entraide inédites.Clara Lecadet montre également comment l’auto-organisation résiste au temps en s’inscrivant dans un réseau international d’associations et d’ONG.
Retrouvez la transcription dans l'onglet "Documentation"
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Transcription
Il y a un déséquilibre absolument flagrant entre la place prise par les étrangers à expulser dans les discours politiques et dans la couverture médiatique des migrations et le fait qu'une fois que ces personnes sont expulsées, elles sont tout à fait occultées du débat public, elles disparaissent littéralement de nos discussions et de nos préoccupations politiques. Donc je souhaitais par ce livre rendre visible cette phase qui suit l'expulsion et dans laquelle les expulsés depuis les années 1990, au Mali, puis dans d'autres pays africains, se sont organisés, regroupés au sein d'associations, à la fois pour organiser les conditions minimales d'un accueil pour ceux qui rentrent, mais aussi pour diffuser, depuis l'Afrique, une critique des politiques migratoires ainsi que des États africains que les expulsés considèrent d'une certaine manière complices de ces politiques. Le livre commence par le récit et l'analyse d'un anniversaire, celui de l'Association malienne des expulsés, qui a été créé en 1996 à Bamako et qui a constitué une initiative pionnière en termes d'organisation, de rassemblement des expulsés. Et cet anniversaire, ces 20 ans qui ont eu lieu en 2016, me permettaient de circonscrire une séquence historique, celle qui a permis l'organisation d'un mouvement des expulsés à l'intérieur de l'Afrique, d'analyser l'évolution de ce mouvement, son intrication avec les instances politiques et les ONG partenaires et de montrer comment ces sujets historiquement invisibilisés, oppressés, ont réussi à un mouvement d'auto-organisation en Afrique. Et à partir de cette scène, celle de la célébration de cet anniversaire, j'essaie de dresser une sorte de micro-histoire de la genèse et de l'évolution de différentes associations d'expulsés en Afrique. Au Mali d'abord, puis au Togo, en Sierra Leone et au Cameroun, de montrer comment, en fonction des différents contextes politiques, ces associations se sont structurées et ont, selon les contraintes et les autorisations accordées à leur mobilisation, modulé leur slogan, leur mot d'ordre, leur revendication. Alors Mahamadou Keita, je lui dédie l'avant-propos de cet ouvrage, car c'est un garçon qui est décédé très jeune, qui était lui-même un expulsé, il avait été expulsé de France vers le Mali en 2006. Immédiatement après son retour, il est passé au registre de l'action collective en rejoignant l'Association malienne des expulsés, dont il est devenu le secrétaire général, et c'est lui qui effectuait l'accueil des expulsés à l'aéroport de Bamako, dans un geste d'identification et de solidarité vis-à-vis de ceux qu'il appelait ses frères expulsés. Il me semble que son action était tout à fait emblématique du geste de l'auto-organisation, c'est-à-dire de recréer, au milieu des épreuves que traversent les expulsés, le sentiment d'une communauté, d'une fraternité, d'un entre soi qui permet de surmonter ce moment de l'après-expulsion. Je voulais à travers cet avant-propos aussi montrer comment la vie d'un homme, d'une certaine manière, et la transformation qu'avait représenté pour lui ce passage à l'action collective, faisait écho à la transformation collective qui a permis l'émergence des expulsés comme acteurs politiques et sujets de lutte. Ce qui me semble très important, c'est que le simple fait pour les expulsés d'endosser ce terme d'expulsés, de revendiquer une condition commune est déjà symboliquement un coup de théâtre, d'une certaine manière, parce qu'ils passent de l'invisibilité à une possible intervention, à une possible participation au débat public. Au Mali, l'Association malienne des expulsés, en Sierra Leone, le Network of ex-asylum seekers ont réussi, par leurs interventions dans les médias, par l'organisation de forums et de débats publics qui ont donné la voix et le droit de cité aux expulsés, à peser sur les politiques nationales, à opérer des transformations, à devenir des interlocuteurs à la fois des pouvoirs politiques et des acteurs de la gouvernance mondiale des migrations. Ces sujets historiquement invisibilisés ont pris place dans le débat public et ont réussi à obtenir des transformations des politiques nationales. Il y a à la fois le coup de force symbolique de se rassembler sous ce terme d'expulsés et puis de vraies transformations politiques opérées par ces expulsés qui sont devenus progressivement des interlocuteurs des pouvoirs publics. Lorsque les expulsés en 1996 à Bamako ont créé l'Association malienne des expulsés, il y avait entre eux un sentiment d'abandon et de défiance partagée vis-à-vis de l'État. Non seulement l'État qui les avait expulsés, mais aussi leur propre État qu'ils considéraient complice des épreuves qu'ils avaient subies. Ils dénonçaient non seulement les politiques à l'origine de leur expulsion, mais aussi l'attentisme, voire l'incapacité de leur État à les protéger des épreuves qu'ils avaient traversées. Ce thème de l'abandon a constitué un motif récurrent tout au long des mobilisations menées par l'Association malienne des expulsés depuis les années 1990. C'est ce thème de l'abandon qui a permis de construire une critique politique de l'État, l'État qui expulse, mais aussi l'État d'origine qui est d'une certaine manière coupable de ne pas pouvoir protéger ses ressortissants. Ce besoin, cette nécessité de constituer une sorte d'entre-soi, de communauté parmi ceux qui ont subi des mesures d'expulsion naissait d'une hostilité vis-à-vis de tous les corps politiques institués. Et ce que les expulsés ont cherché à créer, c'est précisément un espace de représentation et de prise de parole propre qui puisse les constituer en sujets politiques et qui puisse donner une voix et un espace de parole à ces sujets qui, jusque-là, ne participaient pas du tout au débat public. Les expulsés sont très peu visibles et très peu entendus dans le débat public, car les discours médiatiques et politiques sont, à mon avis, partagés entre deux extrêmes. C'est-à-dire que les étrangers sont constitués par les États comme une source de déstabilisation des États, comme un problème et comme une menace. Parallèlement, les expulsés sont présentés par les ONG, par le discours humanitaire et de défense des droits des migrants comme des victimes ou comme des populations vulnérables. Ces deux types de registres, aussi antagonistes puissent-ils paraître, ont en réalité une caractéristique commune, c'est qu'ils empêchent les expulsés de se présenter comme des sujets politiques, de se présenter comme des individus qui ont quelque chose à dire de leur expérience et des épreuves qu'ils ont traversées. Ce que j'ai essayé de montrer en retraçant une micro-histoire de différentes associations d'expulsés formées en Afrique, c'est aussi de montrer que ces associations se sont formées, se sont modelées en fonction de leur contexte politique national. Par exemple, au Mali, l'émergence du mouvement des Sans Voix dans les années 1990 a finalement donné une grande place à des populations subalternes, à des populations minorisées et leur a permis de s'exprimer et de diffuser leurs revendications dans l'espace public. Dans le même temps, au Togo, le caractère féroce du régime en place ne permettait pas à des mobilisations de subalternes, de populations minoritaires de se développer. Et les associations ont dû s'adapter à ces contextes très, très antagonistes, et ont modulé leurs revendications et leurs mots d'ordre en fonction de ces contextes. Par exemple, au Togo, l'Association togolaise des expulsés a dû adopter des revendications et des mots d'ordre beaucoup plus consensuels que ceux diffusés par l'Association malienne des expulsés dans l'espace public malien. Et ce qui est très intéressant à mon avis, c'est que dans leur position marginale liminaire, les expulsés deviennent d'une certaine manière les témoins de leur propre régime politique et de ce que ces régimes autorisent en matière de mobilisation et d'expression dans l'espace public.
Dans la même collection
-
De la rue à la mairie
HamouDavidInterview de David Hamou, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "De la rue à la mairie. Sociologie du municipalisme"
-
Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen
PavyFloreInterview de Flore Pavy, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"
-
Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme
SznaiderNatanInterview de Natan Sznaider, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme"
-
La Mouridiyya en marche
BabouCheikh Anta Mbacké" La Mouridiyya en marche" est un livre essentiel pour comprendre les interactions entre spiritualité, culture et mondialisation, sur la communauté soufie des Mourides du Sénégal.
-
La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ? - Hartmut Rosa
RosaHartmutInterview de Hartmut Rosa, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ?"
-
Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre…
CicottiniGwendolineInterview de Gwendoline Cicottini, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Relations interdites"
-
Zygmunt Bauman. Une biographie
WagnerIzabelaInterview de Izabela Wagner, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Zygmunt Bauman Une biographie"...
-
Black Metropolis : Une ville dans la ville. Chicago (1914-1945).
RaulinAnneAtukpeSarahInterview de Anne Raulin et Sarah Atukpe, dans le cadre de la sortie de l'ouvrage "Black Metropolis : une ville dans la ville. Chicago 1914-1945
-
Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir
PiazzaSaraInterview de Sara Piazza, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir"
-
Jardins en commun(s) - Politiser l'écologie ordinaire
SachseVictoriaInterview de Victoria Sachsé, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Jardins en commun(s). Politiser l'écologie ordinaire"
-
Dieux maudits - L'histoire du blasphème
SchwerhoffGerdInterview de Gerd Schwerhoff, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Dieux maudits. L'histoire du blasphème"
-
Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)
MrozekBodoInterview de Bodo Mrozek, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)"
Sur le même thème
-
-
Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan
LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de
-
Présentation de l’ouvrage « Vulnérables. Portraits sociologiques »
LachhebMoniaMoussaHayetBoissevainKatiaAbdessamadHichemMellitiImedThibaultAdrienL’IRMC organise une présentation - débat autour de l’ouvrage « Vulnérables. Portraits sociologiques », réalisé sous la direction de Imed Melliti, sociologue et chercheur associé à l’IRMC, et Hichem
-
Heritage Cosmopolitics in the Hindu Kush Himalaya region
HussainZahraInterview de Zahra Hussain, architecte et géographe, au sujet des communautés montagnardes de la région de l'Hindu Kush Himalaya confrontés aux changements climatiques et au développement des
-
"Paz, pan y trabajo”. Hombres y mujeres en los procesos migratorios en España (1951-1965)
Ortega LópezTeresa MaríaPor primera vez en Europa, el coloquio Anatomía del franquismo (1936-1977) ofrece una síntesis colectiva de los conocimientos sobre el franquismo, elaborada por historiadores e historiadoras.
-
"Paix, pain et travail" : hommes et femmes dans les processus migratoires en Espagne
Ortega LópezTeresa MaríaLe colloque "Anatomie du franquisme (1936-1977)" proposait pour la première fois en Europe une synthèse collective des connaissances sur le franquisme, réalisée par les historiennes et les historiens
-
Le sport et les investissements patronaux
VilleSylvainCe projet repose sur une approche biographique qui entend prendre pour objet des patrons d’entreprises variées et évoluant dans des secteurs différents entre 1880 et 1980 sur le sol français. Une
-
Fossile Futur – S’organiser collectivement pour créer après l’école d’art
BassonNinaDubedatSimonChaumelLéaNotre objectif est de remettre en état et de restaurer la maison dans laquelle nous nous sommes installé·es à Meymac (Corrèze) pour en faire un lieu culturel, tout en montant des projets collectifs
-
Luttes écologiques et logiques d'emprise. La rébellion des milieux fait-elle bouger le monde des or…
Depuis le milieu des années 1990, la sociologie des alertes et des controverses a mis en évidence les contraintes qui pèsent sur la trajectoire des causes publiques, en insistant sur les questions
-
Feeling British: An Interview with Zita Holbourne
LefrançoisFrédéricHolbourneZitaFeeling British: An Interview with Zita Holbourne
-
Ent'revues : Soirée "Artiste en lutte, activisme par l'art ?"
PoinsotMarieGayVincentRencontre avec Vincent Gay et Marie Poinsot, dans le cadre du nouveau numéro de la revue Hommes et Migrations : "Artivisme"
-