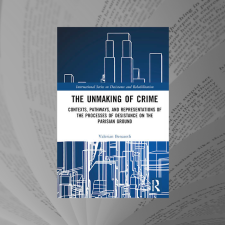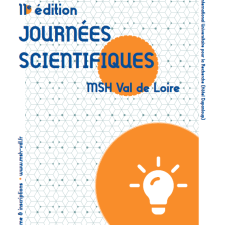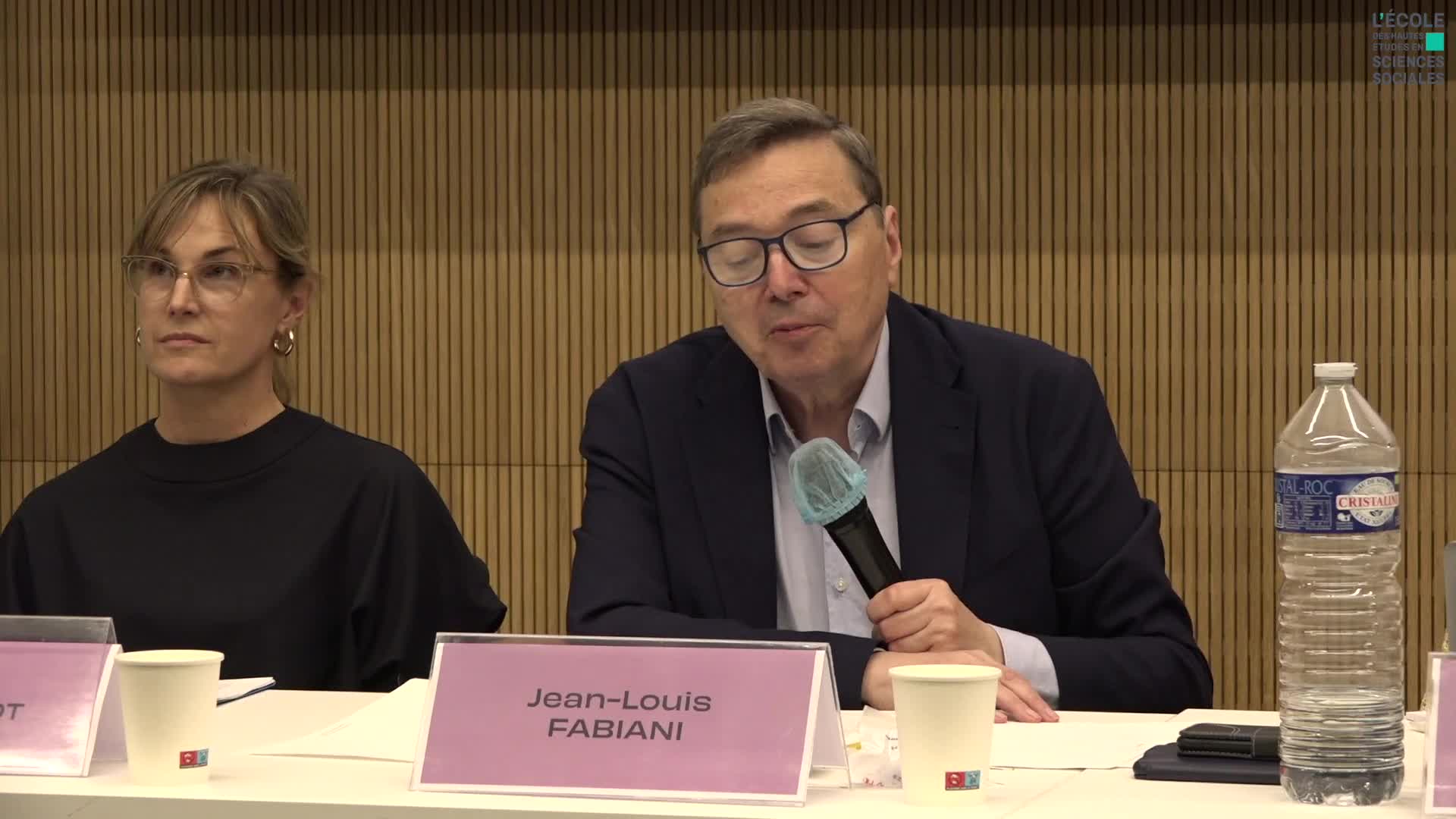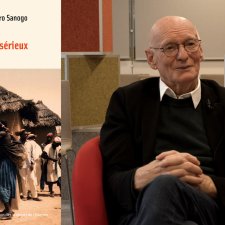Notice
La reconnaissance du génocide culturel au Canada
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque international Justice, Vérité & Résilience(s) qui s'est tenu à Caen les 23 et 24 novembre 2018. Ce colloque, porté par la MRSH, a été organisé dans le cadre du dispositif Normandie pour la Paix impulsé par la Région Normandie, avec le soutien de l’Institut Demolombe, de Caen la Mer et de l’Université de Caen et en partenariat avec l’Institut Universitaire Varenne.
Nourrir la paix durable suppose de lever le voile sur le silence qui recouvre une réalité souvent peu avouable. L’expérience de cette forme atypique de recherche de justice, nommée « justice transitionnelle », a été ouverte par Nelson Mandela, avec l’instauration des Commissions Vérités et Réconciliation en Afrique du Sud. Ce colloque international a pour ambition de réunir des acteurs clefs de commissions s’étant tenue sur divers continents. Une réflexion sera menée sur la question de la protection des défenseurs de l’environnement qui subissent des exactions à travers la planète. Sera également abordée la question du rôle des tribunaux d’opinion portés par la société civile.
Fannie Lafontaine est avocate, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux. Elle est membre régulier de l'Institut québécois des hautes études internationales et co-directrice du Centre de droit international et transnational de l’Université Laval. Elle est la fondatrice et co-directrice de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, récipiendaire du prix «Hommage aux innovations sociales» de l’Université Laval.
Résumé de la communication
Durant leXXème siècle, le gouvernement canadien a mené une politique quivisait à « tuer l’indien dans l’enfant ». Del’année 1878 à 1996, 150 000 enfants autochtones ont étéplacés dans les pensionnats, dès l’âge de 6 ans jusqu’à leurs16 ans, 6 000 enfants ont trouvé la mort. À l’origine,l’objectif affiché était d’ériger « la solutionfinale au peuple autochtone ». Les taux de mortalité dansles pensionnats étaient en moyenne de 35% et pouvaient monter jusqu’à75%, notamment en raison de la malnutrition. Les peuples autochtonesy ont subi des violences psychologiques, l’acculturation, lamalnutrition et ont pu faire l’objet d’expérimentationsmédicales. La Commission Vérité et Réconciliation du Canadamènera des travaux durant 7 années qui aboutiront en 2004 à ladélivrance d’un rapport final particulièrement conséquent.Fannie Lafontaine a insisté sur deux apports fondamentaux. D’unepart, la Commission reconnaît la réalité d’un génocideculturel défini comme « la destruction desstructures et des pratiques qui permettent aux groupes de vivreensemble en tant que groupes » : destructions desinfrastructures, déplacements de forces et limités, interdictionsdes pratiques culturelles. D’autre part, le rapport conclut à 94appels à l’action, à l’endroit de l’ensemble de la sociétécanadienne (gouvernement fédéral, fédérés, société civile,facultés de droit...). Il reste pour le moins que la populationcanadienne est longtemps restée dans l’ignorance des pensionnatsautochtones. La chercheuse cite alors le centre national pour lavérité et la réconciliation, qui a fait un sondage à travers leCanada. Le résultat paraît stupéfiant : un canadien sur deuxignore les pensionnats des peuples autochtones. Reste que l’onassiste à un réveil des peuples autochtones dont la fierté a étéretrouvée.
Thème
Sur le même thème
-
Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan
LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de
-
Valerian Benazeth - The Unmaking of Crime
BenazethValerianL’ouvrage documente les parcours d’anciens contrevenants qui réforment leur mode de vie et renoncent à la criminalité, analysant les capacités et limites du système pénal pour faciliter ce processus.
-
Les invasions biologiques : quelles perceptions par le public ?
ArbieuHugoUgo Arbieu, chercheur post-doctorant à l'université Paris Saclay, montre dans cette vidéo l'intérêt de la culturomique pour étudier la perception sociale des invasions biologiques.
-
Reconfigurations de l’aptitude à être affecté : de la réception à l’émancipation, Spinoza à l’épreu…
BaudeyMatthieuCe projet s’appuie sur une mission de terrain de quatre mois au Kazakhstan pendant laquelle il s’agit de mener des entretiens qualitatifs avec les membres de différents mouvements sociaux, culturels
-
JRSS 2022 - Session de clôture
Session de clôture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
JRSS 2022 - Session d'ouverture
Session d'ouverture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
Engagement dans les sciences sociales : contraintes et tensions dans le monde 2/2
VegSebastianКопосовНиколай ЕвгеньевичBehrValentinKarsentiBrunoJouanjanOlivierLadier-FouladiMarieLes sciences sociales, en tant que savoirs critiques et émancipateurs, sont exposées aux tensions politiques des contextes où elles se produisent.
-
Autorité et autonomie des sciences sociales : construire une communauté de pairs 4/1
KarsentiBrunoSabbaghDanielMarzoukiNadiaFabianiJean-LouisFriedlanderJudithTerziCédricOrléanAndréSi les connaissances produites par les sciences sociales peuvent jouir d’autorité dans l’opinion, c’est qu’elles se soumettent à des règles méthodologiques, à des modes d’administration de la preuve
-
Les sciences sociales dans la cité : demandes publiques, contraintes, expertises 2/1
DaucéFrançoiseBozarslanHamitPortilloJosé MaríaGousseffCatherineAktarO. CengizZevounouLionelLes sciences sociales sont dans un rapport intérieur à la cité qui justifie qu’on les interroge et qui fonde un certain nombre d’attentes légitimes à leur égard, que ce soit de la part des pouvoirs
-
Ouverture du colloque Sciences sociales en danger ? 1/1
ProchassonChristopheKarsentiBrunoThireauIsabelleOuverture du colloque Sciences Sociales en danger ? Pratiques et savoirs de l'émancipation, 22 et 23 septembre 2022 au Centre des colloques au Campus Condorcet, par Christophe Prochasson, président de
-
LES « DIT-ON » ET AUTRES RÉCITS PLUS SÉRIEUX - INTERVIEW DE JEAN-PAUL COLLEYN
ColleynJean-PaulInterview de Jean-Paul Colleyn dans le cadre de la sortie du livre, "Les « dit-on » et quelques autres récits plus sérieux" publié le 16 février 2023 dans la collection "54" des Éditions de la FMSH.
-
Anne Sedès et Nicolas Thély - À propos de #JournéeEcologieClimaRNMSH - Ouverture de la journée
ThélyNicolasSédèsAnneOuverture de la journée