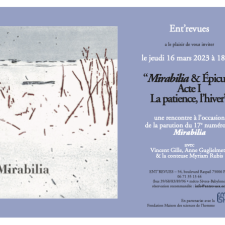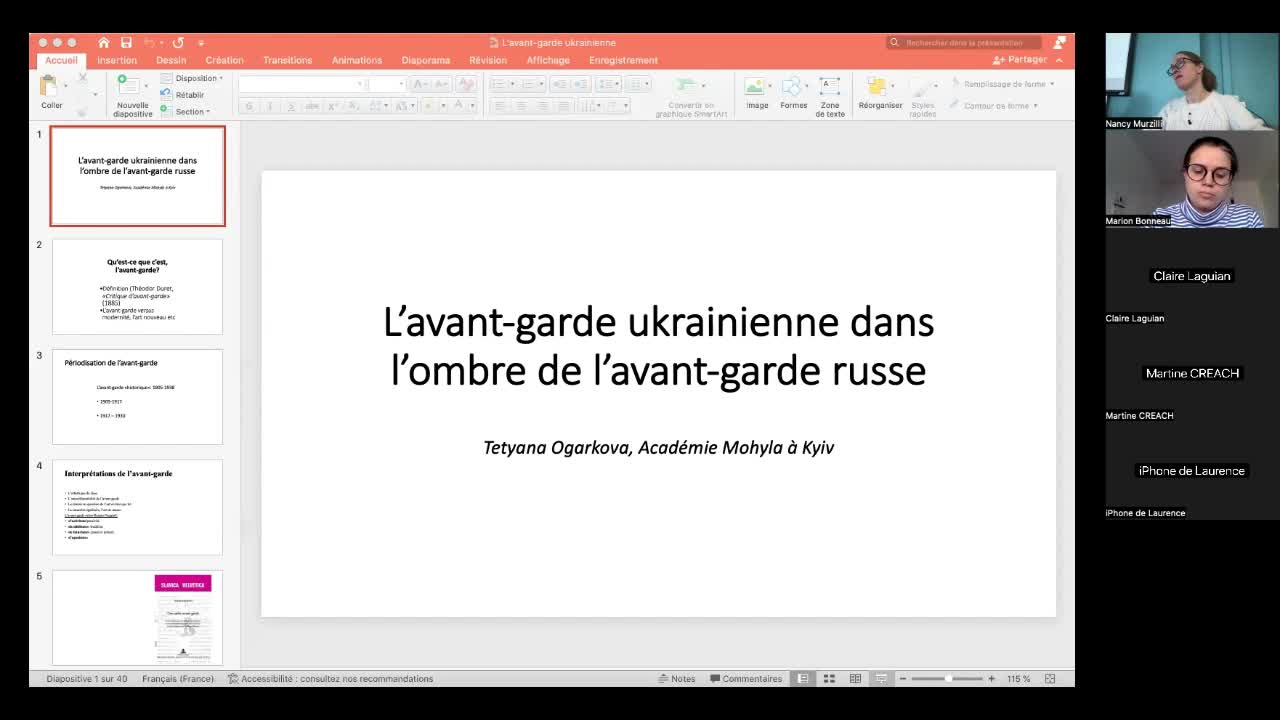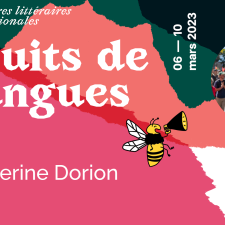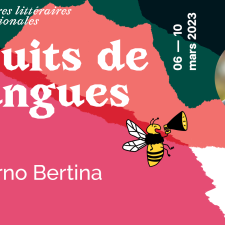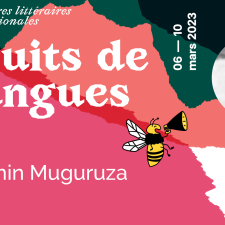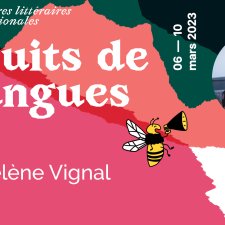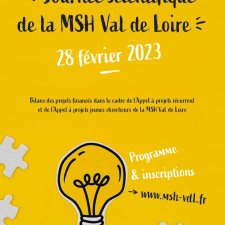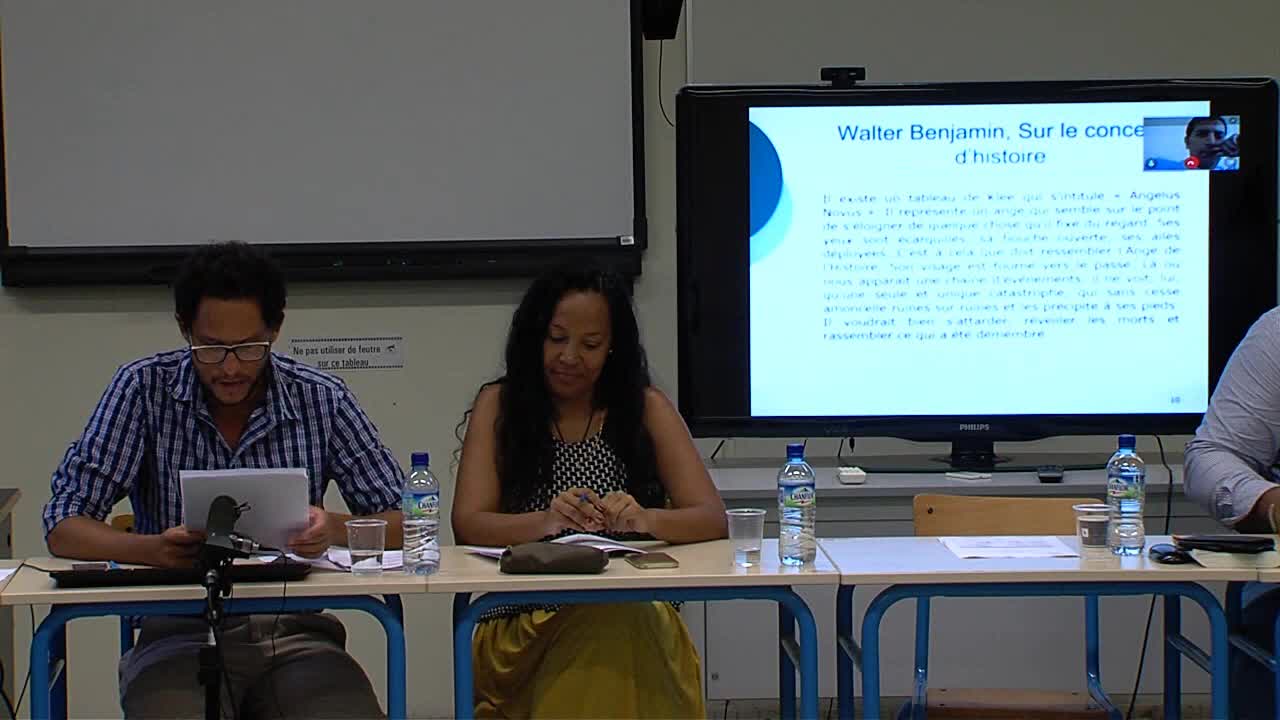Notice
MRSH Caen
Pour une éthique des lettres
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été enregistrée lors d'une journée d'études (7 et 8 novembre 2018) consacrée à Claude Chabrol, à l’usage critique (dans ses articles) et dramatique (dans ses films) de la lettre, à la manière dont celle-ci contribue à la fatalité des intrigues chabroliennes. Figure critique certes moins éminente que ses camarades au milieu des années 50, Claude Chabrol a néanmoins, dans son œuvre prolifique, partagé avec eux le souci d’accorder à l’écrit une fonction souvent cruciale, fatidique même, propre à précipiter ceux qui en sont victimes dans les eaux troubles d’un sort irrémédiable. La lettre tue chez lui, elle est un poison qui tourmente ou terrasse. Parfois anonyme, souvent cachetée d’une mauvaise foi, elle circule d’experts (écrivains, journalistes, postiers, etc.) en pauvres destinataires funestement ciblés. Lecteur précoce, adorateur déclaré de Madame Bovary, admirateur de Georges Simenon, de Ruth Rendell, de la série noire, Claude Chabrol mérite à tous égards de compléter la liste des cinéastes de la Nouvelle Vague (Eric Rohmer, François Truffaut et Jacques Rivette) étudiés au Laslar depuis 2014 sous l’angle de l’écrit fondateur. La plume et les masques étant monnaie courante dans ses films, il est loisible d’en étudier les jeux de dupes et autres mauvais augures, aussi bien dans l’ordre narratif que dans les partis pris de réécriture ou reformulation de l’œuvre littéraire adaptée.
Docteure en Histoire et sémiologie du texte et de l'image (2017), agrégée de Lettres classiques, Nathalie Mauffray est chargée de cours de cinéma à l'UFRLAC de l'Université Paris Diderot.
Résumé de la communication
La Jeune fille coupée en deux de Claude Chabrol (2007)
S’inspirant du crime passionnel en 1906 d’un architecte new-yorkais pour sa liaison avec une danseuse de cabaret, objet de nombreuses adaptations, tant littéraires que cinématographiques, Claude Chabrol, dans La Jeune fille coupée en deux (2007), transpose de manière significative ce fait divers dans le milieu littéraire contemporain. Par la mise en scène du couple Gabrielle Deneige (Ludivine Sagnier)/ Charles Saint-Denis (François Berléand), une Miss Météo et un écrivain à succès, il double le récit d’une dimension éthique et allégorique sur la tension que le cinéma opère entre, d’un côté, les images, leur impact visuel et sonore, la présence sensible des corps et, de l’autre, l’espace de la conscience, des lettres et du discours.
Sur le même thème
-
Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan
LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de
-
Emma Larthomas, étudiante et cinéaste, itinéraire d'une créatrice précoce
Brunet-MalbrancqJoëlleLarthomasEmmaLes causeries de la culture - La culture à l'université 2
-
Ent'revues : Soirée "Mirabilia"
GilleVincentGuglielmettiAnneRubisMyriamRencontre avec Vincent Gille, Anne Guglielmetti et la conteuse Myriam Rubis à l'occasion de la parution du 17e numéro de "Mirabilia".
-
Conférence de Tetyana Ogarkova : « L’avant-garde ukrainienne dans l’ombre de l’avant-garde russe »
OgarkovaTetyanaL’équipe FabLitt a eu le plaisir de recevoir, le 4 avril 2023, Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla, professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée
-
Le CiD - Le cinéma et le droit : Investigation comparative des dilemmes bioéthiques
LassalasChristineBorgesRose-MarieChristine Lassalas (CMH) et Rose-Marie Borges (CMH) relatent la manière dont elles ont conduit le projet Le Cid, programme croisant le cinéma, le droit et l'éthique.
-
Rencontre avec Catherine Dorion
Rencontre avec l'autrice, comédienne et militante politique du Quebec, Catherine Dorion
-
Rencontre avec Arno Bertina
BertinaArnoConsidérant que sa « langue natale, c’est le roman », Arno Bertina se construit autour d’un langage et d’une littérature variée, l’amenant à co-fonder le collectif d’écrivains autour de la revue et de
-
A la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé
LefrançoisFrédéricAugustinAudreyLavenairePascaleLazloViktorCatalanLindsayA la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé
-
Rencontre avec Fermin Muguruza
Entretien avec le chanteur et cinéaste, Fermin Muguruza lors du festival international Bruits de Langues 2023
-
-
Translatio. Réception de l'Antiquité classique dans le japon contemporain
CaltotPierre-AlainHenningerAlineLe programme de recherches Translatio vise à s’intéresser à la réception et à la présence de l’Antiquité classique, en l’occurrence Antiquité grecque et romaine, dans le Japon moderne et contemporain,
-
Poétique de l'errance : penser les marges dans la littérature brésilienne contemporaine
Mingote Ferreira de ÁzaraMichelPoétique de l'errance : penser les marges dans la littérature brésilienne contemporaine