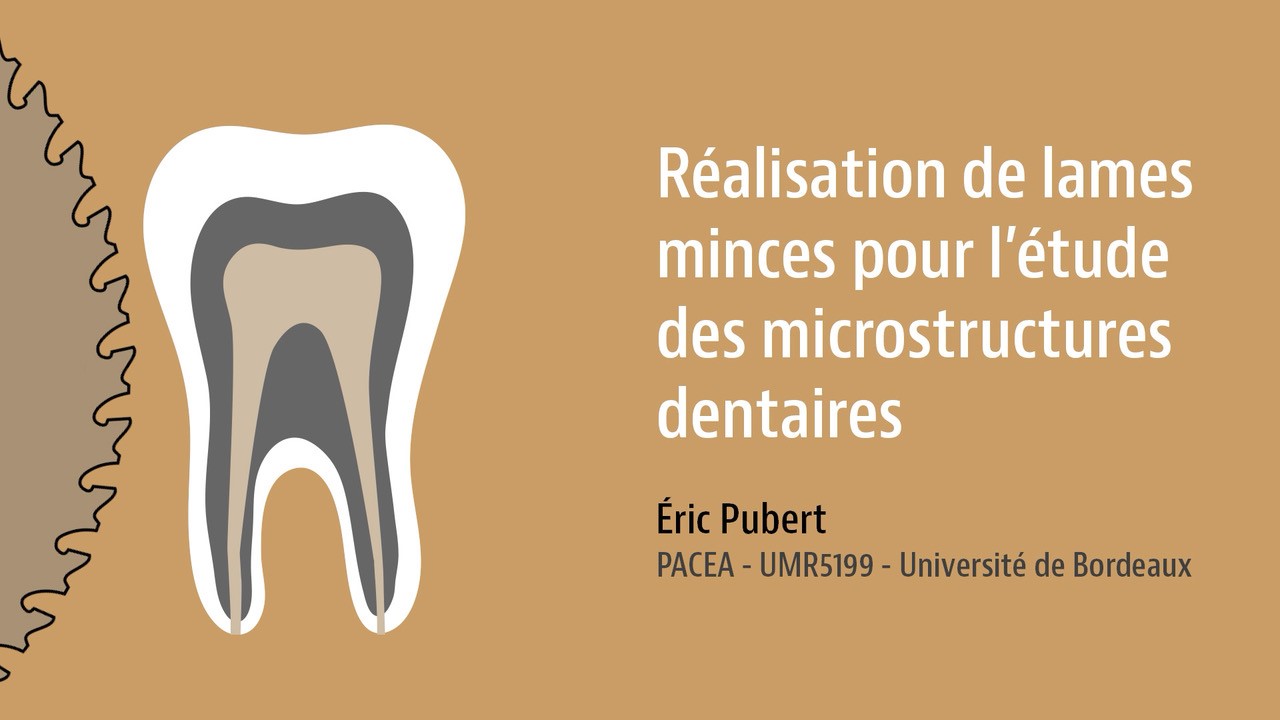Chapitres
- La préhistoire du cinéma01'05"
- Les frères Lumière et Charles Pathé01'48"
- Robert Flaherty03'04"
- John Grierson01'10"
- Dziga Vertov01'55"
- L'école anglaise01'16"
- Henri Stork et Joris Ivens01'00"
- La seconde guerre mondiale03'14"
- La musique et le commentaire01'40"
- Jean Rouch et le son direct03'51"
- Michel Brault et le son synchrone04'07"
- La vidéo d'intervention06'06"
- Beauviala l'inventeur04'30"
- L'écriture cinématographique en vidéo01'26"
- Le documentaire et la télévision03'25"
- Filmer seul(e)04'23"
- Toujours le cinéma02'16"
- L'autobiographie05'49"
Notice
Le documentariste et ses outils à travers les âges (Penser le cinéma documentaire : leçon 1, 1/2)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- Dossier
Descriptif
Le cinéma documentaire est né de la rencontre entre le désir des cinéastes d'explorer le monde et la passion des inventeurs d'enregistrer le réel :
Entre Louis et Auguste Lumière, filmant le déjeuner en famille avec une caméra cinématographe noir et blanc muette et Dominique Cabréra se filmant elle-même avec une caméra DV numérique en couleurs et sonore, il y a cent ans d'écriture documentaire et d'inventions techniques.
Les cinéastes ont cherché à transmettre, avec leur point de vue, la vie quotidienne de leurs contemporains en s'approchant progressivement au plus près de leur intimité, jusqu'à parfois devenir les propres "acteurs" de leurs films.
Pour en arriver là, un dialogue permanent s'est établi entre eux, des inventeurs et des ingénieurs. il a fallu alléger les caméras, les installer sur des trépieds fluides, domestiquer la couleur de la pellicule, mener une véritable conquête pour entendre en direct les personnes que l'on filme, réunir sur un même support l'image et le son avec l'arrivée de la vidéo, inventer de nouvelles techniques de montage plus simples et plus rapides, miniaturiser tous ces équipements pour parvenir aux caméscopes que nous connaissons actuellement.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Visionner les extraits des films analysés dans la leçon :
- Entrée du train en gare de La Ciotat, un film de Louis Lumière et Auguste Lumière , 1895 - France - 35 mm
- Nanouk l'esquimau, Robert J. Flaherty, 1922 - États-Unis - 64 minutes - 35 mm
- L'homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929 - Russie - 67 minutes - 35 mm 1929 URSS
- Drifters, John Grierson, 1929 - Grande-Bretagne - 49 minutes - 16 mm
- Misère au borinage, un film de Henri Storck et Joris Ivens, 1933 - Belgique - 28 minutes - 35 mm
- Toute la mémoire du monde, un film d'Alain Resnais, 1956, France, 35 mm
- Les maîtres fous, un film de Jean Rouch, 1958 - 29 minutes - 16 mm
- Le joli Mai, un film de Chris Marker et Pierre Lhomme, 1962 - France - 80 minutes - 35 mm
Bibliographie,Filmographie
- BARNOUW Erik, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, Oxford University Press, 1993
- COLLEYN Jean Paul., Le regard documentaire, Paris, Centre Georges Pompidou,1993
- GAUTHIER Guy, Le documentaire, un autre cinéma, Nathan, 1995
- ODIN Roger, L’âge d’or du documentaire, Tome 1 et 2, Paris, L’Harmattan, 1998
- MARSOLAIS Gilles, L'aventure du cinéma direct, Seghers, Paris, 1974
- NICHOLS Bill, Representing reality. Issues and concepts in Documentary, Indiana University Press, 1991
- PIAULT Marc, Anthropologie et cinéma, Paris, Nathan, 2000
- PREDAL René, Le documentaire français, Cinémaction, n°41, 1987
- VERTOV Dziga., Articles, journaux, projets, Paris, U.G.E, 1972
- Entrée du train en gare de La Ciotat, un film de Louis Lumière et Auguste Lumière , 1895 - France - 35 mm
- Nanouk l'esquimau, Robert J. Flaherty, 1922 - États-Unis - 64 minutes - 35 mm
- L'homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929 - Russie - 67 minutes - 35 mm 1929 URSS
- Drifters, John Grierson, 1929 - Grande-Bretagne - 49 minutes - 16 mm
- Misère au borinage, un film de Henri Storck et Joris Ivens, 1933 - Belgique - 28 minutes - 35 mm
- Toute la mémoire du monde, un film d'Alain Resnais, 1956, France, 35 mm
- Les maîtres fous, un film de Jean Rouch, 1958 - 29 minutes - 16 mm
- Le joli Mai, un film de Chris Marker et Pierre Lhomme, 1962 - France - 80 minutes - 35 mm
- Pour la suite du monde, un film de Marcel Carrière et Michel Brault, Pierre Perrault, 1963 - Canada - 105 minutes - 16 mm
- Pour que la guerre s'achève..., un film de Luc et Jean Pierre Dardenne, 1980, Belgique, 16 mm
- Les patients, un film de Claire Simon, 1989, France, 75 minutes - Vidéo
- Demain et encore demain, un film de Dominique Cabrera, 1998, FRANCE.
Sur le même thème
-
Le pouvoir de la science comme force, pulsion, désir
Dans sa conférence plénière, Rudolf Bernet explore un autre champ que celui de la vie humaine subjective balisé dans son dernier livre, et déplace sa problématique en la mettant à l’épreuve à la
-
Médecine améliorative et santé connectée
Daniela Cerqui-Ducret évoque certains enjeux anthropologiques liés au transhumanisme. En particulier, elle relativise l’opposition souvent faite entre réparer et améliorer pour montrer que le
-
Exploiter l'information brevet
KermadecYann deInterview : comment exploiter l’information brevet ? Développer l’expertise technique, combiner les moyens pour créer.
-
Sur les traces du Galermi
BouffierSophieSur les traces du Galermi Le Sur une idée originale de Sophie Bouffier (AMU - Centre Camille Jullian, UMR 7199) Le film retrace les principales étapes d'une étude interdisciplinaire portant sur
-
Réalisations de lames minces pour l'étude des microstructures dentaires
PubertEricLes dents ont la capacité d’enregistrer dans leurs structures internes, les cycles ou les évènements qui ponctuent la vie d’un individu : variations métaboliques cycliques, grossesses, maladies,
-
Reproduction d'objets par prise d'empreinte en silicone et tirage de répliques en résine
PubertEricDans le domaine de l’archéologie, chaque objet est unique et la réalisation d'un moulage permet de dupliquer cet objet. La vidéo présente les différentes étapes de la technique de moulage dit "en
-
DÉMONSTRATION SOUFFLAGE DE VERRE DE SILICE (QUARTZ) PAR PASCAL MAZABRAUD, SOUFFLEUR DE VERRE AU CHA…
AssegondCélinePalezisAlexandreOutre le fait de saisir les gestes et l'enchainement des opérations techniques, le film permet d'appréhender la forte intensité lumineuse (lumière blanche aveuglante) provoquée par le taux de silice
-
TRAVAIL DE RÉALISATION D'UNE RAMPE À VIDE PAR PASCAL MAZABRAUD, SOUFFLEUR DE VERRE AU CHALUMEAU À L…
AssegondCélinePalezisAlexandreLe film est l'occasion de découvrir l'atelier qu'il occupe sur le campus universitaire Orléans-La Source, l'organisation de son poste de travail, le type de verre utilisé ainsi que les différents
-
TRAVAIL DE RÉALISATION EXPÉRIMENTAL PAR PIERRE GALLOU, SOUFFLEUR DE VERRE, À PARTIR D'UN MODÈLE DE …
AssegondCélinePalezisAlexandrePierre Gallou, souffleur de verre à la canne à la Verrerie d’Art d’Amboise-Chargé Patrick Lepage (37), expérimente la reproduction d’un modèle de vase actuellement conservé au Musée de Vierzon au sein
-
JEAN-CLAUDE HAJDUK ET ANDRÉ SCHMID, ANCIENS SOUFFLEURS DE VERRE AU CHALUMEAU, MEILLEURS OUVRIERS DE…
PellerinNadiaAssegondCélinePalezisAlexandreDans cette deuxième partie d’entretien, les deux collègues se souviennent du concours des meilleurs ouvriers de France qu’ils ont remporté dans les années 1960. Les deux anciens collègues abordent
-
JUNIEN LOUSTAUD, ANCIEN CUEILLEUR DE JAMBES ET DE PIEDS PUIS TAILLEUR SUR VERRE CHEZ THOUVENIN.
MichauNadineAprès avoir été employé comme garçon de ferme à l'âge de 11 ans, Junien Loustaud est recruté en 1945 à l'âge de 14 ans à la verrerie Thouvenin de Vierzon. Il y travaillera pendant 11 ans jusqu'à la
-
SUZANNE MARTINET, ANCIENNE COMPTABLE, ET ANDRÉ MOYON, ANCIEN MODELEUR, TOUS DEUX CHEZ RONDELEUX.
MichauNadineIls se souviennent des évolutions techniques et des innovations dans le secteur de la porcelaine puis reviennent sur leurs carrières respectives, le quotidien de travail dans les usines.