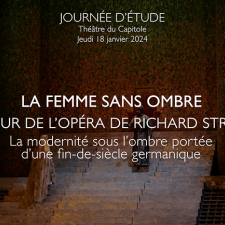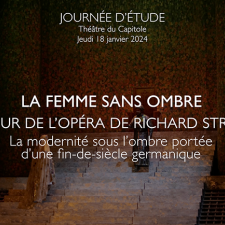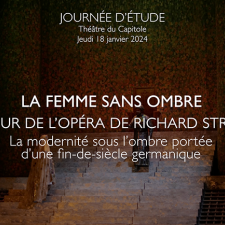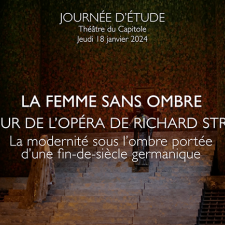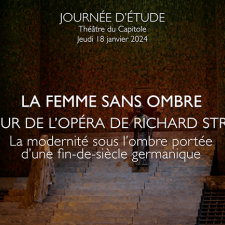La femme sans ombre de Strauss : la modernité sous l’ombre portée d’une fin-de-siècle germanique
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- document 1 document 2 document 3

Descriptif
Le catalogue des opéras de Richard Strauss couvre un large champ culturel et thématique, selon une progression partant de légendes médiévales à la mode wagnérienne (Guntram, 1894) pour s’inscrire durablement dans la mythologie grecque (Elektra, 1909 ; Ariane à Naxos, 1912 ; Hélène d’Égypte, 1928 ; Daphné, 1938, etc.). L’épisode biblique de Salomé (1905), bien que teinté de décadence dans le prolongement de la version d’Oscar Wilde, a servi de passeport pour monter dans un train peuplé d’héroïnes, égéries décalées d’un XXe siècle naissant frappé par la Grande Guerre. Au-delà de cette crise politique européenne, l’ensemble de ces opéras fait face à l’essoufflement du romantisme, à la naissance de la psychanalyse et à l’inextricable malaise à se situer entre modernité et avant-garde. Comme une respiration nécessaire, la lignée parallèle des comédies aristocratiques et bourgeoises (Le Chevalier à la rose, 1911 ; Intermezzo, 1924 ; Arabella, 1933, etc.) nous divertit quelque peu du poids marmoréen de cette Antiquité chargée de refonder la valeur civilisationnelle de l’espace germanique.
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des deux artistes en actualisant cette fois un héritage germanique porté par une filiation issue d’un Orient philosophique et merveilleux. Le glissement de l’Antiquité grecque vers l’Orient fantastique ne marque pas pour autant un changement dans les préoccupations existentielles de l’opéra allemand post-wagnérien. Quelle valeur édificatrice peut être accordée à un conte adapté à l’opéra en ce début du XXe siècle ? Strauss, compositeur d’opéras, est-il encore tenu de servir une musique romantique illustrative et émotionnelle, surtout après s’être essayé aux explorations philosophiques de son Ainsi parlait Zarathoustra (1896) et de sa Symphonie alpestre (1915) ?
L’institut IRPALL et l’Opéra national du Capitole de Toulouse ont réuni des spécialistes en littérature, philosophie et musicologie germaniques pour tenter de mettre en lumière le feu croisé des dynamiques culturelles qui traversent La Femme sans ombre : tradition, modernité, mythologie, romantisme décadent, héritages du monde de l’opéra…
Vidéos
La Femme sans ombre, le dernier opéra romantique ?
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
La Femme sans ombre et la modernité viennoise : effondrement du présent et rédemption de l’avenir
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
Le merveilleux chez Strauss et Schreker : approche comparative
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
Orchestre et orchestration dans "La Femme sans ombre"
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
Humain, trop humain : morphologie anthropologique des leitmotive straussiens
Si La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
Intervenants et intervenantes
Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'allemand. - Philosophe et germaniste, spécialiste de Nietzsche (en 2024)
Docteur ès lettres (Paris 4, 1996). - Chargé de cours à l'Université de Cergy-Pontoise (en 1998). - Professeur en études germaniques et directeur du département d'allemand, université de Rennes 2 (en 2024)
Maître de conférences en musicologie à l'université Toulouse II (en 2017). - Membre du laboratoire de recherche Il Laboratorio à l’Université Toulouse - Jean Jaurès (en 2023)
Docteur en musicologie, Université Strasbourg 2 (en 2003). - VP Sciences et société, Université de Strasbourg (en 2015). - Professeur en musicologie à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques et du Centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique (en 2023)
Agrégation d’Éducation musicale et de chant choral (en 1985). - Doctorat d’Histoire de la musique et Musicologie, Université de Paris Sorbonne (en 1992). - Maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris IV depuis 1994 (en 2001, en 2024). - Membre du Groupe de Recherche sur les Institutions Musicales, l’Orchestre, l’Instrumentation, le Répertoire orchestral en Europe -GRIMOIRE- de l'IREMUS (en 2024)