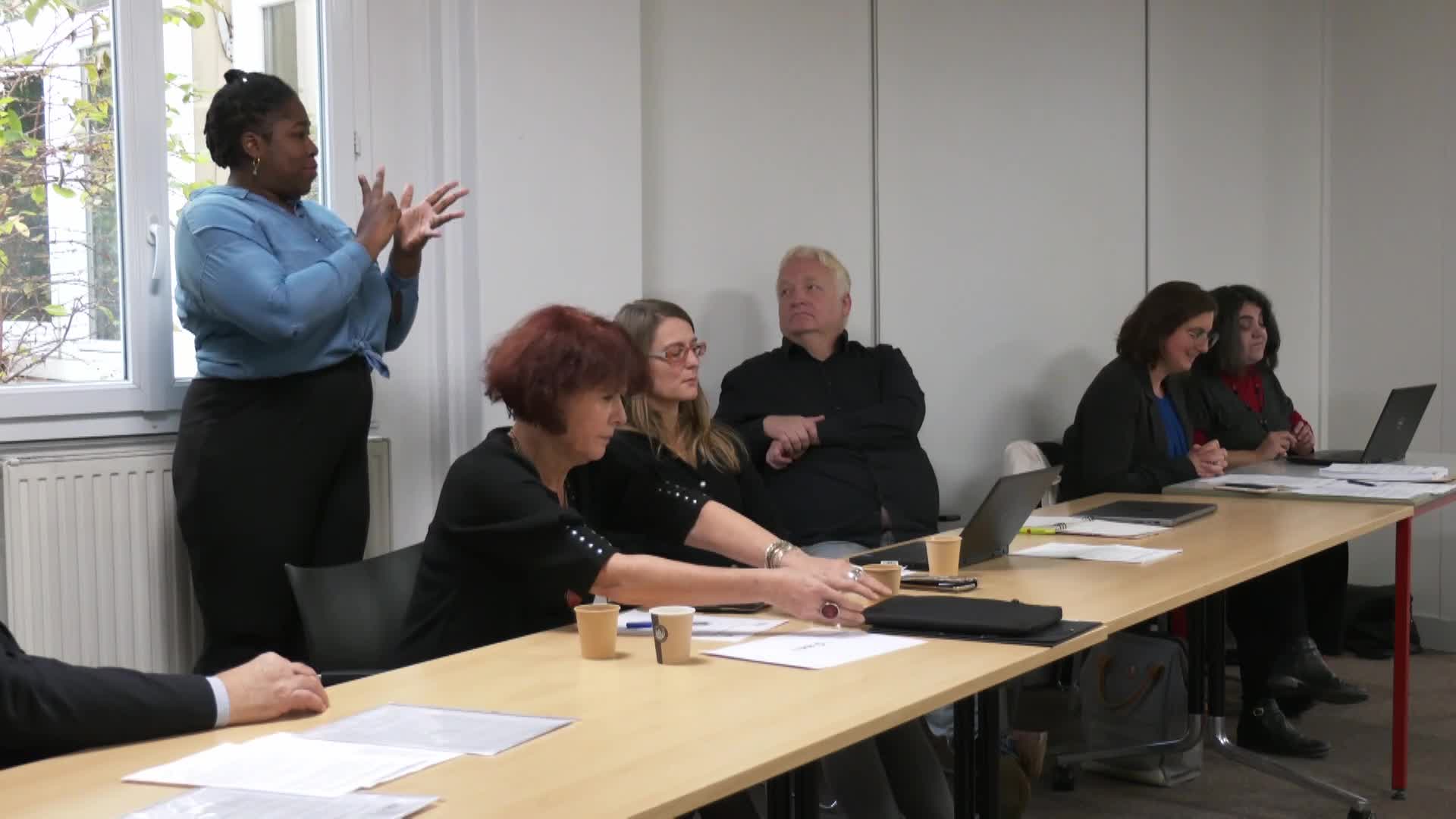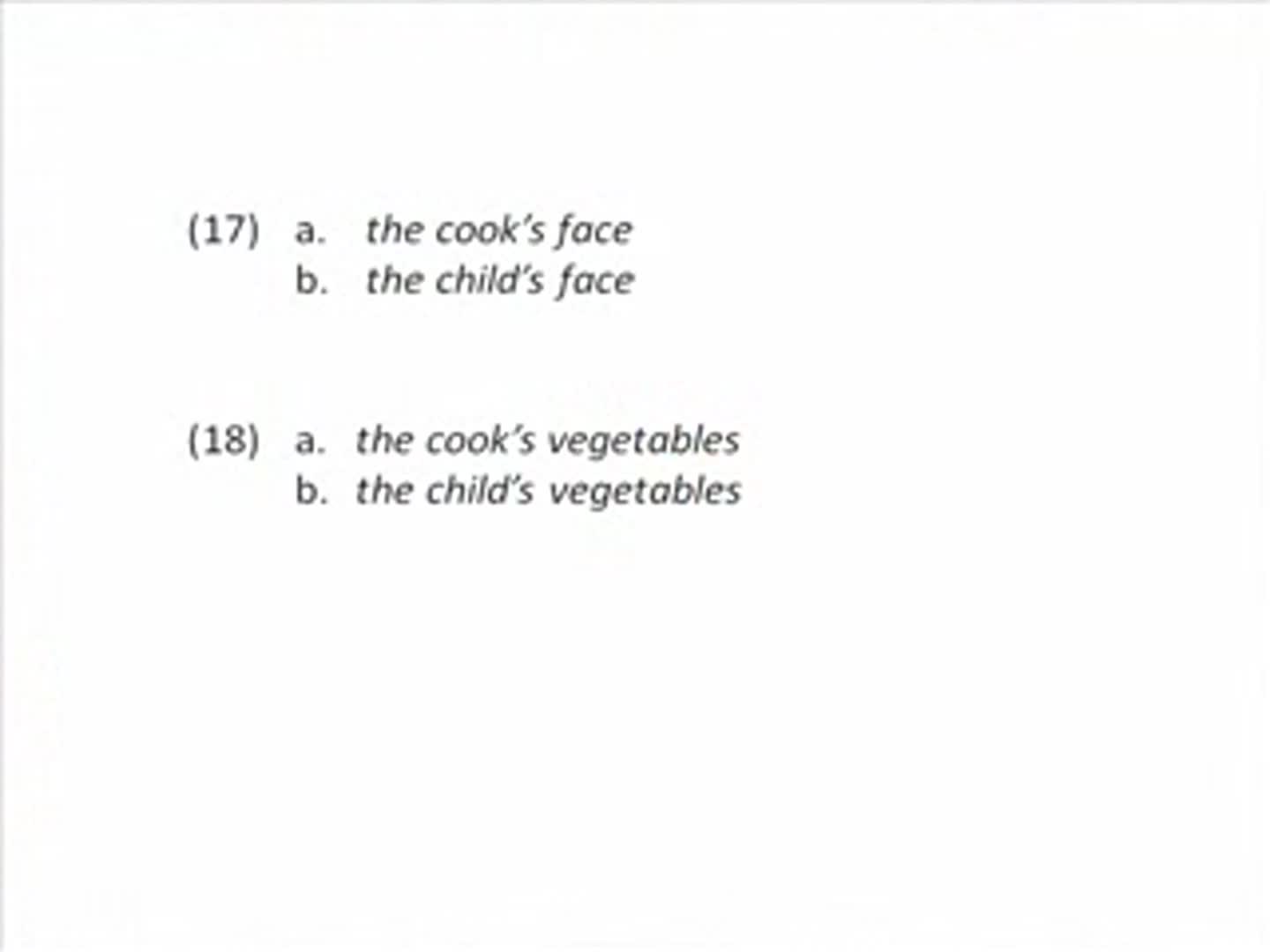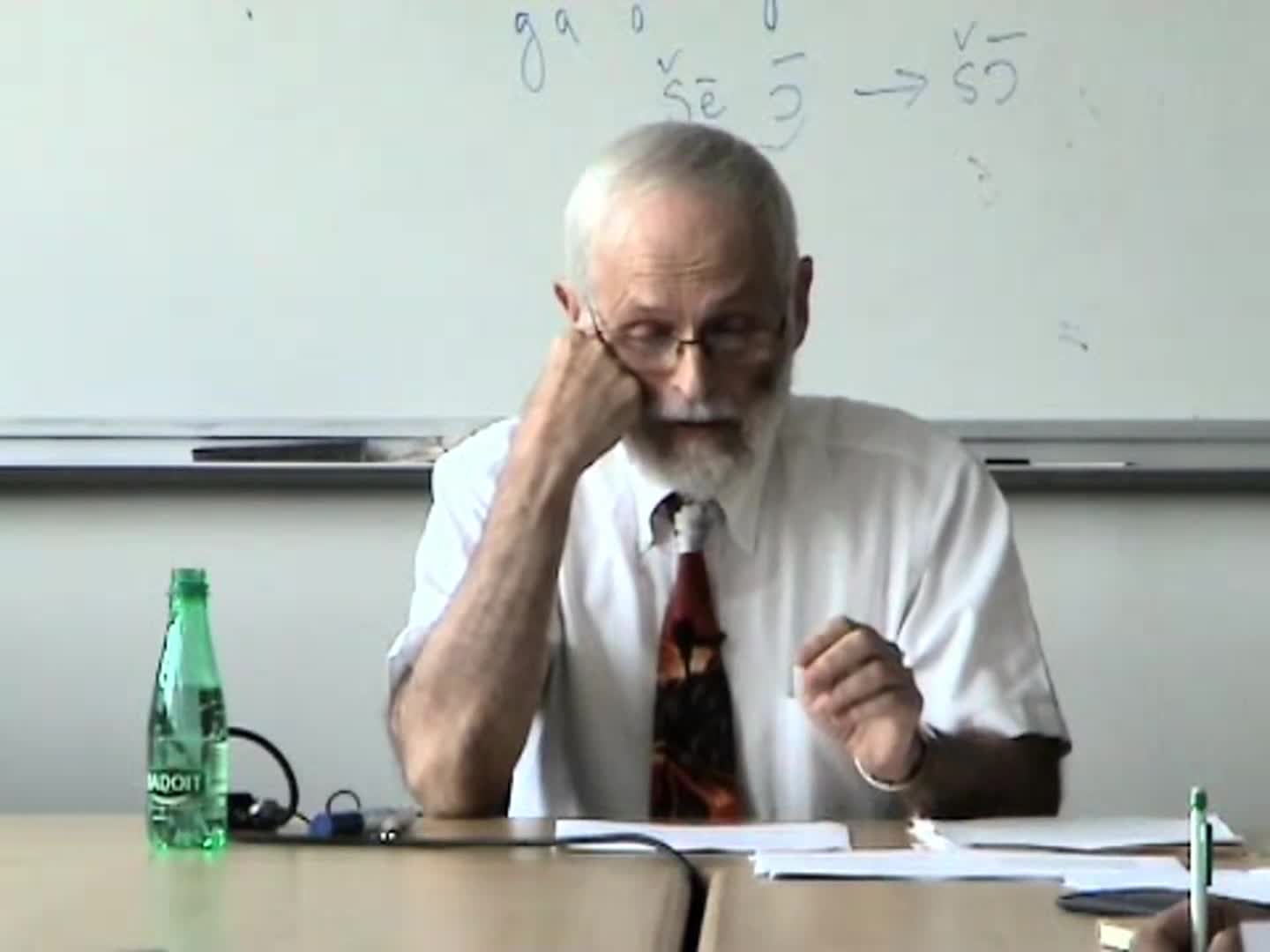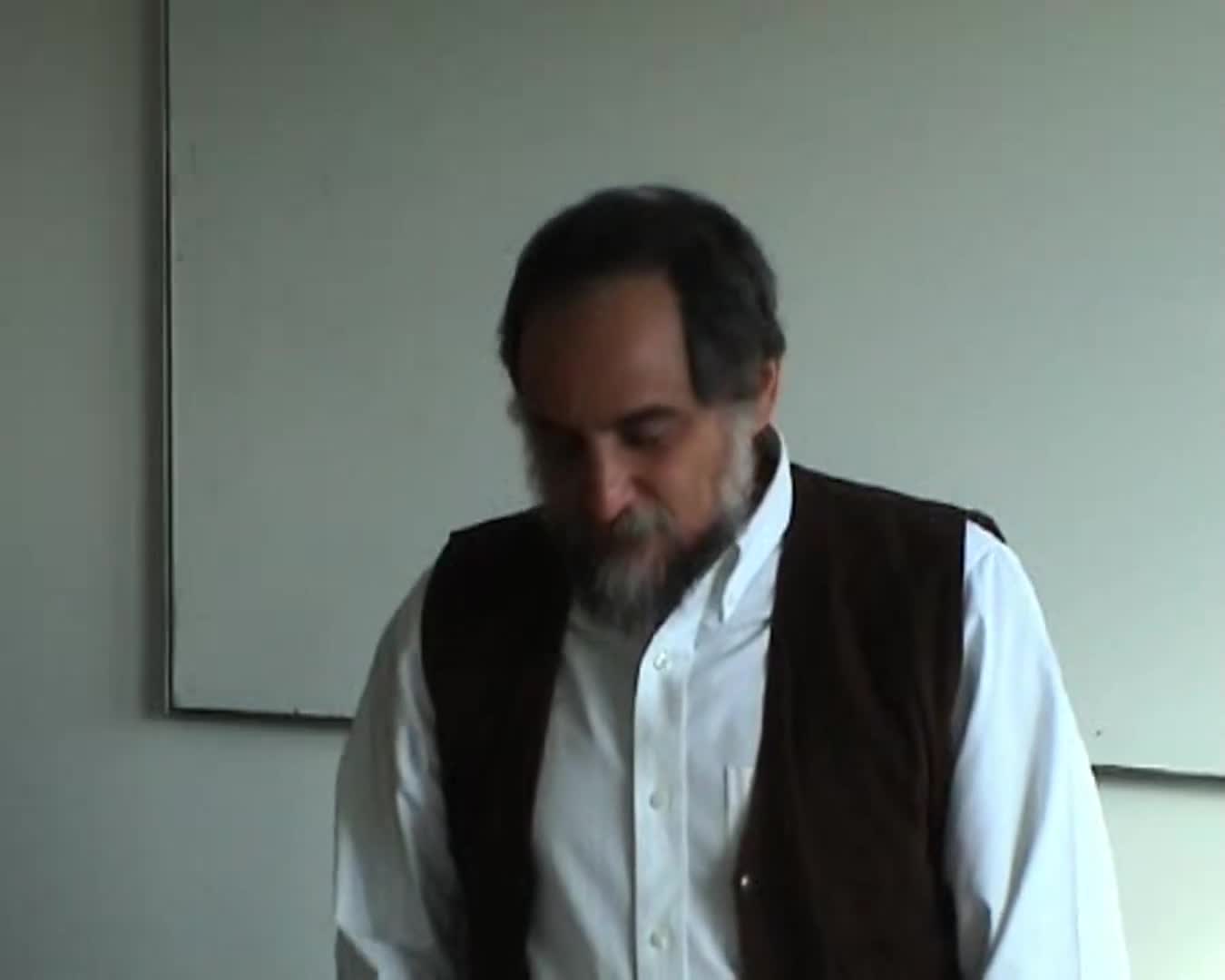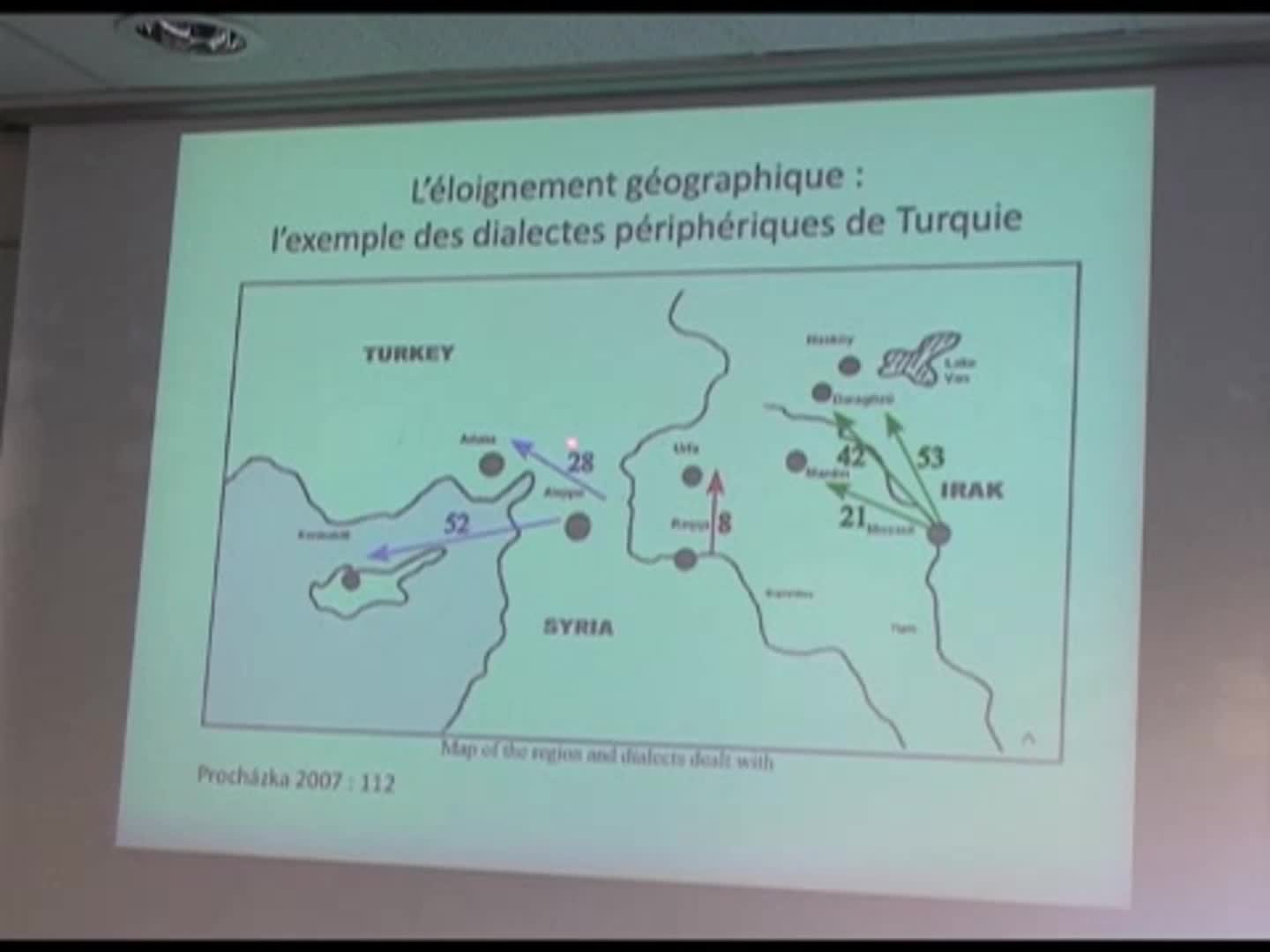Chapitres
- Parcours intellectuel03'46"
- Présentation des principaux domaines de recherche08'44"
- La notion "forme-sens"05'15"
- Stylistique et étude littéraire : Chrétien de Troyes07'51"
- La littérature arthurienne et le motif de la parole empêchée15'54"
- La rhétorique du silence07'26"
- Motifs d’origine celte02'57"
- La phénoménologie du silence06'05"
- Le genre roman05'36"
- Composition romanesque et oralité05'45"
Notice
L'oeuvre littéraire médiévale comme forme-sens
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Danièle JAMES-RAOUL est maître de conférences en ancien français à l'Université de la Sorbonne - Paris IV. Elle est habilitée à diriger des recherches. Elle a été amenée dans un premier temps à étudier comment un motif particulier élabore sa propre rhétorique. Les articles et travaux publiés ensuite l'ont portée progressivement et plus précisément à envisager le sens à partir de la forme adoptée. Elle emprunte à Henri Meschonic son concept de "forme-sens" et fait apparaître la modernité des textes narratifs et encyclopédiques des XIIe et XIIIe siècles face au poids de la tradition gréco-latine ou judéo-chrétienne.
Son ouvrage sur l’Approche du style de Chrétien de Troyes s’inscrit dans une perspective stylistique historique, qui prend appui méthodologiquement sur une étude préalable de ce qui peut constituer le socle rhétorique de l’écriture narrative à la fin du XIIe siècle.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Bibliographie,Curriculum Vitae
I. OUVRAGES PUBLIES ET DIRIGES
1. La parole empêchée dans la littérature arthurienne, Paris, Champion, « Bibliothèque du Moyen Âge », 1997, 476 p.
2. La montagne au Moyen Âge, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000, 348 p.
Cet ouvrage a obtenu la « Mention du jury » dans la catégorie « Grand prix du Livre de Montagne » au 3e grand prix du Livre de Montagne et de Randonnée de Font-Romeu, en juillet 2001.
3. Dans l'eau, sous l'eau, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, 429 p.
4. Merlin l'Enchanteur, introduction, choix de textes, traduction, notes, Paris, L.G.F., « Les classiques d'aujourd'hui », 2001, 128 p.
5. Approche du style de Chrétien de Troyes, 2002, 840 p. Édition en cours d'une version abrégée (de 650-700 pages), à paraître chez Honoré Champion dans la « Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge » dirigée par Jean Dufournet.
6. Forme-sens: du legs de la tradition à la modernité créatrice (XIIe-XIIIe siècles), mémoire de synthèse réalisé en vue de l'Habilitation à Diriger des Recherches, 2002, 123 p.
7. En quête d'utopies, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005, 409 p.
8. Par les mots et les textes, Mélanges de langue, de littérature et d'histoire des sciences médiévales offerts à Claude Thomasset, Études réunies par Danielle Jacquart, Danièle James-Raoul et Olivier Soutet, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2005, 896 p.
À paraître
9. Les ponts dans la littérature et la pensée médiévales, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005.
10. De l'écrin au cercueil, Essai sur les contenants, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
11. La pierre dans le dans le monde médiéval, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
II. NOTE DE SYNTHESE DACTYLOGRAPHIEE
12. Forme-sens: du legs de la tradition à la modernité créatrice (XIIe-XIIIe siècles), mémoire de synthèse réalisé en vue de l'Habilitation à Diriger des Recherches, 2002, 123 p.
III. ARTICLES
1. « La parole empêchée dans la littérature arthurienne », Perspectives médiévales, 21, juin 1995, p. 38-41.
2. « Un curieux avatar de l'Estoire Merlin : le Roman de Silence », Traduction, transposition, adaptation au Moyen-Âge, Bien dire et bien aprandre, n° 13, 1996, p. 145-157.
3. « La femme maléfique dans la littérature romanesque de la fin du Moyen Âge », dans Le mal et le diable. Leurs figures à la fin du Moyen Åge, dir. Nathalie Nabert, Paris, Beauchesne, 1996, p. 11-33.
4. « Le chevalier démuni ou la non-déclaration amoureuse », La déclaration amoureuse, Bien dire et bien aprandre, n° 15, 1997, p. 131-144.
5. « Étude grammaticale d'un texte français antérieur à 1500 », dans Le CAPES de Lettres Modernes, dir. Laurent Fourcaut, Paris, Vuibert, 1998, p. 75-103 ; 2e édition, 1999, p. 73-101 ; 3e édition, 2003 ; 4 e édition à paraître en 2005.
6. « D'une météorologie l'autre : le temps qu'il fait du Conte du Graal de Chrétien de Troyes au Parzival de Wolfram von Eschenbach », dans Le temps qu'il fait au Moyen Âge, Études réunies par Joëlle Ducos et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1998, p. 209-230.
7. « La rhétorique du silence dans le Conte du Graal », dans Faits de langue et sens des textes, dir. Franck Neveu, Paris, SEDES, 1998, p. 9-32.
8. « La parole empêchée dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes », Op. Cit., n° 11, 1998, p. 15-27.
9. « Les discours des mères. Aperçus dans les romans des XIIe et XIIIe siècles », La mère au Moyen Âge, Bien dire et bien aprandre, n° 16, 1998, p. 145-157.
10. « L'impossible déclaration féminine : hardiesses, subtilités ou désarroi de la dame », dans La dichirazione d'amore, La déclaration d'amour, dir. Nicole Gelas et Catherine Kerbrat-Orecchioni, Genova (Italie), Erga ed., 1998, p. 320-339.
11. « Rhétorique de l'entrelacement et art de régir la fin : le cas du Tristan en prose (ms. Vienne 2542) », Clore le récit : recherche sur les dénouements romanesques, PRIS-MA, t. XVI, n° 29, 1999, p. 85-111.
12. « Monts et merveilles romanesques », dans La montagne au Moyen Âge, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 255-283.
13. « Le rire des femmes dans le monde arthurien », Études médiévales, 2, dir. Danielle Buschinger, 2000, p. 72-84.
14. « La mer Méditerranée dans les récits de pèlerinages et les récits de croisades», dans La Méditerranée médiévale : Perceptions et représentations, dir. Hatem Akkari, Paris-Sfax (Tunisie), Maisonneuve et Larose - ALIF - Les Éditions de la Méditerranée, 2002, p. 51-79.
15. « Inventaire et écriture du monde aquatique dans les bestiaires », dans Dans l'eau, sous l'eau, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 175-226.
16. « Conclusion », dans Dans l'eau, sous l'eau, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 413-416.
17. « La description en question », Médiévales, 24, dir. Danielle Buschinger, 2002, p. 52-63.
18. « En guise de préface. « À la fenêtre » : approche d'un topos textuel dans les romans entre 1150 et 1250 », Par la fenestre, Senefiance, Études réunies par Chantal Connochie-Bourgne, 2003, p. 9-22.
19. « La poétique de la célébration dans la Chanson de Roland (v. 661-2608) : éléments de style », dans Styles, Genres, Auteurs, 3. La Chanson de Roland, Aubigné, Racine, Rousseau, Balzac, Jaccottet, Textes réunis par Catherine Fromilhague et Anne-Marie Garagnon, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003, p. 13-28.
20. « Forme-sens : du legs de la tradition à la modernité créatrice (XIIe-XIIIe siècles) », Perspectives médiévales, 29, 2004, p. 140-146.
21. « Les Amazones au Moyen Âge, autres façons de penser la femme », dans En quête d'utopies, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2004, p. 195-230.
22. « Conclusion », dans En quête d'utopies, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2004, p. 395-399.
23. « La poétique du flou dans la Queste del Saint Graal (147, 1-210, 28) : éléments de style », dans Styles, genres, auteurs, 4, Textes réunis par Gérard Berthomieu et Françoise Rullier-Theuret, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2004, p. 11-30.
24. « Le Graal ou la grande illusion », Méthode, n° 7, 2004, p. 33-40.
25. « Défense et illustration de la langue française : la néologie dans les arts poétiques (XIIe-XIIIe siècles) », dans Par les mots et les textes, Mélanges de langue, de littérature et d'histoire des sciences médiévales offerts à Claude Thomasset, Études réunies par Danielle Jacquart, Danièle James-Raoul et Olivier Soutet, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2005, p. 451-463.
26. « L'attention au paysage dans l'ouvre de Chrétien de Troyes », dans Le génie du lieu, Des paysages en littératures, Textes réunis par Arlette Bouloumier et Isabelle Trivisani-Moreau, Paris, Imago, p. 17-29.
27. « La digression dans les arts poétiques des XIIe et XIIIe siècles. Aperçu théorique », dans La digression dans la littérature et l'art du Moyen Âge, Senefiance, 51, Études réunies par Chantal Connochie-Bourgne, 2005, p. 229-243.
28. « Polysémie, homonymie et polyphonie. Application à l'étude des rimes chez Chrétien de Troyes », dans La polysémie, dir. Olivier Soutet, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005, p. 401-414. À paraître
29. « Le pont dans les locutions : aperçu sur les langues européennes », dans Les ponts dans la littérature et la pensée médiévales, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005, p. 287-315.
30. « Conclusion », dans Les ponts dans la littérature et la pensée médiévales, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2005, p. 317-320.
31. « Les arts poétiques des XIIe et XIIIe siècles face à la rhétorique cicéronienne : originalités et nouveautés » dans La transmission des savoirs du XIIe au XIVe siècle : modalités, images et lieux, Textes réunis par Pierre Nobel, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.
32. « L'écriture des lapidaires français du Moyen Âge », dans La pierre au Moyen Âge, Études réunies par Danièle James-Raoul et Claude Thomasset, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
33. « La littérature dans le prisme de la civilisation », Ulysse, I. S. L. G., Université de Gabès (Tunisie). 34. « La rhétorique entre vérité et mensonge : les leçons des arts poétiques des XIIe et XIIIe siècles », dans Le vrai et le faux dans la littérature médiévale, Bien dire et bien aprandre, Études réunies par Élisabeth Gaucher.
35. « La stylistique médiévale », dans 30 ans d'études médiévales, Volume jubilaire de la Société de Langue et de Littérature Médiévales d'Oc et d'Oïl, Études réunies par Dominique Boutet et Jean-René Valette, Paris, Champion.
36. « L'écriture des commentaires dans les romans de Chrétien de Troyes », dans Gloses et commentaires dans la littérature médiévale, Études réunies par Daniel Lacroix et Florence Bouchet, Université de Toulouse-Le Mirail.
37. « Écrire la tempête, dire la mer », dans Mondes marins au Moyen Âge, Senefiance, Études réunies par Chantal Connochie-Bourgne. IV. ARTICLES DE DICTIONNAIRES
38. Trente et une notices sur la langue et le style d'auteurs ou d'ouvrages du Moyen Âge et de la Renaissance pour le Robert des grands écrivains de langue française, publié sous la direction de Philippe Hamon et Denis Roger-Vasselin, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2002 (première édition abrégée en 2000) : Aucassin et Nicolette, Béroul, La Chanson de Roland, Charles d'Orléans, Chrétien de Troyes, Philippe de Commynes, Fabliaux, Guillaume de Lorris, Jean Froissart, Jean de Meun, Jean de Joinville, Lancelot en prose, Marie de France, La Mort le Roi Artu, René d'Anjou, Le Roman d'Alexandre, Le Roman d'Enéas, Le Roman de Renart, Rutebeuf, Thomas, La Vie de Saint Alexis, Geoffroy de Villehardouin, François Villon, Wace ; Joachim du Bellay, Jean Calvin, Louise Labé, Clément Marot, Marguerite de Navarre, Pierre de Ronsard et La Rochefoucauld.
, Titres et diplômes
30 novembre 2002 : Forme-sens : du legs de la tradition à la modernité créatrice (XIIe-XIIIe siècles).
Habilitation à diriger des recherches soutenue devant un jury composé de Mmes et MM. les Professeurs Chantal Connochie-Bourgne (Aix-Marseille I), Francine Mora (Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Dominique Boutet (Paris X), Jean-Marie Fritz (Dijon), Olivier Soutet (Paris IV, Président), Claude Thomasset (Paris IV, Directeur).
17 octobre 1992 : La parole empêchée dans la littérature arthurienne.
Thèse de Doctorat de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) soutenue le 17 octobre devant un jury composé de MM. les Professeurs Claude Thomasset (Paris IV, Directeur), Michel Rousse (Rennes II, Président), Jean Jolivet (ÉPHÉ), Claude Gaignebet (Nice). Mention très honorable décernée à l'unanimité du jury.
1986 : La parole empêchée dans le Lancelot en prose.
D.E.A. à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction de M. le Professeur Claude Thomasset. Mention très bien.
1984 : Agrégation de Lettres Modernes.
1981 : Étude littéraire du Roman de Silence de Heldris de Cornouaille (mention très bien).
Maîtrise d'enseignement en Littérature médiévale à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction de M. Charles Méla.
C.A.P.E.S. théorique de Lettres Modernes.
1976 : Baccalauréat série C. Mention assez bien.
Activités d'enseignement
. 1981-1993 : Professeur de français dans le secondaire à Vesoul-70 (Lycée Belin), Belfort-90 (Collège Vauban), Grandpré-08 (Collège de Grandpré), Boussy-Saint-Antoine-91 (Collège A. Dunoyer de Segonzac).
. 1993-1996 : Maître de conférences en Langue et Littérature médiévales à l'Université Charles de Gaulle-Lille III.
. Depuis 1996 : Maître de conférences en Ancien Français à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).
Dans le cadre de cours magistraux ou de travaux dirigés, j'ai enseigné la littérature médiévale du DEUG II à la maîtrise et la langue médiévale à tous les niveaux universitaires.Lors de missions universitaires, j'ai été chargée de l'enseignement de la littérature et de la langue médiévales en deuxième et troisième années universitaires, à l'Institut Français d'Athènes (Grèce) en novembre 1999, à l'Institut Supérieur des Langues de Gabès (Tunisie) en décembre 2002-avril 2003, en décembre 2003-avril 2004, en décembre 2004-avril 2005.
J'ai aussi assuré des TD d'Histoire de la Langue en DEUG I et en Licence, un CM-TD sur l'approche du Vocabulaire français (« Vocabulaire, société et civilisation ») ou des TD de Grammaire et Stylistique française en préparation au CAPES de Lettres Modernes.
Depuis 1999, j'assure une formation sur les techniques et outils informatiques pour les étudiants de maîtrise et de DEA et, depuis la rentrée 2001, un cours de maîtrise FLE sur « Lexique du français et traitement informatique », qui a pour objet le maniement des bases de données Frantext et TLFI (Trésor de la Langue Française informatisé). À plusieurs reprises, j'ai proposé à des collègues universitaires français et étrangers des démonstrations sur le maniement de ces outils linguistiques.
Participation régulière aux jurys de concours (épreuves écrites d'ancien français ; épreuves orales d'explication de textes improvisée ; épreuves orales de leçons ; rédaction partielle ou totale de plusieurs rapports sur l'épreuve d'Ancien Français) :
- CAPES Externe de Lettres Modernes de 1994 à 1996 (Présidente de Commission) ;
- Agrégation Externe de Lettres Modernes de 1997 à 2000 ;
- CAPES Externe de Lettres Modernes en 2002 ;
- Agrégation Externe de Lettres Modernes depuis 2003.
Activités de recherche
Mon Doctorat et les conférences données dans son sillage m'ont amenée à étudier comment un motif particulier élabore sa propre rhétorique. Les articles ou travaux publiés ensuite, m'ont porté progressivement et plus précisément à envisager le sens à partir de la forme adoptée. Dans les formes-sens considérées, s'énonce et se constitue la modernité des textes narratifs et encyclopédiques des XIIe et XIIIe siècles face au poids de la tradition gréco-latine ou judéo-chrétienne. Mon ouvrage sur l'Approche du style de Chrétien de Troyes s'inscrit dans une perspective stylistique historique, qui prend appui méthodologiquement sur une étude préalable de ce qui peut constituer le socle rhétorique de l'écriture narrative à la fin du XIIe siècle. Le présupposé qui fait de cet auteur le premier grand écrivain de langue française autant que la singularité du vaste corpus de ses ouvres justifient parfaitement de s'intéresser à lui dans l'optique de la stylistique médiévale.
Co-responsable pour le Moyen Âge, je fais partie du Comité de Pilotage du Dictionnaire des Femmes célèbres de l'Ancien Régime, sous la direction de Kathleen Wilson-Chevalier, entrepris par la S.I.E.F.A.R.
Sur le même thème
-
Quand la BD reveille l'Antiquité
LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.
-
Projet ORDI-GOAL - André Magord et Marlène Belly (Université de Poitiers)
Présentation du projet ORDI-GOAL – Oralité Dynamique : Grand Ouest français, Acadie, Louisiane, lauréat de l’appel à projets CollEx-Persée 2022.
-
Quels ouvrages écrivent les locuteurs du croissant ?
PisuRafaëlloÉtudier les parlers locaux ne se limite pas à analyser les langues en tant que système linguistique. La sociolinguistique a pour postulat de base qu'on ne peut s'intéresser à une langue sans prendre
-
Le croissant dans l’atlas sonore des langues régionales de France
Boula de MareüilPhilippeDepuis quelques années, dans le laboratoire LISN du CNRS, on développe un atlas sonore des langues régionales de France qui prend la forme d'un site web présentant une carte interactive de France,
-
Soutenance de thèse : Robert GAVRILESCU
GavrilescuRobertGarciaBrigitteSallandreMarie-AnneNystVictoriaRathmannChristianBogdanGeluSoareElenaSoutenance de thèse : Robert GAVRILESCU Description linguistique de la Langue des Signes Roumaine. Analyse de la variation linguistique et sociolinguistique dans deux régions roumaines
-
Des langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien
EtxepareRicardoDes langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien
-
Conférence du professeur Frank Lichtenberk | Apparition et disparition des classificateurs possessi…
LichtenberkFrankConférence de Frank Lichtenberk (Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande) | Apparition et disparition des classificateurs possessifs en austronésien / The rise and demise of possessive classifiers in
-
conférence du Professeur James A. Matisoff | Les initiales laryngales primaires et secondaires en T…
MatisoffJames A.Conférence du Professeur James A. Matisoff (Université de Californie, Berkeley) | Les initiales laryngales primaires et secondaires en Tibéto-birman | 06 mai 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à
-
conférence du Professeur Brian Joseph | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics
JosephBrian D.Conférence du Professeur Brian Joseph (Ohio State University) | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics | 02 octobre 2008 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)
-
ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | Ta…
NicolaïRobertJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)
-
ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | De …
Taine-CheikhCatherineJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)
-
ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | Aux…
ToscoMauroJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)