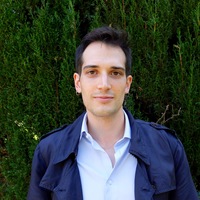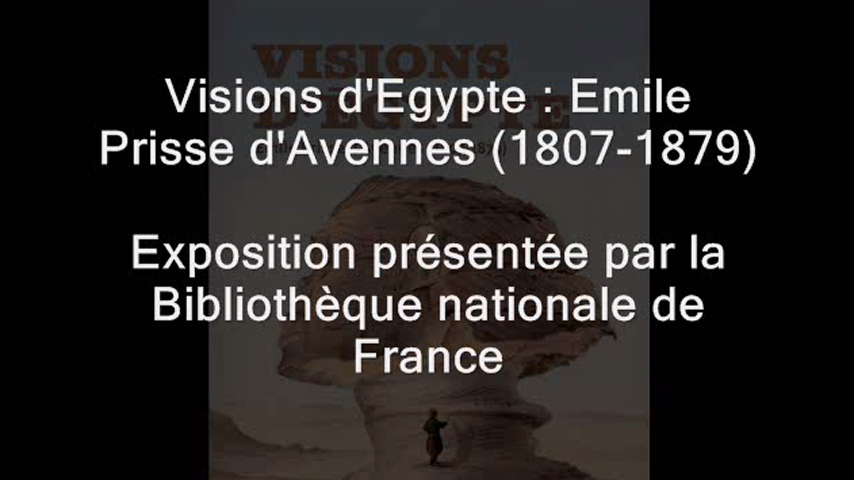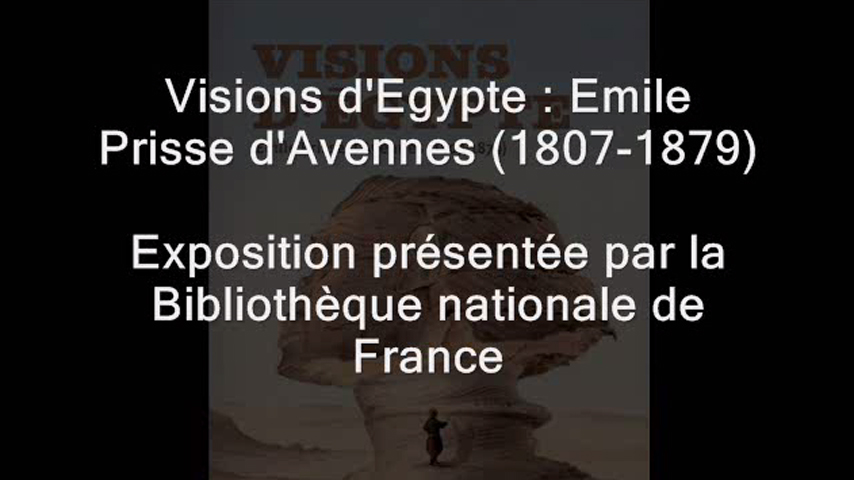Notice
Auditorium du Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Le voyage, un pré-texte. Écrire et photographier les métamorphoses du monde
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- Dossier
Descriptif
Le photographe Laurent Villeret et l’écrivain-voyageur Julien Blanc-Gras qui inaugurent cette nouvelle série d'échanges s'attacheront à nous faire partager leur tropisme pour le voyage.
Pour l'un comme pour l'autre, voyager rime avec découvrir de nouvelles manières de regarder l’homme habiter le monde. Les travaux de ces deux artistes s’articulent autour de leurs nombreux périples. Bien que distinctes, ces deux approches mettent chacune en lumière des regards singuliers sur le monde et ses changements, et sur les hommes qui les vivent.
Laurent Villeret réalisait des photographies aériennes pour une société de cartographie, avant de décider, en 1999, « d'aller voir l’ailleurs ». Son projet Les Héliotropes est né en 2002, lors d’un voyage en Inde. Il concrétise alors son idée de réaliser un carnet de voyage in situ pour ne pas avoir des centaines de photos à développer de retour chez lui. Inspiré par les lieux, il choisit de se servir de l’héliographie, une technique inventée par Nicéphore Niepce, consistant à reproduire sur gravure une image photographiée. Laurent Villeret s'est servi lui d’un Polaroïd* qu'il a, avant son développement, appliqué sur du papier-aquarelle préalablement mouillé. Le rendu est saisissant. Le papier-aquarelle confère à la photo, une texture et un grain très particuliers, une esthétique propre. L'effet escompté par l'artiste donne toute sa mesure : l'univers visuel, bien que figuratif, perd ses repères temporels. Pour Laurent Villeret, l'idée de « brouiller les pistes » était une des composantes initiales de ce projet qui vise à s'intéresser à l’habitat humain au sein de son espace naturel. Cet univers photographique transfiguré par l'imaginaire, Laurent Villeret l'a nommé « Onirie » car « l’ailleurs et l’imaginaire constituent [pour lui] la réponse à la soif d'inconnu qui nous guide » . Une démarche singulière déclinée à chaque étape de ce voyage qui l'a conduit de la Mauritanie à la Russie en passant par Zanzibar et la Chine.
* Art Polaroid
Selon les termes de son éditeur, Julien Blanc-Gras est « écrivain par vocation ». Le voyage constitue l'autre partie intégrante de sa démarche. Cet écrivain-voyageur, en doux rêveur devant les cartes et les atlas, a nourri le projet, en forme de pari (cf son entretien sur France Inter), de quadriller méthodiquement la carte du monde, en la sillonnant, pour ensuite coucher sur le papier ses rencontres et ses impressions de voyage. Ce globe-trotter infatigable a déjà foulé le sol d'une soixantaine des 197 pays que compte notre planète. Son livre Touriste participait déjà de cette audacieuse démarche qu'il qualifie lui-même de « saugrenue ». La simple lecture d’une dépêche de l’Associated Press avait suffi pour qu'il se décide à partir à l'autre bout du monde, aux Îles Kiribati*. La hausse du niveau de la mer annoncée, conséquence du réchauffement climatique, entraînerait à terme l'engloutissement de ces archipels. Pour faire face à ces prévisions mortifères, le gouvernement des Kiribati a décidé d'acquérir 2 400 hectares aux îles Fidji pour y délocaliser la totalité de sa population qui compte 110 000 âmes. Cette disparition annoncée est le « pré-texte » du départ de Julien Blanc-Gras pour la Micronésie, en solitaire pour mieux aller à la rencontre des autres. L'écrivain en reviendra avec une galerie de portraits comme celui (évoqué sur France-Culture) d'un personnage étonnant à la fois ancien professeur, constructeur bénévole de digues, et conducteur du seul taxi de l’île. En parfait émule de Nicolas Bouvier, Julien Blanc-Gras pense que chaque sujet dicte sa forme littéraire. Et marchant dans les pas de l'éminent journaliste et écrivain-voyageur Ryszard Kapuściński, il travaille lui aussi le fragment pour mieux saisir la diversité des situations.
* Les îles Kiribati, composées de 32 îlots, se trouveraient au centre du monde, étant à cheval sur l'équateur et sur l'antiméridien 180 °, à la fois en Polynésie et en Micronésie, au sud des îles Marshall et de Hawaï et au nord des Tuvalu, des Samoa, des îles Cook et de la Polynésie française (source Wikipédia).
Intervention / Responsable scientifique
Sur le même thème
-
Giovanni Botero et la question de la circulation dans l’Empire ibérique
Dans ses œuvres politiques et géographiques, Botero attribue un rôle de premier plan aux diverses formes de mobilités et de circulations maritimes qui assurent l’union des diverses parties de l’Empire
-
Constitution et circulation d’un savoir stratégique au XVIe siècle : le cas des antiquités péruvien…
À l’instar des nouvelles sur le déroulement de la conquête et la richesse du territoire, les premières informations sur le Pérou préhispanique, issues d’observations directes et d’interactions
-
Dynasties marchandes, migrations et familles entre Rouen et le monde ibérique
Rouen, la seconde ville du royaume de France, accueille dès le XVIe siècle de nombreux Ibériques formant une communauté d’une grande importance au siècle suivant. Se pose alors la question des modes d
-
"Villes Mondes" (France Culture). Portraits urbains polyphoniques et radiophonie littéraire
Entre 2013 et 2016, France Culture programme, le dimanche en deuxième partie d'après-midi, une émission permettant à ses auditeurs et à ses auditrices de découvrir de nombreuses villes de par le monde
-
Souvenirs d’un officier-mécanicien de la Marine marchande
François Renault est officier-mécanicien en retraite de la Marine marchande, auteur de l'ouvrage Bateaux de Normandie (Douarnenez, L'Estran, 1984). Il est également membre du Pôle maritime de la MRSH.
-
Prisse d’Avennes et l’art arabe (copie)
Mercedes Volait, spécialiste de l’histoire de l’architecture moderne (XIXe-XXe siècles) en Égypte, particulièrement au Caire est une des commissaires de l’exposition consacrée à Émile Prisse d’Avennes
-
Prisse d’Avennes et l’art arabe
Mercedes Volait, spécialiste de l’histoire de l’architecture moderne (XIXe-XXe siècles) en Égypte, particulièrement au Caire est une des commissaires de l’exposition consacrée à Émile Prisse d’Avennes
-
Le touriste - Jean Didier URBAIN
UrbainJean-DidierBien que tôt reconnu dans son ampleur sociale et économique, à travers ledit « phénomène » touristique et la précoce « industrie » du tourisme qu'il a suscités, le touriste a cependant été longtemps
-
La littérature géographique
LestringantFrankDepuis 1999, Frank LESTRINGANT est professeur de littérature française de la Renaissance à l’Université de Paris IV-Sorbonne ; directeur du centre Saulnier, centre de recherche sur la création