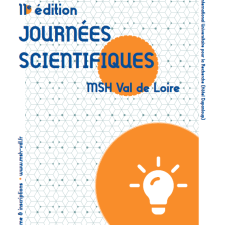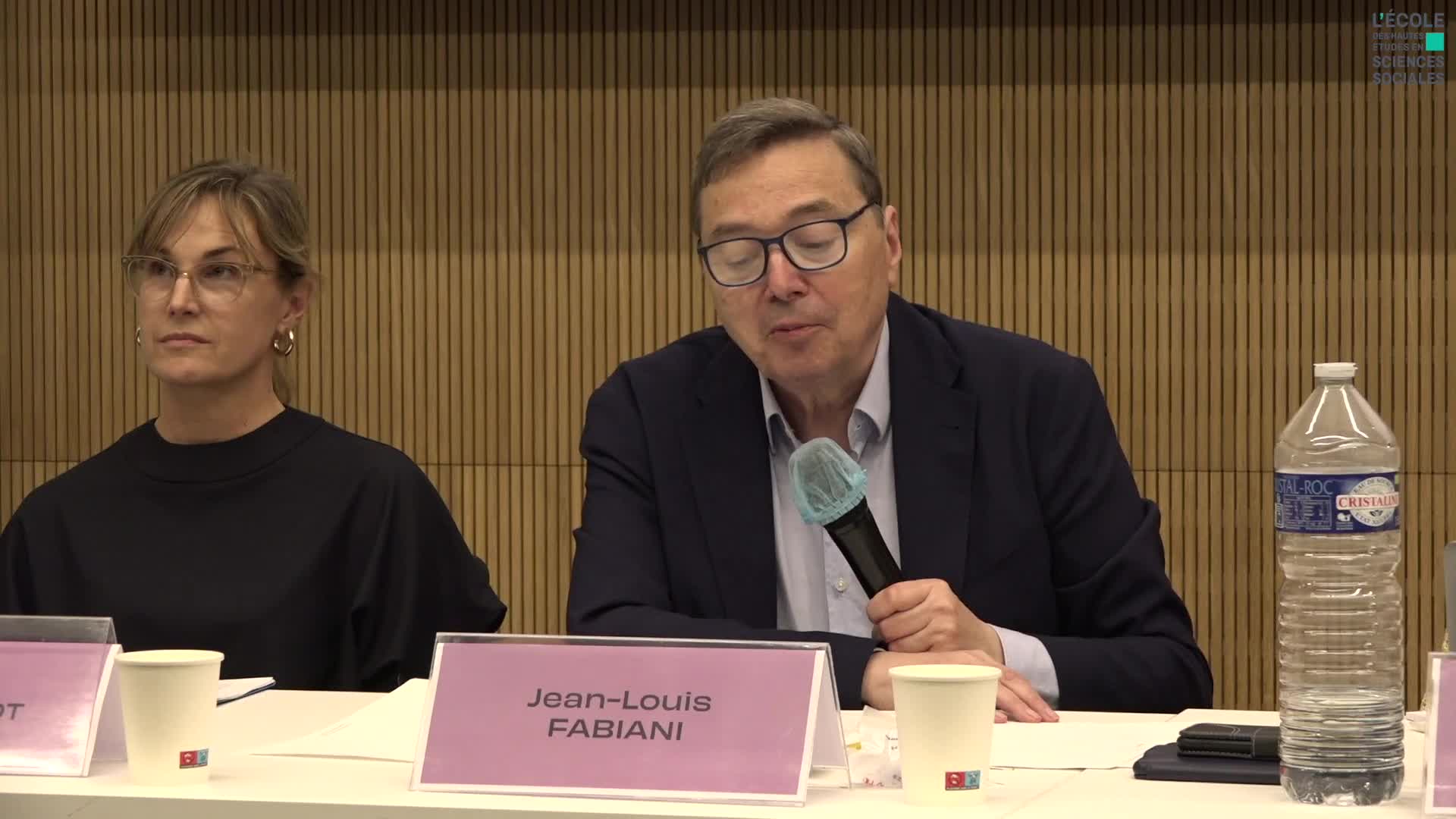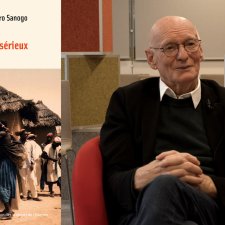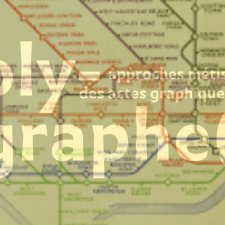Notice
Influences étrangères dans le cinéma britannique des années 30 et 40
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été filmée dans le cadre d'une journée d'étude du LASLAR consacrée au cinéma britannique. Cette journée s'inscrivait dans un programme d’études sur deux ans (2018/2020), organisé par l’Université de Paris 1, l’Université de Strasbourg et l’Université de Caen, avec 6 journées d’études et un colloque en juin 2020 à Cerisy La Salle.
Jean-FrançoisBaillon est professeur à l’Université Bordeaux Montaigne.Membre de l’AFECCAV (Association Française des Enseignants etChercheurs en Cinéma et Audiovisuel) et président d’honneur de laSERCIA (Société d’Etudes et de Recherches sur le CinémaAnglophone), il a publié des articles sur le cinéma britanniquedans la revue CinémAction, dans Positif et dans diversouvrages collectifs. Ses recherches portent principalement sur lesrapports entre identités (culturelles, ethniques, sexuelles) etformes cinématographiques, aussi bien dans le cinémasocial-réaliste (Ken Loach, Lindsay Anderson) que dans le cinémagothique et d’horreur (Thorold Dickinson, Terence Fisher, PeteWalker) ou le cinéma des diasporas (Mira Nair, Atom Egoyan). Il aété membre du jury du Festival International du Film d’Histoirede Pessac en 2017 (consacré au cinéma britannique) et prépareactuellement un Dictionnaire du cinéma britannique (avec N.T. Binh).
Résumé de la communication
La question duréalisme se pose au moment où le cinéma britannique « devientlui-même » après le vote du Quota Act de 1927 et l’arrivéedu parlant après 1929, contemporaine de l’émergence du mouvementdocumentaire. C’est aussi le moment où les grands studios(Gainsborough, créé en 1924 puis London Films, créé en 1933, laRank Organisation, née dans les années 1930) mettent en place unstar system à l’anglaise. Les années de guerre confortentle projet d’une identité britannique exprimée à travers lecinéma mobilisé dans l’effort patriotique. Mais les années 1930et 1940 sont aussi celles de l’arrivée dans l’industriecinématographique britannique d’un nombre important d’étrangersessentiels à tous les postes de production : producteurs(Alexander Korda), scénaristes (Lajos Biro, Emeric Pressburger),acteurs (Anton Walbrook, Conrad Veidt), décorateurs (Alfred Junge,Vincent Korda), directeurs de la photographie (Georges Périnal, OttoHeller), musiciens (MiklosRozsa, Allan Gray), parfois un peu tout àla fois ou en succession (Alberto Cavalcanti). Loin d’une visionsimplifiée d’une école britannique associée à la tradition duréalisme, la présente communication se propose de repérer unediversité de sensibilités liées à un ensemble de contributionsrelevant de traditions esthétiques divergentes qui s’éloignent duréalisme documentaire.
Thème
Sur le même thème
-
Les invasions biologiques : quelles perceptions par le public ?
ArbieuHugoUgo Arbieu, chercheur post-doctorant à l'université Paris Saclay, montre dans cette vidéo l'intérêt de la culturomique pour étudier la perception sociale des invasions biologiques.
-
Reconfigurations de l’aptitude à être affecté : de la réception à l’émancipation, Spinoza à l’épreu…
BaudeyMatthieuCe projet s’appuie sur une mission de terrain de quatre mois au Kazakhstan pendant laquelle il s’agit de mener des entretiens qualitatifs avec les membres de différents mouvements sociaux, culturels
-
JRSS 2022 - Session de clôture
Session de clôture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
JRSS 2022 - Session d'ouverture
Session d'ouverture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
Engagement dans les sciences sociales : contraintes et tensions dans le monde 2/2
VegSebastianКопосовНиколай ЕвгеньевичBehrValentinKarsentiBrunoJouanjanOlivierLadier-FouladiMarieLes sciences sociales, en tant que savoirs critiques et émancipateurs, sont exposées aux tensions politiques des contextes où elles se produisent.
-
Autorité et autonomie des sciences sociales : construire une communauté de pairs 4/1
KarsentiBrunoSabbaghDanielMarzoukiNadiaFabianiJean-LouisFriedlanderJudithTerziCédricOrléanAndréSi les connaissances produites par les sciences sociales peuvent jouir d’autorité dans l’opinion, c’est qu’elles se soumettent à des règles méthodologiques, à des modes d’administration de la preuve
-
Les sciences sociales dans la cité : demandes publiques, contraintes, expertises 2/1
DaucéFrançoiseBozarslanHamitPortilloJosé MaríaGousseffCatherineAktarO. CengizZevounouLionelLes sciences sociales sont dans un rapport intérieur à la cité qui justifie qu’on les interroge et qui fonde un certain nombre d’attentes légitimes à leur égard, que ce soit de la part des pouvoirs
-
Ouverture du colloque Sciences sociales en danger ? 1/1
ProchassonChristopheKarsentiBrunoThireauIsabelleOuverture du colloque Sciences Sociales en danger ? Pratiques et savoirs de l'émancipation, 22 et 23 septembre 2022 au Centre des colloques au Campus Condorcet, par Christophe Prochasson, président de
-
LES « DIT-ON » ET AUTRES RÉCITS PLUS SÉRIEUX - INTERVIEW DE JEAN-PAUL COLLEYN
ColleynJean-PaulInterview de Jean-Paul Colleyn dans le cadre de la sortie du livre, "Les « dit-on » et quelques autres récits plus sérieux" publié le 16 février 2023 dans la collection "54" des Éditions de la FMSH.
-
Anne Sedès et Nicolas Thély - À propos de #JournéeEcologieClimaRNMSH - Ouverture de la journée
ThélyNicolasSédèsAnneOuverture de la journée
-
La MSH de Clermont-Fd en 3'33
Découvrir la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand en 3 minutes et 33 secondes...
-
Revue POLYGRAPHES
La revue POLYGRAPHE(S), approches métissées des actes graphiques est souhaitée comme un nouvel espace d'échanges intellectuels autour d'un vaste sujet d'étude commun, un lieu de rencontres et de