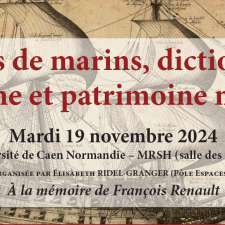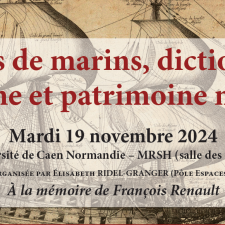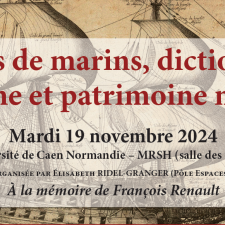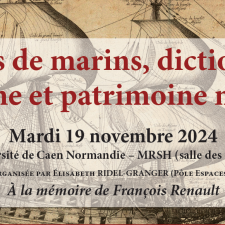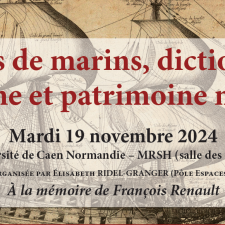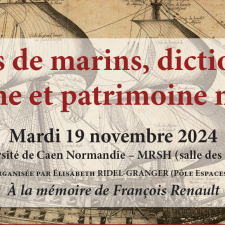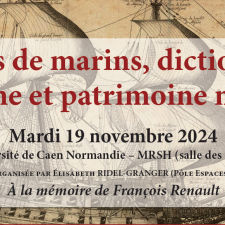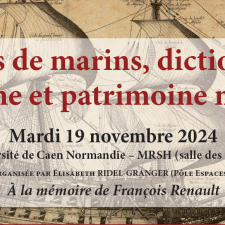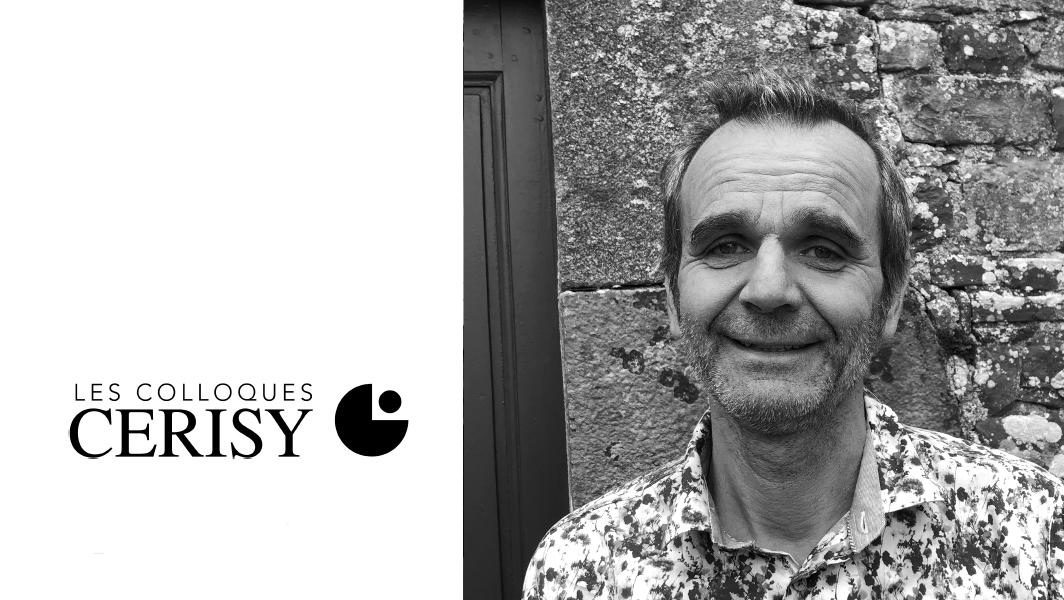Notice
MRSH Caen
La construction navale en Normandie
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été prononcée dans le cadre du séminaire annuel du pôle maritime de la MRSH, dont les thématiques 2011-2012 concernent le commerce et le vocabulaire maritimes.
Michel Daeffler est ingénieur d'études, cartographe au CNRS. En 2002, il soutient une thèse de doctorat à l'EHESS, intitulée Formes de carène et navires de combat : l'invention du vaisseau de ligne en Angleterre (1560-1642), thèse publiée en 2004. Après s'être intéressé à la marine de guerre, il explore aujourd'hui la marine de commerce, et plus particulièrement la construction navale du 16e au 18e siècle, domaine de recherche pour lequel les sources restent encore souvent à « inventer ».
Résumé de la communication
Les navires de commerce sous l'Ancien Régime restent très mal connus, contrairement à leurs homologues de la marine royale, les constructeurs des chantiers privés n'ayant écrit aucun traité de construction. Pour la période antérieure au règne de Louis XIV, les archives notariées sont les principales sources concernant la construction navale. Ainsi, le tabellionnage de Honfleur est particulièrement riche en documents concernant l'activité maritime de ce port depuis le XVIe siècle : contrats de construction, d'affrètement, tiercement, louage et vente de navire.
Trois catégories de documents constituent notre principale source concernant la construction navale : les marchés de construction, les contrats de radoub et de réparation, les contrats de vente de navire.
Les marchés de construction constituent la source principale. Ceux-ci fournissent de précieuses informations sur les dimensions, la charpente et parfois les aménagements intérieurs. Ces contrats sont également des documents commerciaux et nous informent sur le lieu de construction , le prix du navire, les délais de construction, les noms et domiciles des différentes parties ainsi que leurs engagements respectifs. Nous pouvons ainsi mieux connaître les différentes personnes impliquées ainsi que leur rôle dans le processus de construction.
Elément important, ces contrats indiquent le type de navire devant être construit : roberge ; bateau flambard ; bateau de pêche et de cabotage ; barque, utilisé essentiellement pour le cabotage ; heu ; navire de haute mer ; frégate.
La description des caractéristiques de chacun de ces types nous permet de tenter une typologie assez précise de cette petite marine de commerce. Les contrats de radoub nous fournissent des détails complémentaires sur les assemblages des pièces de charpente, le chevillage, les aménagements des gaillards et des ponts... Quant aux contrats de vente et de location de navire, ce sont les seuls documents, pour les XVIe et XVIIe siècles, à nous informer sur la mâture, la voilure et les équipements de bord.
Afin de connaître l'allure de ces différents bâtiments, d'autres sources sont sollicitées : les graffitis de navire. La comparaison entre les caractéristiques de leurs coques et grééments, avec les descriptions des contrats permet de préciser d'avantage l'aspect de leurs coques et mâtures. Différentes peintures de port ainsi que des ouvrages traitant de la pêche et du commerce de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, tel le « traité general des pesches » de Duhamel Dumonceau, sont également d'excellentes sources iconographiques.
A partir du règne de Louis XIV, les archives de l'amirauté d'Honfleur complètent les informations du tabellionnage. Le dépouillement des archives notariées et de l'Amirauté, associé à l'étude de diverses sources iconographiques devrait nous permettre de mieux comprendre cette marine et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, tant dans le domaine de l'histoire des techniques, que dans celui de l'histoire rurale pour la compréhension de la gestion des ressources forestières. D'autre part, l'intégration des chantiers de construction dans le tissu urbain ainsi que les choix d'implantation de ces chantiers pourraient être étudiés en liaison avec d'autres recherches menées sur les ports et la mise à jour de nouveaux sites prometteurs, d'un point de vue archéologique.
Sur le même thème
-
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
-
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.
-
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
-
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
-
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
-
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
-
Le lexique maritime dans les parlers normands.
Le lexique maritime dans les parlers normands.
-
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
-
Comment un territoire absorbe un grand parc éolien en mer ?
La mer constitue le dernier espace de la conquête énergétique. L'État planifie d'immenses parcs éoliens au large des côtes : il décide de leur taille et de leur localisation avant d'en confier la
-
L'atlas transmanche et le commerce maritime
Premier couloir de circulation maritime au monde, la mer de la Manche voit transiter quotidiennement au large de ses côtes plus de 400 bateaux. Cette porte d'entrée du monde en Europe est animée d'un
-
Techniques de pêche et conflictualité en France méditerranéenne (XVIIe-XIXe s.)
Dans une mer sans marée, au plateau continental réduit, avec des littoraux inégalement occupés, de configurations variées et jalonnés d’étangs productifs (Berre Thau, Lacanau), les pêcheurs de la
-
La défense du littoral en baie du Mont-Saint-Michel dans l'antiquité tardive
Les causes de la défense. A la fin du IVe siècle ap. J.C., des pirates connus sous l'appellation générique de « Saxons » viennent ravager les côtes du nord-ouest de l'empire romain. Ces pirates,