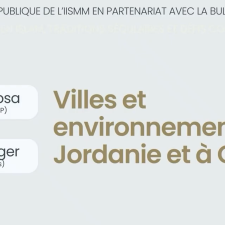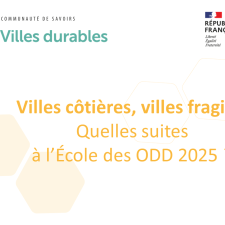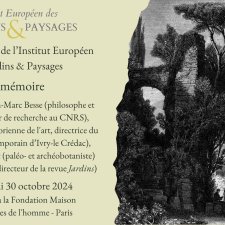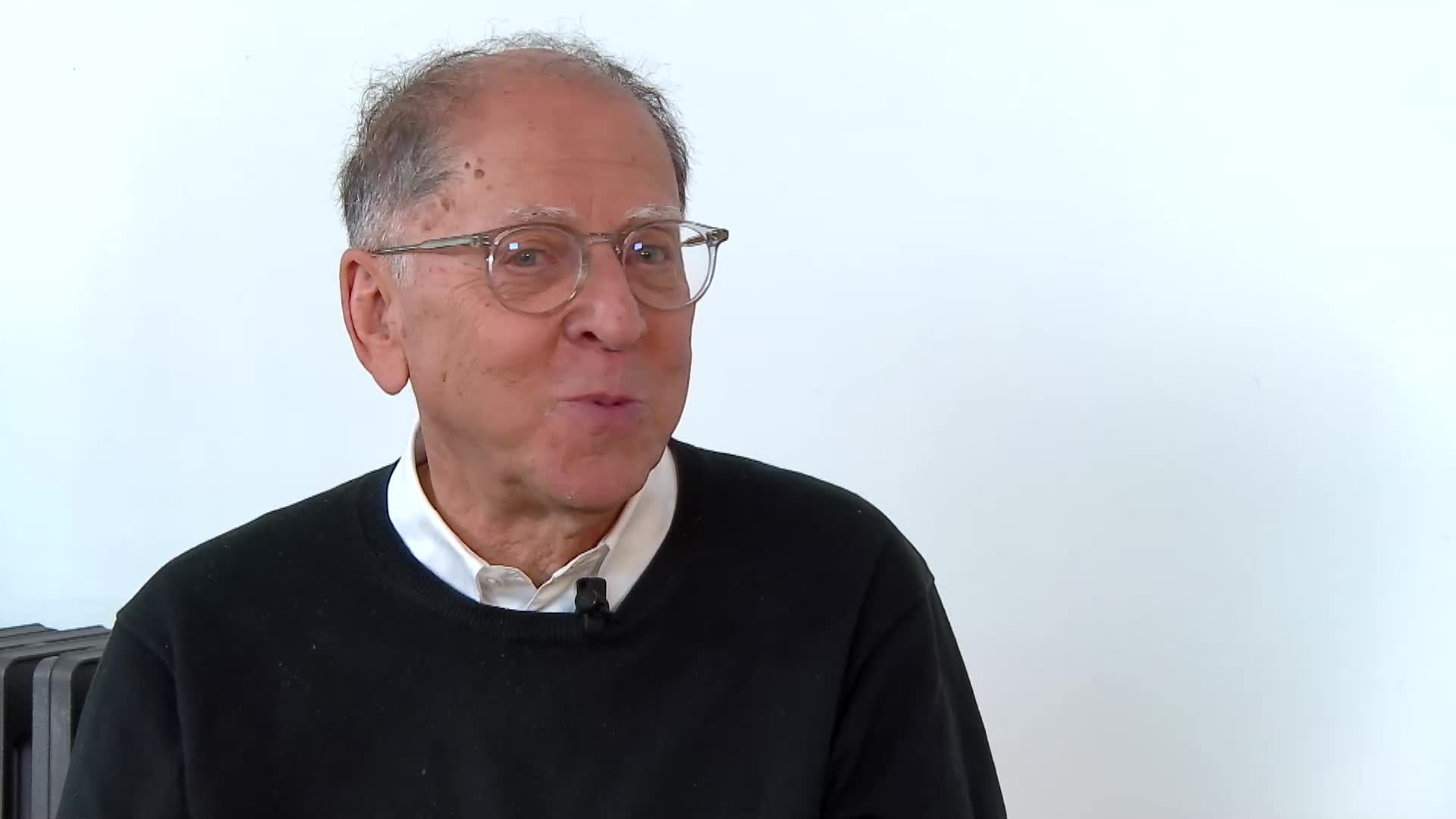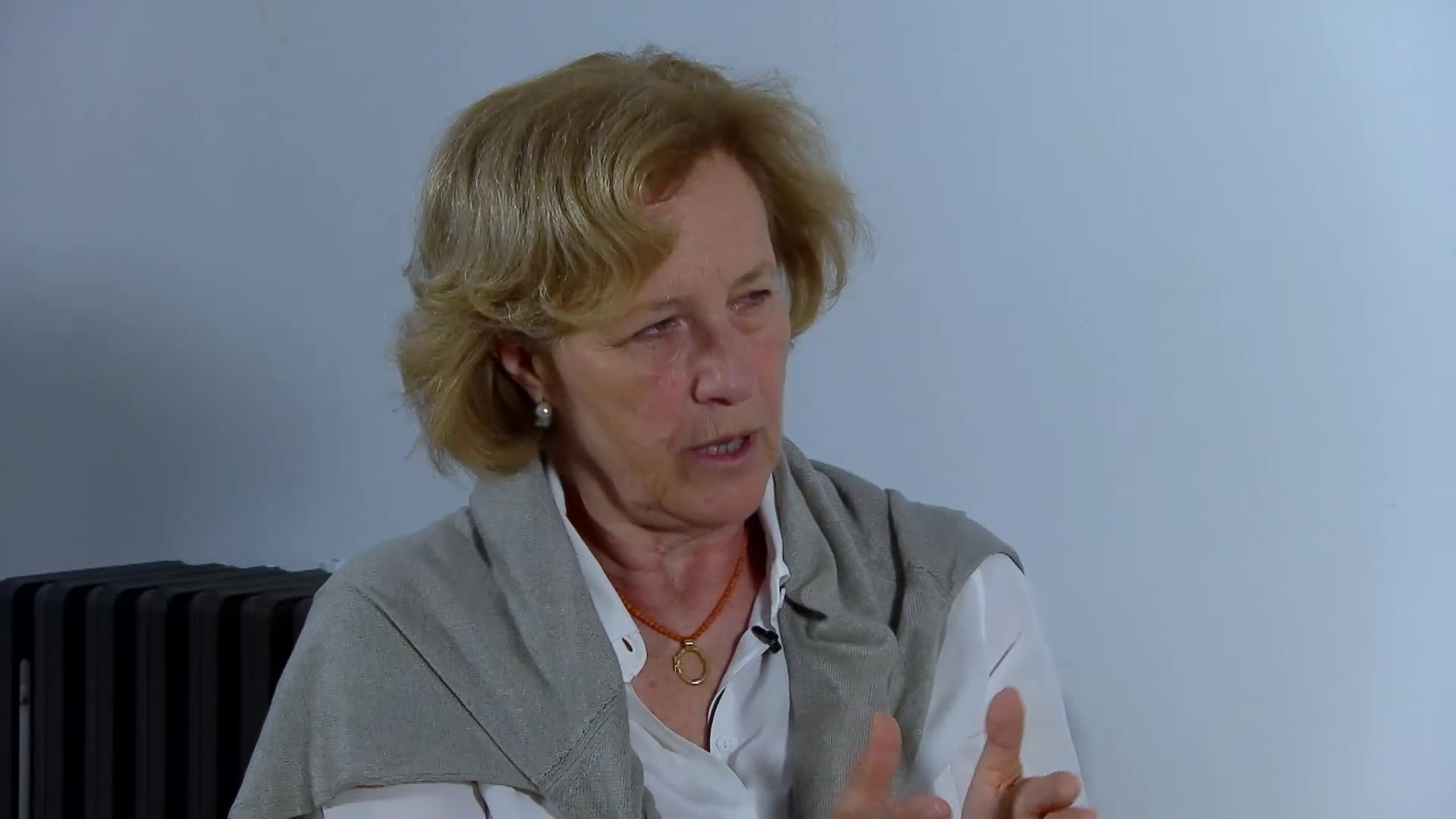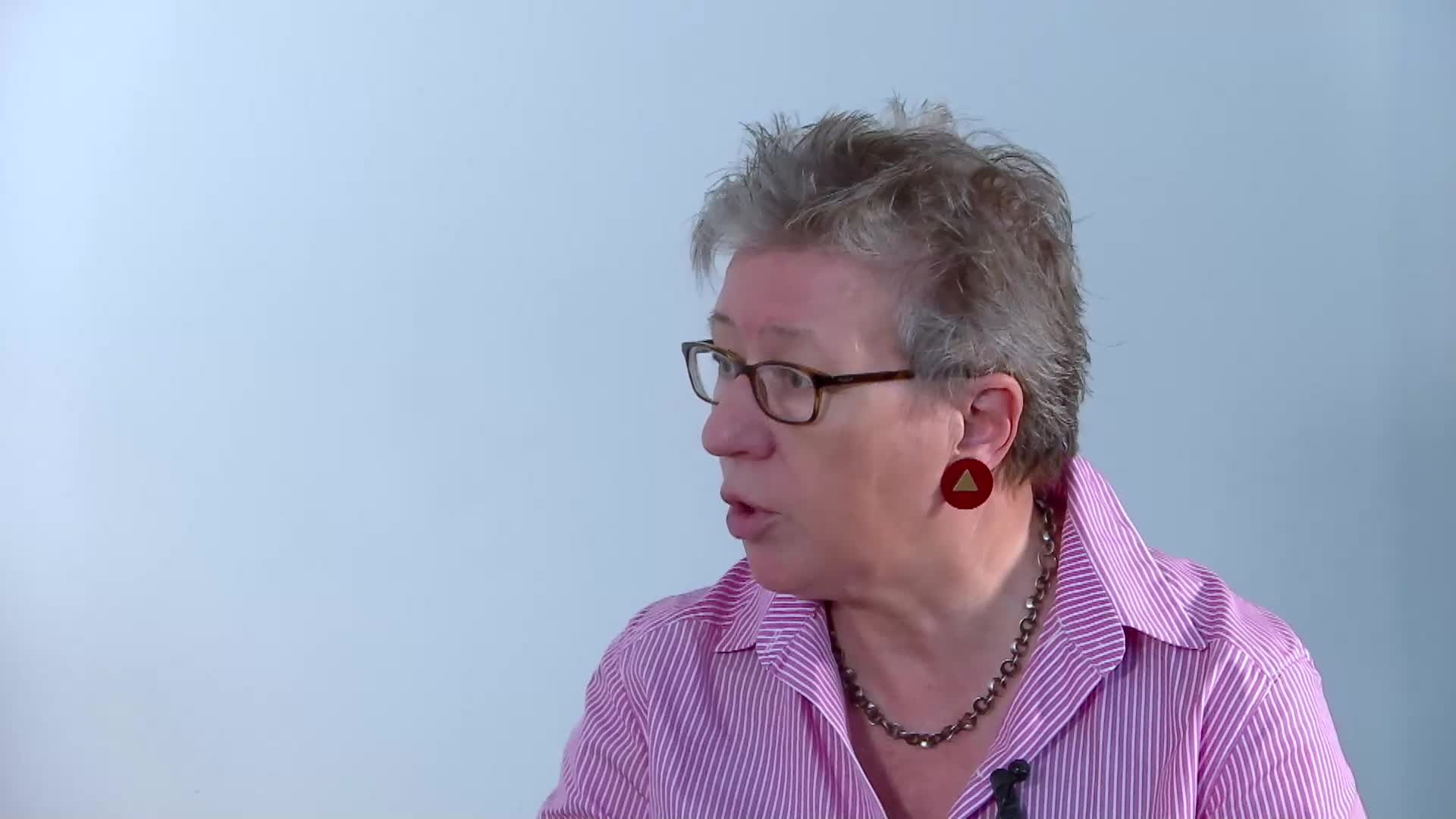Notice
CCIC, Cerisy-la-Salle
Lire l'agriculture urbaine à partir de l'espace topologique : une approche par les pratiques des habitants dans la métropole rennaise
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé "Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées" qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 6 au 13 août 2014, sous la direction de Sylvain ALLEMAND et Édith HEURGON.
Présentation de l'intervenant
Paula Nahmías est doctorante à l’UMR CNRS 6590 ESO Espaces et Sociétés, Université Rennes 2 et travaille à la rédaction de sa thèse. Ingénieure agronome diplômée de la "Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso" au Chili, elle a 6 ans d’expérience de travail au Ministère de l’Agriculture du Chili dans le domaine du développement rural à travers la formulation de politiques publiques et la mise en place de mécanismes d’organisation des acteurs paysans. Elle est également titulaire d’un Master International Erasmus Mundus en développement rural et d’un master recherche en géographie sociale à l’Université Rennes 2. En partant de la réflexion de l’agriculture paysanne, elle s’est intéressée aux rapports entre le milieu rural et le milieu urbain. Cette réflexion est actualisée par une entrée de géographie sociale, axée sur les enjeux de l’agriculture urbaine vécus à travers les pratiques des habitants.
Résumé de la communication
L’observation de l’agriculture urbaine dans la métropole rennaise montre que l’agriculture pratiquée et vécue par les habitants aux échelles de la vie quotidienne donne lieu à une diversité d’expériences et de formes agri-urbaines qui concernent l’individu et ses constructions sociales. Les lieux d’agriculture urbaine pratiqués, perçus, représentés et vécus par les habitants peuvent être identifiés dans le tissu urbain, dans la frange urbaine, et dans l’espace périurbain. Les agricultures vécues et/ou pratiquées par un habitant de la ville peuvent aussi se déployer jusque dans l’espace rural.
La notion d’espace topologique (Le Caro, 2011) permet d’interroger les dimensions de l’habiter qui participent à la construction des lieux cultivés et jardinés en milieu urbain. L’élargissement des lieux de vie se manifeste ainsi à travers des rapports d’attachement personnel aux lieux, des expérimentations, des apprentissages et des manières de faire que nous avons pu identifier: échanges de savoir faire, de produits et de matériaux, d’heures de travail de pratiques agricoles et de produits alimentaires entre les habitants qui sont concernés par ces lieux. De même, l’intégration des spatialités individuelles et collectives qui se nouent dans les lieux d’agriculture urbaine entraîne une configuration de relations, voire de réseaux, qui peuvent concerner autant la sphère familiale, amicale, associative que professionnelle. Cette dialectique spatiale se nourrit des représentations que les habitants portent sur la ville, la campagne, l’agriculture et l’alimentation. Cette notion d’espace topologique permet aujourd’hui de mieux comprendre le fonctionnement de l’agriculture urbaine (Nahmias et Le Caro, 2012). Elle interroge les modalités d’intervention des collectivités territoriales, par les décalages qu’elle introduit avec les territoires habituels et normalisés de l’intervention d’aménagement urbain.
Thème
Documentation
Présentation du colloque
Ce colloque prolonge la décade "Renouveau des jardins: clés pour un monde durable?" (août 2012, dont les actes sont parus en mai 2014 aux éditions Hermann) qui a fait paraître l’enjeu crucial des jardins (individuels et collectifs) pour se nourrir dans les sociétés urbanisées, mais aussi leur rôle de réconciliation en accompagnement des transitions spatiales et sociales. Portant plus spécifiquement sur les Nourritures jardinières, cette rencontre s'est proposée d’étudier à quelles conditions les diverses initiatives prises lors de ce renouveau peuvent monter en généralité et apporter des réponses à certains problèmes actuels, alimentaires comme urbains.
Après d’utiles analyses historiques, la réflexion a porté d’abord sur la capacité des jardins à faire face aux défis alimentaires: d'une part, satisfaire aux besoins de subsistance des populations vulnérables, d'autre part, répondre aux exigences croissantes du plus grand nombre en matière de traçabilité pour une alimentation saine, de qualité, voire délicieuse. À la suite de visites dans le Cotentin et de rencontres avec des acteurs de la Manche qui ont permis d’étudier les façons de se nourrir dans le bocage normand, les travaux ont traité des défis urbains impliquant, sur les espaces (urbains, périurbains, intersticiels, en marge), de réconcilier l’agriculture avec la ville. Il s'est agi, dans un premier temps, d’analyser les modalités permettant de se nourrir en ville, et, dans un second temps, de réinterroger, au vu des compétences jardinières, les savoirs et les pratiques des architectes, paysagistes, gestionnaires qui s’engagent ensemble pour construire la ville nourricière, et jusqu’aux enjeux de gouvernance alimentaire et d’adaptation des politiques publiques.
Pour radicaliser un peu les hypothèses, les jardins ont été envisagés comme une réponse possible aux peurs alimentaires et non moins, au travers de certaines opérations de requalification, comme une réponse aux inquiétudes urbaines.
Actes du colloque
Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées
Sylvain Allemand, Édith Heurgon (dir.)
Hermann Éditeurs — 2016
ISBN : 978-2-7056-9182-0
Sur le même thème
-
Villes et environnement en Jordanie et à Oman
AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).
-
Le sorgho de saison sèche au Cameroun
TourneuxHenryLe bassin du lac Tchad et la région camerounaise de l’Extrême-Nord où s’inscrit le Diamaré disposent de terres particulières que l’on peut cultiver en saison sèche sans avoir besoin d’irriguer. Ces
-
Villes côtières, villes fragiles : Quelles suites à l’École des ODD 2025 ? - CoSavez-vous ? Villes …
Après les sessions de l’Ecole des ODD 2025 consacrées aux villes côtières , ce webinaire poursuit les échanges très riches pour faire émerger de nouveaux questionnements aux croisements entre des
-
Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages
MartellaMarcoBesseJean-MarcLe RestifClaireThiébaultStéphanieRencontre du 30 octobre 2024. La mémoire
-
Regards croisés sur le séisme de 557 à Byzance : histoire, archéologie, sismologie [ép. 1/2]
Pour la rentrée de la saison 2024-2025, nous vous emmenons dans la Byzance du VIe siècle ap. J.-C., non pour admirer les ors des palais et le galbe des coupoles, mais pour vivre avec sa population
-
[PODCAST] Rendez-vous au jardin
SchuhDianeLe podcast a été enregistré lors d'une balade sonore ouverte au public effectuée par la chercheuse Diane Schuh dans le jardin de biodiversité de la MSH Paris Nord, à l'occasion des Rendez-vous aux
-
-
-
-
-
-