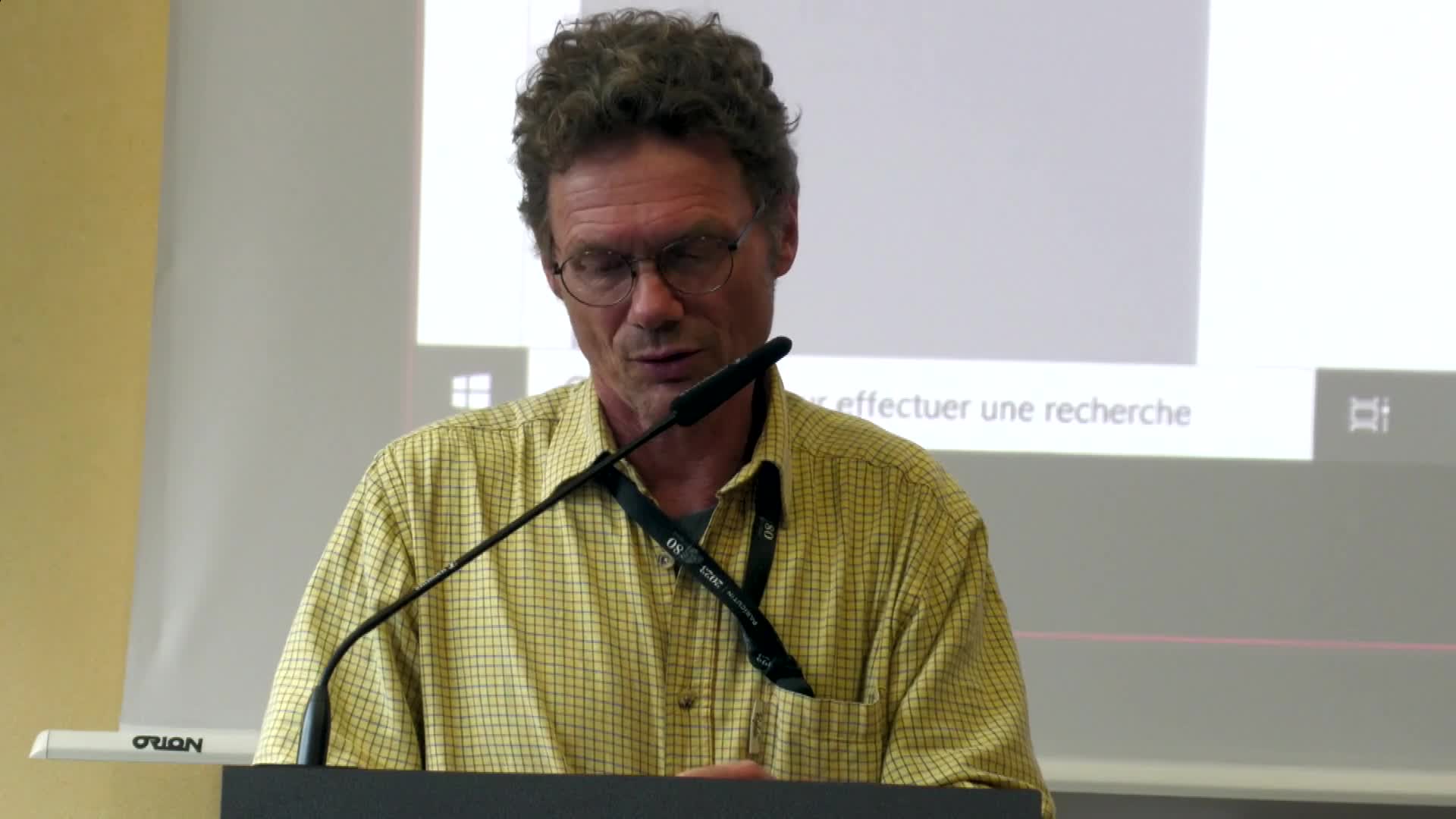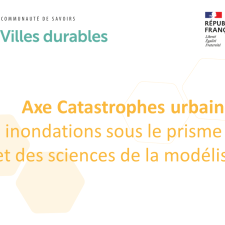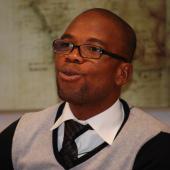Notice
Retranscription
Ce film est dédié aux victimes des inondations. Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre enquête en 2018-2019. Préambule Marinette Crampe : « Moi je n’en ai pas vu d’autres. C’est la première que je vois. » Pascal Aribbet : « On sait que nous sommes sujets à des événements de ce type. On n’était quand même pas préparés psychologiquement à subir une crue de cette ampleur. » Jean-Daniel Cavaillé : « Quand nous avons évacué, les employés municipaux étaient en pleurs et en stress absolu. Ils nous disaient : « Partez... on va tous y passer. ». » Jean-François Meyer, gendarme (Haute Vallée de la Garonne) : « Là, ça dépasse tout entendement. On ne s’imagine pas, un jour, vivre ça. Puis on ne maîtrise pas, ça, on ne maîtrise pas… » Alain Bron : « Jusqu’à présent on n’avait pas, nous, subi réellement une centennale. » Le 18 juin 2013, alors que les Pyrénées centrales connaissent une fonte tardive d’un épais manteau neigeux, de fortes pluies s’abattent. Elles déclenchent une crue exceptionnelle qui surprend, au petit matin, les habitants des hauts bassins versants du gave de Pau et de la Garonne. Jean-François Meyer, gendarme (Haute Vallée de la Garonne) : « On voit le centre de Saint-Béat avec deux mètres vingt, deux mètres trente de flotte, dans les rues. » Frédéric Valot, gérant du Casino/Vival (Haute Vallée de la Garonne) : « Vous voyiez des bêtes, des moutons qui passaient. Une vache est passée aussi. J'ai vu des voitures qui flottaient… Vous avez de tout, des meubles, tout ça, qui sortaient des maisons. C'était impressionnant. » Christian Armary, restaurateur, moniteur de parapente et de ski (Vallée du Bastan) : « C'est une furie, c'est un bruit, c'est du soulèvement de matière, des enfouissements, qui roulaient… On n’aurait jamais imaginé ça dans notre petit torrent des Pyrénées alors qu'on y est toujours passé, on l’a toujours traversé, on y est toujours passé d’une pierre à l’autre, et là ce n'était carrément plus possible du tout. » Daniel Delous, retraité RTM-ONF (Vallée du Bastan) : « Et puis ce bruit, il y avait du brouillard partout, une odeur de terre… Il y avait des pans de montagne qui tombaient. » Christian Armary, restaurateur, moniteur de parapente et de ski (Vallée du Bastan) : « Ça faisait quelque chose qu'on ne voyait qu'à la télé. » David Pujadas, présentateur du Journal Télévisé de France 2 de 20h : « Bonjour à tous. Dans l’actualité ce soir, le bilan des crues s’alourdit au pied des Pyrénées. Deux retraités ont été emportés par les flots, des routes ont cédé, des villages restent isolés. On parle de millions d’euros de dégâts. L’État se mobilise. Page spéciale. Ce soir nous serons en direct… » Dominique Boutonnet, membre du collectif « Vivre à Saint-Béat » (Haute Vallée de la Garonne) : « Et c'est seulement le lendemain matin qu'on a pu mesurer l'importance de ce qui venait de se passer. Une fois l’eau repartie, on a vu ce qu’il y avait en-dessous, c’était impressionnant. Vers 7h-8h du matin, tout le monde sortait au petit jour dans les rues. Entre habitants, on se croisait dans les rues du village, mais sans se parler. Oh, c'était terrible, terrible. Très dur. » Dominique Souberbielle, Directeur des Thermes de Barèges (Vallée du Bastan) : « Le lendemain, à 4h30 j’étais déjà dehors, je n’avais quasiment pas dormi. Effectivement là, on voyait les gens qui sortaient dans la rue... hébétés. » Maryse Carrère, Sénatrice des Hautes-Pyrénées : « On…
Lire l'intégralitéAprès la crue
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Quelques années après la crue exceptionnelle de 2013 dans les Pyrénées centrales, Anne Peltier et Jean-Marc Antoine, enseignants-chercheurs au Laboratoire Géographie de l’environnement (GEODE), sont allés recueillir la parole des habitants et des acteurs locaux pour mieux connaître la période de l’après-crue.
Ils ont choisi deux vallées particulièrement touchées par la catastrophe :
- Vallée du Bastan (Hautes-Pyrénées) : Barèges, Luz-Saint-Sauveur
- Haute vallée de la Garonne (Haute-Garonne) : Fos, Saint-Béat
Ils étaient accompagnés de Claire Sarazin du Pôle Production de la Maison de l’Image et du Numérique (MIN) qui a réalisé le documentaire. Le film intègre des images d’archives de l’INA et des archives locales recueillies auprès des habitants des deux vallées.
Ces témoignages montrent que les deux territoires étudiés ont fait face à beaucoup de difficultés après la crue et qu’ils n’ont pas récupéré au même rythme et de la même manière. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi.
Avec ce film, les chercheurs présentent le fruit de leur travail au grand public et en particulier aux habitants des deux vallées. Ils ont voulu, grâce à de nombreux entretiens, rendre compte du vécu des habitants après une crue et montrer les stratégies déployées par les acteurs du territoire pour faire face aux conséquences de cette crue.
Intervention / Responsable scientifique
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La gestion des risques : le cas des montagnes
VidalFranckAntoineJean-MarcA côté des grands types de risques naturels (feux, inondations, mouvements de terrain...) certains milieux sont susceptibles de générer des risques propres, mais également d'en amplifier les effets. C
Sur le même thème
-
Construction de sens, gestion des risques naturels et résilience
LièvrePascalVan Wyk de VriesBenjaminMérourEléonoreSymposium « Construction de sens, gestion des risques naturels et résilience » avec Pascal Lièvre, Benjamin Van Wyk de Vries et Eléonore Merour.
-
Axe Catastrophes urbaines - Les inondations sous le prisme des SHS et des sciences de la modélisati…
PujolLéoGuevara ViquezSofiaDeux présentations : Assimilation de données variationnelle pour la modélisation de crues éclair urbaines : application à un quartier d’Abidjan Capturer l(es) inondation(s) dans la ville : le
-
Hydrologie spatiale : la solution ? - CoSavez-vous ? Eau bien commun
VenotJean-PhilippeHostacheRenaudLes dernières décennies ont vu les capacités d’observation de la Terre par satellite démultipliées. Ces sources de données massives et les financements qui y sont associés offrent des opportunités
-
Territoire servis, territoires servants : face aux grands projets, quel avenir pour la Bassée ?
GobertJulieDeroubaixJosé-FrédéricÀ 70 Km au sud-est de Paris, dans la Bassée, grande plaine alluviale d’Ile-de-France, un casier pilote d’une capacité de 10 millions de m³ d’eau, fonctionnant comme un bassin de surstockage en cas de
-
Le Morbras, une petite rivière urbaine sous pression ou opportunité pour redécouvrir la nature en v…
LespezLaurentLe Morbras est un petit cours d’eau ordinaire, prenant source en Seine-et-Marne, et continuant son cours dans le Val-de-Marne. Contrairement à la Seine ou à Marne, dans lequel se jette le Morbras, ces
-
Configurations et dynamiques de l'aide humanitaire dans la vallée du fleuve Niger au Nord-Bénin
DjohyGeorgesLes inondations récurrentes au Nord-Bénin ont des conséquences désastreuses pour les communautés locales. Bien que de nombreux projets d'aide aient été lancés, la situation ne s'améliore pas. Dans son
-
Climate change: a reality in Normandy
LaignelBenoîtBenoît Laignel, a professor at the University of Rouen Normandie, presents the work of the Normandy IPCC in this vide.
-
Le changement climatique : une réalité en Normandie
LaignelBenoîtBenoît Laignel, professeur à l'université de Rouen Normandie, présente dans cette vidéo, les travaux du GIEC Normandie.
-
Film Terrain n°8 - L'histoire d'Ouragame
GrancherDelphineAnselmeBriceDurandPaulDécouvrez l'histoire d'Ouragame...
-
L’atome, les flots et la ville : Fukushima ?
Depuis mars 2011, l’ultime catastrophe a un nom : « Fukushima ». Les images de l’explosion de la centrale nucléaire japonaise ont véhiculé, à travers le monde et en chacun de nous, des sentiments
-
Risque climatique et réactivité des populations urbaines vulnérabilisées face à la montée des eaux …
Partant des trois principales étapes adaptatives des populations exposées aux risques d'inondation dans l'histoire en France (affolement des populations, débat entre experts et prise de décision)
-
Une histoire relique ou un retour d'expérience ? La contribution de l'historien au risque littoral …
Ce travail tente de prouver l'intérêt pour l'assureur d'une approche historique consacrée aux tempêtes et aux cyclones entre 1500 et nos jours. Les exemples de la France, de l'Europe et de l'Océan