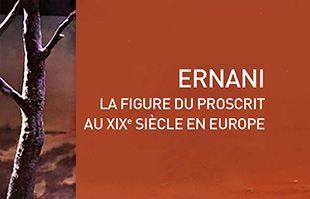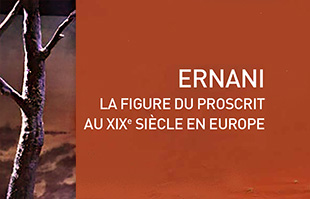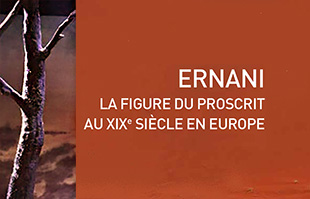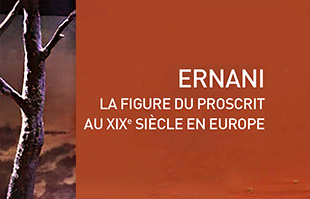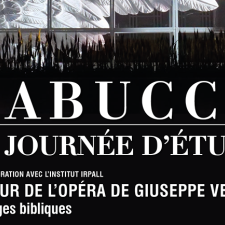Notice
Le proscrit populaire en Italie (XVIIIe-XIXe siècles) / Jean-Luc Nardone
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Le proscrit populaire en Italie (XVIIIe-XIXe siècles) / Jean-Luc Nardone, in "La figure du proscrit dans les arts en Europe dans la première moitié du XIXe siècle" [Autour de l'opéra Ernani], journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordinationde Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 28 février 2017.
* Images et prise de son : Service audiovisuel de la Mairie de Toulouse.
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un banni, un être renié par la société, un hors-la-loi qui tient déjà sa revanche : être tout le contraire d’un hors-la-vie. Son bannissement révèle l’existence d’un monde à la périphérie de la civilisation, qui n’attend que son action de bandit pour renverser l’ordre de l’univers. Le méchant devient le gentil. Il est notre « lion, superbe et généreux ». Il est fureur. Il fait fureur. Mis au ban pour un crime parfois non avéré, il exprime colère et ressentiment à l’égard d’une société qui le dégoûte par sa médiocrité et qui le fascine tout autant, ne serait-ce qu’à travers la bien-aimée qu’il adore et qui demeure de l’autre côté de la barrière, prisonnière. Il est une force qui va. Sa violence est mortifère, elle est aussi passionnelle. Il aime à la démesure le cœur de celle qui voudrait le sauver et la main de celui qui cherche à le tuer.
Les chercheurs réunis dans le cadre de la 17e journée d’étude organisée par l’Institut IRPALL en collaboration avec le Théâtre du Capitole présentent plusieurs figures de proscrits, tantôt réelles tantôt fantasmées, issues de pays différents, dont certaines ont connu les feux de la rampe d’une scène d’opéra ou de théâtre [texte de présentation de Michel Lehmann].
Mots-clés : Critique et histoire de la littérature italienne ; Opéras -- Italie ; Bandits et brigands (dans la littérature), Dante Alighieri (1265-1321), Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871)
Thème
Documentation
Références documentaires
FOURNIER-FINOCCHIARO, Laura (2017). Les exilés politiques italiens, vecteurs et médiateurs de la langue et de la littérature italienne en France au XIXe siècle, in Laura Fournier-Finocchiaro, Cristina Climaco (dirs), Les exilés politiques espagnols, italiens et portugais en France au XIXe siècle : questions et perspectives, Paris, Éditions L'Harmattan, 121-144.
MILANI, Giuliano (2015). Esili difficili. I bandi politici dell’età di Dante, in Johannes Bartuschat (dir.), Dante e l’esilio, Ravenna, Longo editore, coll. Letture Classensi, 31-46.
FERRARA, Sabrina (2013). D’un bannissement subi à un exil revendiqué, Arzanà, 16-17, 199-213. [En ligne : https://journals.openedition.org/arzana/217].
NARDONE, Jean-Luc, MALHERBE-GALY, Jacqueline (eds) (2012). Les Vêpres siciliennes. Le complot de Jean de Procida. Toulouse, Éditons Anacharsis, 87 p.
La Muette de Portici. Auber (2011), Avant Scène Opéra, 265, 114 p.
MILANI, Giuliano (2003). L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XIIe-XIVe secolo. Roma, Istituto Storico Italiano per il MedioEvo (ISIME), 515 p.
SHAW, Christine (2002). Ce que révèle l’exil politique sur les relations entre les États italiens, in La République en exil (XVe-XVIe siècles)", Laboratoire italien, 3, 13-32. [En ligne : https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/361].
ULYSSE, Georges (dir.) (1991). L’Exil et l’exclusion dans la culture italienne. Actes du colloque franco-italien, Aix-en-Provence, 19-20-21 octobre 1989. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 270 p.
HEERS, Jacques, BEC, Christian (dirs) (1990). Exil et civilisation en Italie : XIIe-XVIe siècles. Nancy, Presses universitaires de Nancy, 141 p.
HINARD, François (1985). Les proscriptions de la Rome républicaine. Rome, École Française de Rome, 624 p.
HUGO, Victor (1830). Hernani ou L'Honneur castillan [extrait : scène II]. Paris, Mame et Delaunay-Vallée Libraires, 154 p. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8617137c/f17.item ou http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/HUGO_HERNANI.pdf].
Dans la même collection
-
La force lyrique du proscrit : le héros préféré de Verdi ? / Michel Lehmann
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
Verdi et la littérature allemande. La figure du proscrit dans "Die Räuber" et "I Masnadieri" / Jea…
CANDONI Jean-François
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
Depuis Pampelune. L’Espagne romantique et farouche d’Hugo et de Verdi / Amaia Arizaleta
ARIZALETA Amaia
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
« Crois-tu donc que pour nous il soit des noms sacrés ? » : éthique et dramaturgie des proscrits da…
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La Bible dans la peinture italienne du XIXe siècle
NARDONE Jean-Luc
Le thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
L’Italie et la tradition orientale, de Marco Polo au XVIIe siècle / Jean-Luc Nardone
NARDONE Jean-Luc
Récits de voyage, contes et fictions locales, pensées et spiritualités ne forment qu’une part de la vaste matière identitaire prête à circuler d’une civilisation à l’autre. Pour cela, il faut