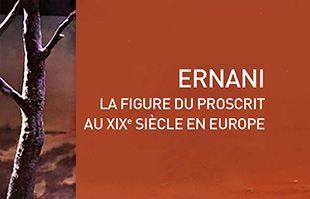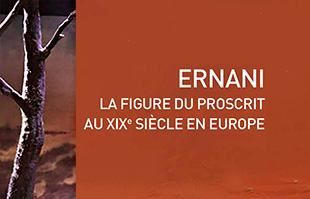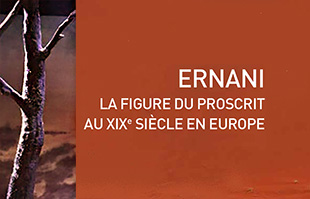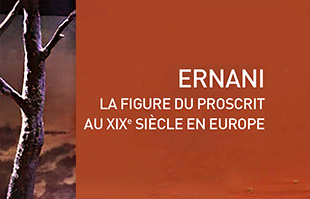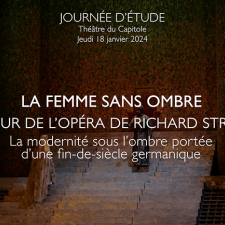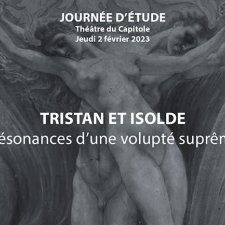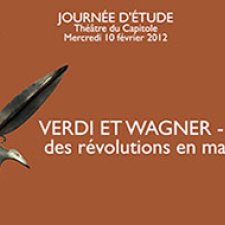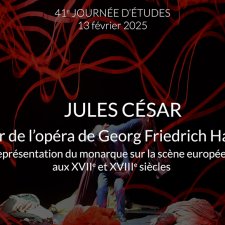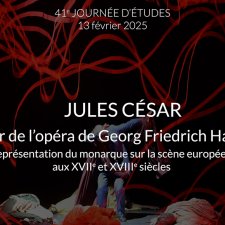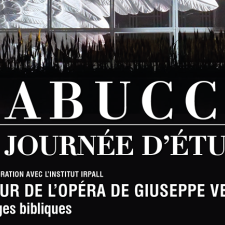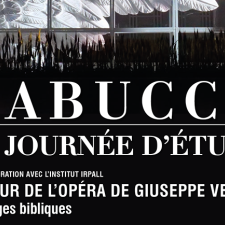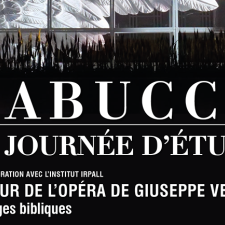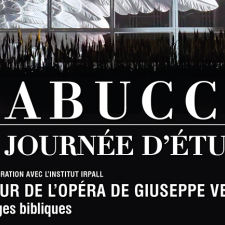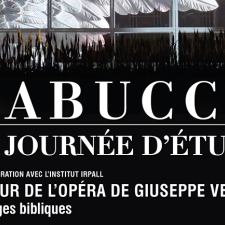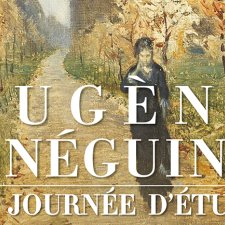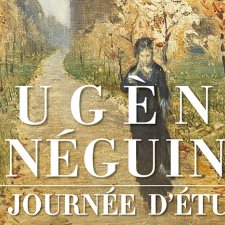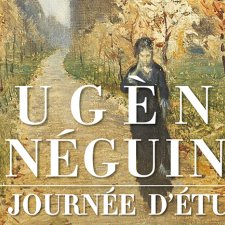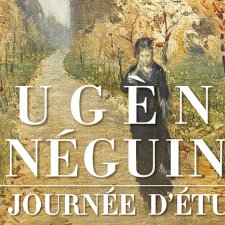Notice
Verdi et la littérature allemande. La figure du proscrit dans "Die Räuber" et "I Masnadieri" / Jean-François Candoni
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Verdi et la littérature allemande. La figure du proscrit dans Die Räuber et I Masnadieri / Jean-François Candoni, in "La figure du proscrit dans les arts en Europe dans la première moitié du XIXe siècle" [Autour de l'opéra Ernani], journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordinationde Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 28 février 2017.
* Images et prise de son : Service audiovisuel de la Mairie de Toulouse.
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un banni, un être renié par la société, un hors-la-loi qui tient déjà sa revanche : être tout le contraire d’un hors-la-vie. Son bannissement révèle l’existence d’un monde à la périphérie de la civilisation, qui n’attend que son action de bandit pour renverser l’ordre de l’univers. Le méchant devient le gentil. Il est notre « lion, superbe et généreux ». Il est fureur. Il fait fureur. Mis au ban pour un crime parfois non avéré, il exprime colère et ressentiment à l’égard d’une société qui le dégoûte par sa médiocrité et qui le fascine tout autant, ne serait-ce qu’à travers la bien-aimée qu’il adore et qui demeure de l’autre côté de la barrière, prisonnière. Il est une force qui va. Sa violence est mortifère, elle est aussi passionnelle. Il aime à la démesure le cœur de celle qui voudrait le sauver et la main de celui qui cherche à le tuer.
Les chercheurs réunis dans le cadre de la 17e journée d’étude organisée par l’Institut IRPALL en collaboration avec le Théâtre du Capitole présentent plusieurs figures de proscrits, tantôt réelles tantôt fantasmées, issues de pays différents, dont certaines ont connu les feux de la rampe d’une scène d’opéra ou de théâtre [texte de présentation de Michel Lehmann].
Mots clés : Littérature allemande (18e-19e siècle) ; Adaptations pour l'opéra ; Bandits et brigands (dans l'opéra) ; Giuseppe Verdi (1813-1901) ; Mercadante, Saverio (1795-1870 ; compositeur)
Thème
Documentation
Références documentaires
CANDONI, Jean-François (2020). Les Brigands, de Friedrich Schiller à Giuseppe Verdi. À propos d’un double transfert culturel, in "Théâtre et musique, transferts culturels et identités nationales", European Drama and Performance Studies, 15, vol. 2020-2, 117-132.
KUHNLE, Till (2017). Jeanne d'Arc ou le charisme de la pureté. L'image de la pucelle chez Shakespeare et chez Schiller, in Vincent Cousseau, Florent Gabaude, Aline Le Berre (dirs), Jeanne politique. La réception du mythe de Voltaire aux Femen, Presses Universitaires de Limoges, 41-59.
FRANTZ, Pierre (2008). Le crime devant le tribunal du théâtre : Les Brigands de Schiller et leur fortune sur la scène française, in "Réécritures du crime : l’acte sanglant sur la scène (XVIe-XVIIIe s.), Littératures classiques, 67, 219‑230. [En ligne : https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques1-2008-3-page-219.htm].
SCHILLER, Friedrich von (2004). Sämtliche Werke. Vol. 1 et Vol. 2. Eds. Peter-André Alt, Albert Meier et alii. München, Carl Hanser Verlag, 1040 et 1305 p.
SCHILLER, Friedrich von (2002). Les Brigands / Die Räuber. Trad. de R. Dhaleine. Paris, Éditions Aubier-Flammarion, coll. bilingue, 384 p.
LETERRIER, Sophie-Anne (2000). Jeanne d’Arc sur la scène lyrique, in Daniel COUTY, Jean MAURICE (dirs), Images de Jeanne d’Arc, Paris, Presses Universitaires de France, 253-256.
GERHARD, Anselm (1998). The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the Nineteenth Century. Trad. par Mary Whittall. Chicago, University of Chicago Press, 503 p. [Titre original : Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts, Stuttgart, JB. Metzler Verlag, 1992].
DE VAN, Gilles (1992). Verdi, un théâtre en musique. Paris, Éditions Fayard, 480 p.
SCHILLER, Friedrich von (1877) Lettre 121 [à Goethe], Iéna, le 29 décembre 1797, in Benjamin LEVY (ed. et trad.), Correspondance entre Schiller et Goethe, Paris, Librairie Hachette, 281-283. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68378w].
SCHILLER, Friedrich von (1867). Les brigands. Paris, Bibliothèque nationale, 183 p. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k683379].
Dans la même collection
-
La force lyrique du proscrit : le héros préféré de Verdi ? / Michel Lehmann
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
Le proscrit populaire en Italie (XVIIIe-XIXe siècles) / Jean-Luc Nardone
NardoneJean-LucDès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
Depuis Pampelune. L’Espagne romantique et farouche d’Hugo et de Verdi / Amaia Arizaleta
ArizaletaAmaiaDès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
-
« Crois-tu donc que pour nous il soit des noms sacrés ? » : éthique et dramaturgie des proscrits da…
Dès les premières heures du Romantisme, surgit un personnage d’un genre fort apprécié et taillé pour la force lyrique de l’opéra romantique : le proscrit. Un héros d’un nouveau type, un condamné, un
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La Femme sans ombre, le dernier opéra romantique ?
CandoniJean-FrançoisSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des
-
Pour en finir avec l'emprise de Wagner ? Le Tristan de Thomas Mann
CandoniJean-FrançoisQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un
-
Symbole, mythe et religion dans "Parsifal" / Jean-François Candoni
CandoniJean-FrançoisDepuis Tannhäuser et Tristan und Isolde, Parsifal complète la galerie des légendes médiévales que Wagner modèle à sa guise, porté par une volonté puissante de réaliser son projet ambitieux, celui d’un
-
L'opéra au XIXe siècle, point de cristallisation romantique des nationalismes européens. Les exempl…
CandoniJean-FrançoisVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. Tannhäuser (1845) et Il trovatore (1853)
Sur le même thème
-
Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle
EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d
-
Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle
MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d
-
La musique du « Va pensiero » : pastiche biblique, imaginaire patriotique, apax de choeur d’opéra
LehmannMichelLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Nul n’est prophète en son pays : Rossini, du Mosè napolitain (1818) au Moïse parisien (1827)
AstorDorianLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
La Bible dans la peinture italienne du XIXe siècle
NardoneJean-LucLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Nabucco et la Bible : entre source d’inspiration et écarts
CourtrayRégisLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Le Nabucco de Verdi, actualisation miraculeuse de clichés bibliques
GaudardFrançois-CharlesLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi
LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Défenses d’aimer. Les obstacles à l’amour dans le drame wagnérien
ImperialiChristopheDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Le malheur de s’appeler Eugène. Du roman en vers de Pouchkine (1833) à l’opéra de Tchaïkovski (1879…
ZidaričWalterDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Des Souffrances du jeune Werther (1774) aux souffrances de Charlotte dans l’opéra Werther (1892) : …
MalkaniFabriceDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
L’aveu de Phèdre à Hippolyte : un défi pour l’opéra (1733-1821, de Paris à Milan)
GrosperrinJean-PhilippeDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une