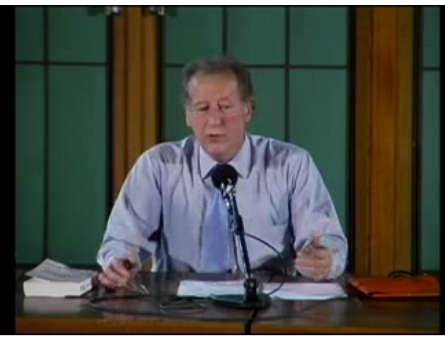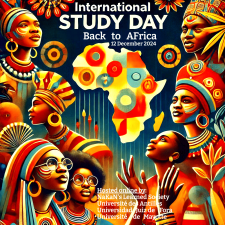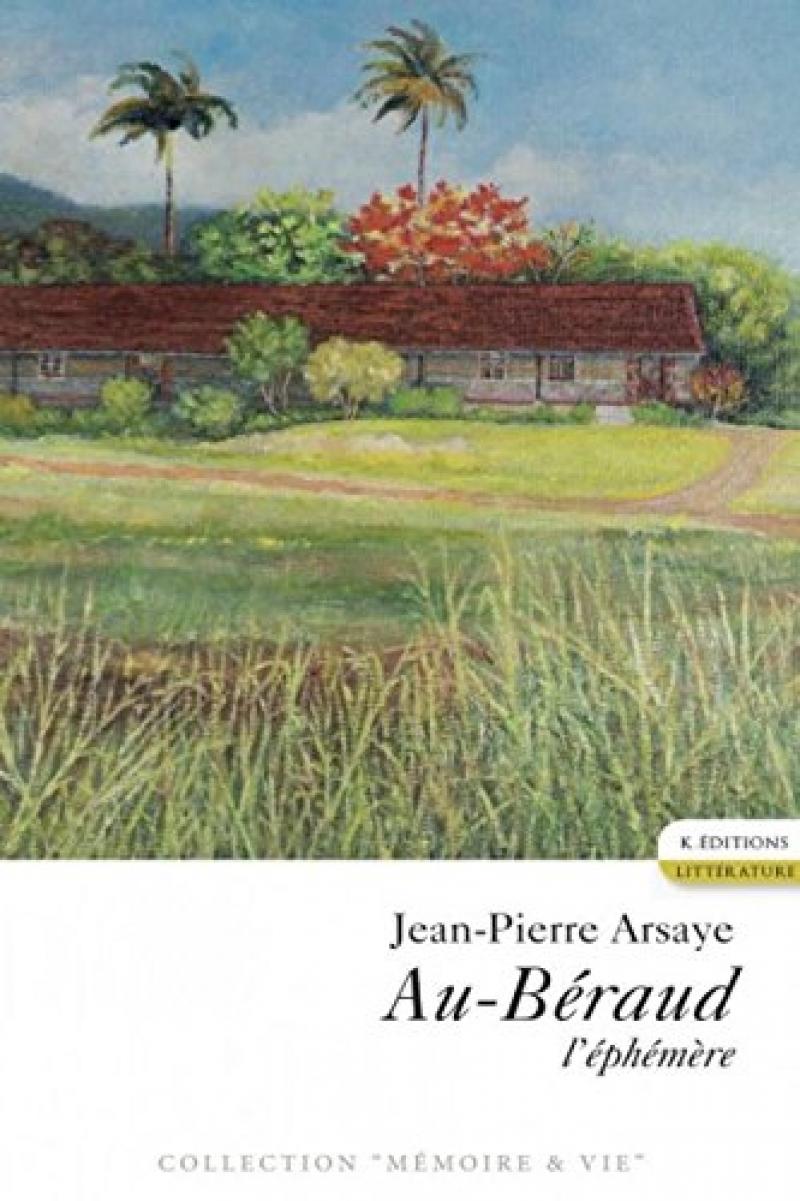Texte de la 658e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 13 octobre 2007
AUTORITARISME POLITIQUE ET MONDE MUSULMAN
Par Nadine Picaudou
La formulation même du thème proposé : « Autoritarisme politique et monde musulman », m’interroge et me trouble à la fois. D’abord parce qu’en singularisant la notion d’autoritarisme politique, elle semble s’inscrire dans la postérité d’un lieu commun des représentations occidentales de l’Orient, le despotisme oriental, dont Lucette Valensi a montré ce qu’il devait à la République de Venise soucieuse de stigmatiser le rival ottoman. L’image a été reprise par Volney, l’un des pionniers du voyage en Orient, qui attribue la décadence historique de la Syrie à la tutelle despotique d’Istanbul. Mais la formule présente surtout l’inconvénient majeur de mettre en parallèle un concept politique et un qualificatif religieux, au risque de glisser d’une simple corrélation entre les deux notions à un lien causal d’explication. Ainsi lorsque Samuel Huntington observait en 1988 que sur 46 pays démocratiques dans le monde, 39 étaient chrétiens, il établissait de fait, après beaucoup d’autres, une corrélation simple entre culture politique et culture religieuse. Prétendues affinités entre christianisme et démocratie d’un côté, entre islam et régimes autoritaires du l’autre ? Les réflexions qui suivent ne se situent pas sur ce terrain là. Précisons d’emblée qu’elles se fondent sur le seul cas des sociétés arabes alors même que le monde de l’islam ne ses réduit pas on le sait au monde arabe. Après avoir posé le constat de la permanence de ce que j’appellerai globalement les autocraties arabes, je tenterai dans un deuxième temps de proposer quelques éléments d’intelligibilité du phénomène.
PERSISTANCE DU « SYNDROME AUTORITAIRE
Le monde arabe contemporain embarrasse les politologues au point que les théoriciens des transitions démocratiques parlent volontiers « d’exceptionnalisme arabe » en matière de démocratie. De fait, le monde arabe est l’un des grands absents de cette littérature qui a accompagné les trois vagues du changement politique survenues dans le monde au cours des dernières décennies : la sortie des fascismes en Europe du sud, la fin des dictatures militaires en Amérique latine, le basculement de l’Europe centrale et orientale après la chute du mur de Berlin. La longévité des autocraties arabes ne laisse pas d’interroger.
Deux remarques préalables s’imposent quant à la notion même d’autocratie. La notion d’autocratie n’est pas à proprement parler un concept. Elle désigne une réalité politique qui ne serait ni une démocratie ni un totalitarisme. Le projet totalitaire se distingue du simple régime autoritaire sur deux points fondamentaux : d’une part il ne vise pas seulement à dominer et à encadrer une société mais à la détruire, à en briser l’autonomie, à effacer la frontière entre système politique et société civile, entre privé et public. D’autre part, le totalitarisme est porteur d’une vision idéologique, d’un projet de transformation de la société et de construction d’un homme nouveau. L’autocratie se définit donc par la négative, ni démocratie ni totalitarisme et ne constitue pas un modèle politique spécifique.
Dans le monde arabe, elle n’offre pas non plus partout le même visage dans la mesure où les systèmes politiques y sont différenciés. Institutionnellement, il y a des monarchies (Maroc, Jordanie, Arabie saoudite…) et des républiques (Algérie, Tunisie, Egypte, Syrie, Irak, Yémen…). Idéologiquement, il existe des régimes conservateurs et d’autres qui se réclament d’un progressisme social et politique. Historiquement surtout rien ne permet d’assimiler la monarchie marocaine, héritière d’un ancien sultanat et la jeune dynastie hachémite importée d’Arabie dans les années vingt dans un Emirat de Transjordanie créé de toutes pièces par les stratèges de l’Empire britannique. Rien ne rapproche non plus l’expérience de la société algérienne, déstructurée par le long épisode colonial, et celle de l’Egypte, où l’Etat et la nation jouissent d’une authentique profondeur historique. Et l’on pourrait multiplier les exemples. Par delà ces différences et pour s’en tenir à un très grand niveau de généralité, deux traits communs caractérisent les autocraties arabes : un strict contrôle politique mais aussi idéologique et culturel des sociétés et la domination de
nomenklatura(s) fermées, ancrées dans des solidarités de parenté ou de clientèle, des élites prédatrices et corrompues imposant des formes de domination néo-patrimoniale et dont l’ultime ambition semble être de se maintenir au pouvoir.
Il n’en faut pas moins nuancer ce constat général et réducteur. D’abord en rappelant quelques unes des expériences d’ouverture politique des années quatre-vingt dix et deux mille qui sont intervenues à la suite « d’événements critiques » déclencheurs d’une crise de régime. Dans le cas du monde arabe, trois types au moins d’événements critiques ont produit de timides ouvertures politiques : une crise d’allocation des ressources, le poids des pressions internationales ou le simple renouvellement générationnel au sommet de l’Etat.
Crise d’allocation des ressources : c’est le cas de l’Algérie où les émeutes d’octobre 1988, initialement provoquées par le renchérissement brutal des produits de première nécessité à la suite d’un plan d’ajustement structurel du FMI, ont rapidement mis fin au monopole du FLN et de l’armée sur l’Etat et ouvert une période d’effervescence politique et médiatique sans précédent avant la dérive vers le conflit civil. C’est le cas aussi en Jordanie où les émeutes populaires qui éclatent sur les mêmes bases au printemps 1989 déstabilisent d’autant plus le régime du roi Hussein qu’elles partent du sud rural et tribal, fief politique traditionnel du régime où l’écrasante majorité de la population, qui vit de la fonction publique civile ou militaire, est touchée de plein fouet par les mesures d’austérité budgétaire. En réponse à l’émeute, le souverain prend quelques mesures de libéralisation politique et promet des élections législatives qui permettront à l’opposition, notamment celle des Frères musulmans, de remporter près d’un tiers des sièges au parlement. L’expérience jordanienne est intéressante dans la mesure où elle permet de tirer quelques leçons généralisables à l’ensemble du monde arabe. D’abord les processus d’ouverture politique sont rarement linéaires et peuvent être suivis de reculs significatifs. Ainsi en Jordanie, l’opposition a perdu du terrain lors des scrutins législatifs des années quatre-vingt dix et le parlement a même été suspendu entre 2001 et 2003, le pouvoir mettant à profit cet intermède pour faire passer une centaine de lois qui libéralisaient l’économie et restreignaient les libertés publiques sous couvert de lutte contre le « terrorisme ». Ensuite l’instillation d’une dose de libéralisation politique ne constitue pas nécessairement le prélude à une réelle démocratisation du régime. Car il convient de distinguer entre la libéralisation, qui se réduit à un desserrement de l’emprise du régime sur la vie publique et la démocratisation, qui implique, outre l’extension des libertés publiques, l’élargissement de la participation politique et la possibilité de l’alternance. Enfin, l’ouverture semble moins y être le résultat d’une réelle dynamique sociale qu’une stratégie politique du régime qui lui permet de surmonter ponctuellement une crise intérieure en jouant un jeu électoral vidé de son contenu (limites imposées au pluralisme, manipulation du découpage électoral, absence de contrôle indépendant du scrutin…). Notons qu’en Jordanie, cette stratégie a permis au régime hachémite d’endiguer l’opposition islamiste légaliste des Frères musulmans en l’associant au pouvoir législatif sans l’inviter à siéger au gouvernement et de la discréditer de surcroît en lui faisant cautionner deux axes très impopulaires de sa politique : l’austérité économique et la normalisation avec Israël.
L’ouverture politique peut aussi se faire sous la pression directe d’acteurs internationaux comme ce fut le cas au Koweït au lendemain de la libération du pays par les forces de la coalition occidentalo-arabe en 1991. Sans doute l e processus d’ouverture était-il enraciné dans les évolutions internes à l’émirat. Il y avait eu, à la veille de l’invasion irakienne, un mouvement dit « pré-démocratique » appuyé sur les étudiants et d’anciens députés d’opposition au parlement dissous. Durant l’occupation, un accord avait été signé entre le gouvernement en exil et l’opposition, qui échangeait l’union sacrée contre la promesse d’un retour à la constitution de 1962 et l’organisation d’élections législatives. Mais l’émir, au lendemain de la guerre, tente de différer toute concession politique en proclamant la loi martiale, pour la première fois dans l’histoire de l’émirat, et en comblant la population de faveurs économiques, notamment des primes d’occupation versées aux Koweïtiens restés au pays. Il a fallu tout le poids des pressions américaines pour que des élections soient organisées en 1992 qui ont là encore permis l’entrée au parlement d’une opposition à dominante islamique.
Le cas de l’Egypte est singulier. C’est sous la présidence de Sadate que le pays a très tôt connu un lent processus d’ouverture politique marqué par l’introduction du pluralisme et un certain désengagement politique de l’armée, mais cette évolution a été mise à l’épreuve au cours des années quatre-vingt dix par la poussée d’une opposition islamiste violente qui a servi à justifier un nouveau renforcement du contrôle de l’Etat sur la société. Certains spécialistes ont proposé de parler de « dé-libéralisation politique » pour qualifier ce mouvement de retour à l’autocratie qui a réduit le jeu électoral, toujours marqué par des fraudes massives voire des violences, à une étroite compétition entre les élites sur fond d’apathie de la société. Notons toutefois que la réforme institutionnelle de 2005 a changé les modalités d’élection à la présidence de la république en autorisant la pluralité des candidatures et en supprimant le filtrage parlementaire de ces candidatures. Mais tout candidat doit pouvoir justifier d’au moins 5% de députés au parlement, ce qui n’est le cas d’aucun parti légal et les candidatures indépendantes sont interdites alors même que les oppositions tolérées mais non reconnues, comme celle des Frères musulmans, usent abondamment de cette étiquette. Il est difficile de dire si ce timide retour à l’ouverture a suivi les pressions occidentales ou s’il a anticipé sur elles, mais il ne peut à coup sûr en être dissocié dans un pays qui constitue un enjeu stratégique majeur au Moyen-Orient et qui est le deuxième bénéficiaire après Israël de l’aide américaine.
Le dernier type d’événement critique qui a pu un moment susciter des espoirs de changement politique dans le monde arabe : le renouvellement générationnel à la tête de l’Etat, successions dynastiques en Jordanie et au Maroc ou « succession républicaine » à Damas, a fait long feu. A l’évidence, le rajeunissement des élites dirigeantes et leur ouverture présumée aux technologies modernes ne constituent pas en eux-mêmes un gage de changement. Au Maroc, le limogeage de l’inamovible ministre de l’Intérieur, Driss Basri, l’exécutant des basses œuvres du régime de Hassan II, et la réforme du code de la famille constituent des symboles forts mais ne suffisent pas à changer les règles du jeu politique. Au reste l’arrivée à la tête du gouvernement, dès 1998, du secrétaire général de l’un des principaux partis d’opposition, l’USFP, exemple unique d’alternance gouvernementale dans le monde arabe, n’ a pas empêché le Palais de continuer à monopoliser l’essentiel des ressources politiques. En Syrie, l’éphémère printemps de Damas, porté par une poignée de députés, d’intellectuels et d’artistes, a tôt fait de déboucher sur une contre-offensive du régime qui a fermé, dès 2001, les forums de débat et procédé à de nouvelles arrestations.
Cette esquisse sommaire de quelques évolutions récentes dans le monde arabe, entre immobilisme des structures, libéralisations en trompe l’œil et retour des autocraties, laisse pourtant dans l’ombre un facteur déterminant : la vitalité des sociétés civiles qui permet souvent de contourner les blocages du champ politique, notamment au Maroc et en Egypte. Les formes en sont très diversifiées : groupes d’intérêt et clubs de réflexion des nouvelles bourgeoisies d’affaire, réseaux caritatifs liés à la mouvance islamique, nouvelles formes de militance des oppositions de gauche reconverties dans la défense des droits de l’homme ou la pédagogie de la citoyenneté. Pour certains observateurs, ces nouveaux répertoires d’action peuvent constituer des moyens efficaces de pression politique, pour d’autres ils pourraient à l’inverse constituer le meilleur alibi des régimes et contribuer à cautionner l’ordre politique établi en permettant aux dirigeants de se prévaloir d’un fonctionnement démocratique sans prendre le risque de l’alternance politique.
Il reste peut–être à faire justice de l’exception libanaise, jadis célébrée comme un îlot de démocratie dans une région arabe vouée à la dictature. De fait, le pluralisme social et politique et le respect des libertés publiques ont longtemps fait de Beyrouth le refuge de tous les opposants arabes, le lieu où s’exprimaient toutes les idées, où se publiaient tous les livres. Si le Liban n’a jamais connu de régime autocratique, c’est que nous sommes là dans un cas de figure très singulier au Moyen-Orient, celui d’un Etat faible, d’une intégration nationale précaire et d’une forme spécifique de démocratie : la démocratie de concordance qui se distingue nettement de la démocratie majoritaire puisqu’il s’agit d’un système qui récuse à la fois le libre jeu de la compétition politique et la règle de la majorité. En substituant au jeu de la compétition un strict partage des pouvoirs entre communautés confessionnelles, assorti d’un droit de veto des communautés en cas de menace sur leur sécurité ou leur identité, la démocratie de concordance cherche à écarter tout risque de domination d’un groupe sur un autre. En récusant la règle de la majorité au profit de la recherche du consensus entre les élites, elle permet d’exorciser la menace d’un éclatement de la communauté nationale. C’est donc dans sa capacité à conjurer le double péril de l’hégémonie et de la guerre civile que résiderait la performance propre du modèle de la concordance ou de la consociation. L’éclatement du conflit civil en 1975 n’en a pas moins démontré la faillibilité du modèle, impuissant à assurer le consensus dans un contexte de fortes tensions régionales qui a précipité l’inféodation des forces politiques nationales à de puissants acteurs régionaux ou internationaux. Plus que le pays de l’exception démocratique, le Liban est peut-être celui de l’impossible autocratie pour des raisons qui tiennent aux structures de distribution du pouvoir et aux singularités de la formation sociale libanaise.
RECUSER LES INTERPRETATIONS CULTURALISTES
Mais au-delà du constat, comment rendre compte de la persistance du « syndrome autoritaire » dans les sociétés arabes ? L’enjeu, pour le spécialiste de cette région du monde, est à mon sens d’échapper à la tentation des approches culturalistes dominantes qui tendent à fonder l’exceptionnalisme politique arabe sur un exceptionnalisme religieux ou culturel.
La thèse de l’exceptionnalisme religieux musulman alimente une littérature pléthorique le plus souvent centrée sur la question de la compatibilité ou de l’incompatibilité entre islam et démocratie. J’en singulariserai deux thèmes récurrents, à commencer par l’idée selon laquelle l’islam confondrait par nature les deux instances du spirituel et du temporel, du religieux et du politique, faisant par là obstacle à l’autonomisation du champ politique, condition d’émergence des communautés politiques modernes. Cette prétendue confusion des registres est généralement référée à l’origine même de l’islam, au temps d’un prophète à la fois homme de Dieu, homme de guerre et bâtisseur d’Etat, comme si les sociétés musulmanes, en leur multiplicité, avaient échappé à toute historicité. Il importe de sortir de ce fétichisme des origines, qui est au demeurant la marque des fondamentalismes, pour aborder la question complexe des relations entre sphère politique et sphère religieuse en islam. Or les modes d’administration du religieux y ont été le produit de rapports de force historiques entre le personnel religieux (les oulémas) et les princes. C’est à travers les multiples recompositions de ces rapports de force que s’est graduellement instauré un compromis entre une élite politico-militaire et des savants religieux qui ont pu s’imposer comme les maîtres de l’élaboration de la Loi et les porte-parole de la communauté. Les oulémas ont ainsi forgé la fiction d’une source sacrée de l’autorité qui résiderait dans la Loi même de Dieu, en définissant l’autorité politique comme une fonction religieuse sous la forme d’un califat chargé de mettre en œuvre la Loi mais sans concourir à son élaboration, demeurée le monopole des docteurs. Là où, dans l’Occident chrétien, les princes ont pu faire de la monarchie de droit divin la meilleure arme de leur émancipation à l’égard du pouvoir de l’Eglise, les oulémas
ont à l’inverse imposé en monde musulman l’exécration du principe monarchique et l’autorité suprême de la Loi divine, gage de leur propre domination symbolique. Il s’est bien développé, dans les sociétés musulmanes classiques, un espace propre du politique, distinct du religieux et non régi par la Loi de l’islam, au demeurant indigente en matière de droit public, mais tout se passe comme si cet espace du politique n’avait pas produit de légitimité propre hors de la caution des docteurs de la Loi.
La situation qui prévaut dans les Etats arabes contemporains se caractérise quant à elle par le contrôle étroit que les régimes politiques sont parvenus à imposer sur le champ religieux et par les manipulations des valeurs de l’islam mises au service de la légitimité des régimes. L’alliance entre les oulémas et les politiques est partout une alliance inégale au bénéfice des seconds. C’est que les oulémas ont perdu, au cours du XX siècle en monde sunnite, les bases de leur indépendance avec la mainmise des Etats sur les biens de mainmorte (
waqf) qu’ils géraient traditionnellement au nom de la communauté. Désormais nommés, payés et contrôlés par les régimes, ils concourent à leur apporter une pure caution symbolique sur des questions jugées sensibles pour les opinions publiques. En Egypte où coexistent trois acteurs religieux institutionnels, tous nommés par l’Etat, le ministre des affaires religieuses, le
mufti de la république et le recteur
d’al-Azhar, les muftis successifs ont apporté leur caution à la paix avec Israël sous Sadate et beaucoup plus récemment à des décisions aussi variées que l’autorisation des bons du trésor porteurs d’intérêt fixe ou les dons d’organes. S’il est vrai qu’il existe des liens étroits entre l’appareil politique et l’establishment religieux, la définition des politiques publiques, en Egypte comme ailleurs, échappe aux religieux, si l’on excepte le registre du statut personnel qui régit notamment le mariage, la filiation et l’héritage.
On ne saurait pour autant ignorer qu’il existe, dans un certain islam contemporain, des aspirations à une fusion du politique et du religieux. Elles sont le fait de courants de pensée qui font une lecture politique moderne de l’islam. Ce sont les Frères musulmans qui ont, les premiers proposé, dans l’Egypte des années trente, une telle lecture. Ils l’ont fait en glissant de l’adage traditionnel selon lequel l’islam était religion et monde, au-delà et ici-bas (
din wa dunya) à
l’idée révolutionnaire selon laquelle l’islam (leur islam) était indissociablement religion, monde et Etat
(din wa dunya wa dawla) . La deuxième génération radicalisée des Frères, qui sera la matrice de toute la mouvance islamiste contemporaine, est allée plus loin en popularisant l’idée selon laquelle il y aurait en islam un modèle spécifique du politique, si bien que la notion d’Etat islamique ou de République islamique s’est imposée, alors même qu’il s’agissait d’une innovation radicale sans enracinement dans la tradition. Cette lecture politique de l’islam est devenue l’instrument d’un combat contre les autocraties arabes et contre la servilité des oulémas serviteurs des princes.
Mais il existe un autre thème récurrent de l’exceptionnalisme religieux musulman, plus directement lié encore à la question de l’autoritarisme politique qui nous occupe. L’islam sunnite, par la voix de ses oulémas, aurait historiquement prêché la soumission à l’ordre politique établi quel qu’en soit le degré de légitimité, préférant la tyrannie (
zulm) au désordre interne et à la division de la communauté (
fitna). Cette position est fréquemment référée au traumatisme fondateur de la communauté musulmane, cette « grande discorde » qui a suivi au premier siècle l’assassinat du troisième calife, Othman. Une discorde dont l’enjeu portait sur la question de la légitimité califale significativement liée aux conflits qui entouraient alors la recension écrite du texte coranique. Au terme de ces affrontements, la communauté s’est trouvée divisée en trois tendances : les kharijites, zélotes de la justice divine, qui prônaient le droit voire le devoir de rébellion contre un calife injuste, les chiites, légitimistes alides pour qui seule l’appartenance à la maison du prophète fondait la légitimité du pouvoir sur la communauté et ceux que l’on n’appelait pas encore les sunnites, qui se définissent à l’origine comme la « majorité silencieuse » qui acceptera l’ordre omeyyade au sortir de la
fitna. De fait, au cours des siècles suivants, très nombreux sont les cas où des princes ambitieux ont obtenu la caution des oulémas, soucieux d’écarter le spectre de la
fitna. Mais la hantise du conflit civil n’est en rien propre au monde de l’islam et « le paradoxe du politique », pour reprendre le mot de Ricoeur, réside précisément en ceci que le lien politique suppose à la fois l’identification et le conflit, autrement dit exige l’intégration de la dissidence au cœur de la communauté politique.
Quoiqu’il en soit, dans les deux cas : la prétendue incapacité de l’islam à dissocier le religieux du politique, la loi de Dieu et celle de l’Etat d’une part et la préférence donnée à la tyrannie sur le désordre d’autre part, il faut y voir un discours normatif des oulémas autant qu’une réalité des pratiques historiques, toujours plus complexes.
J’aimerais ajouter à ces thèses de l’exceptionnalisme religieux musulman d’autres approches, elles aussi d’inspiration culturaliste, qui fondent l’autoritarisme politique sur des déterminismes sociaux et culturels. Il en est ainsi des structures singulières de la parenté arabe, et plus largement méditerranéenne, qui font peser sur l’individu le poids du groupe familial et clanique. Cette prégnance du groupe domestique tient à la combinaison entre une filiation patrilinéaire (l’on s’y définit comme fils de son père) et un type d’alliance matrimoniale qui est toujours une alliance de proximité
(qaraba) . L’idéal de la proximité s’incarne dans le mariage endogamique avec la cousine germaine paternelle, mariage normatif par excellence souvent appelé « le mariage arabe », dans lequel deux frères marient leurs enfants. Notons que ce type d’alliance apparaît comme l’antithèse absolue du postulat qui a guidé toutes les analyses de l’anthropologie de la parenté : celui de l’opposition structurelle entre la filiation et l’alliance qui fonde le principe, présumé universel, de l’échange des femmes entre groupes distincts. Le système méditerranéen, loin de les opposer, superpose au contraire le registre de la filiation et celui de l’alliance, en cherchant à conserver les femmes du groupe pour les hommes du groupe, dans ce que Germaine Tillon a jadis appelé avec bonheur « l a république des cousins » opposée à la « république des beaux-frères ». Il existe en réalité, dans les pratiques, de nombreuses formes de proximité, indépendantes des liens du sang, qui fondent des parentés électives, notamment toutes les formes de proximité par le voisinage. Mais dans tous les cas, les formes spécifiques de l’alliance fondent la solidarité interne au groupe domestique qui s’organise traditionnellement autour du contrôle commun du capital du groupe par les hommes du groupe, capital matériel, capital matrimonial (les femmes), capital symbolique de l’honneur aussi.
Une fois rappelées les structures de base qui régissent le lien social il resterait à penser les rapports de la parenté et du politique, la relation à établir ou non entre la nature des groupes d’appartenance primaire et le syndrome autoritaire. Ces liens peuvent être abordés à deux niveaux : par le haut d’abord, dans la mesure où les solidarités de la parenté, auxquelles viennent parfois s’ajouter celles de l’appartenance confessionnelle, fondent la cohésion des groupes dirigeants dans la majorité des Etats arabes. Dans le cas extrême de la Syrie, la manipulation des solidarités familiales, tribales et communautaire alaouite est au cœur de la consolidation de l’appareil d’Etat. Rappelons que les alaouites sont une minorité religieuse musulmane d’origine chiite ismaïlienne, en même temps qu’une communauté rurale et montagnarde longtemps marginalisée. Or l’analyse du système politique syrien fait apparaître une forte emprise alaouite sur la parti
baas, l’armée et l’appareil sécuritaire, combinée avec un dosage savant entre clans familiaux et une importance croissante donnée à la proximité personnelle avec le Président Asad, comme si la personnalisation du lien politique, garantie présumée de loyauté, constituait un critère déterminant dans le recrutement des élites. On pourrait démontrer de la même façon comment Saddam Hussein a successivement instrumentalisé sa parenté maternelle pour parvenir au pouvoir avant de s’appuyer sur ses cousins germains paternels, qu‘il a mariés à ses propres filles, et finalement sur ses fils, après l’élimination sanglante des cousins. On pourrait à l’inverse citer l’exemple singulier de l’Arabie saoudite où la succession dynastique se fait par cooptation interne au clan des Saoud mais où l’on observe la rotation au sommet des matrilignages, les clans d’origine des mères des princes. Car les princes qui comptent dans le premier cercle du pouvoir, ceux qui détiennent des ministères de souveraineté ou des gouvernorats de provinces sensibles, font des mariages exogamiques contraires à la norme du mariage préférentiel arabe, alors que les femmes du clan Saoud font le plus souvent des mariages endogamiques. Les Saoud sont donc un clan preneur et non donneur de femmes, ce qui tout à la fois exprime leur position dominante et contribue à la pérenniser. Ici les stratégies matrimoniales constituent un moyen privilégié de coopter et de clientéliser les autres clans du pays. Dans une formation sociale tribalisée et une communauté nationale faiblement intégrée comme l’Arabie saoudite, la mainmise du clan paternel sur le pouvoir, gage de la cohésion et de la stabilité du groupe dirigeant, se combine donc avec le principe de l’échange des femmes qui suspend la règle traditionnelle de l’endogamie pour faire des stratégies matrimoniales un instrument de gouvernement.
Si la manipulation des solidarités primaires constitue un facteur de stabilité des groupes dirigeants, c’est plus au niveau du consentement des gouvernés à la domination que ce détour par l’anthropologie peut éclairer plus spécifiquement, par le bas cette fois, la question de l’autoritarisme politique. Car la socialisation de l’individu dans des groupes domestiques fermés et puissamment intégrateurs le conduirait à intérioriser dès le plus jeune âge le principe d’une hiérarchie de statut et de pouvoir, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre gouvernants et gouvernés. Le patriarcalisme interne au groupe familial inscrirait dans l’imaginaire social une culture de la soumission à l’autorité qui ne serait pas sans conséquences sur la culture politique . Pour ceux qui établissent une analogie directe entre espace domestique et espace politique national, le patriarcalisme à l’œuvre dans le groupe familial serait directement transposable dans la relation entre gouvernants et gouvernés. L’intériorisation précoce de la hiérarchie et de l’autorité, l’infantilisation durable des fils par les pères seraient autant de caractéristiques que l’on retrouverait dans la relation politique et qui favoriseraient la soumission aux dominants et le culte du chef. Ainsi l’universitaire américain d’origine palestinienne Hisham Sharabi voyait dans cette culture de la soumission au principe d’autorité un obstacle majeur à toute évolution démocratique dans le monde arabe. Il y ajoutait la question connexe du rapport à la langue et de la situation de diglossie entre deux registres de langue très différents, l’arabe littéral du discours politique, de la littérature, de la presse et des medias et l’arabe « dialectal » vernaculaire. Le pouvoir politique et les porteurs de la culture savante parlent en effet une langue qui n’est pas celle de la communication quotidienne. Comme si le monde arabe n’avait toujours pas « perdu son latin » et osé promouvoir les parlers locaux au rang de langues nationales. Sharabi voyait dans cette révolution le préalable absolu à une véritable appropriation de la chose publique par les sociétés.
Toutefois, l’influence des structures anthropologiques d’une société sur sa culture politique est sans doute plus complexe et plus ambivalente. Une certaine résilience des solidarités de la parenté ou d’autres réseaux primaires d’appartenance, comme les communautés confessionnelles, induit des formes de rapport à l’Etat qui ne peuvent se réduire à la soumission pure et simple à l’autorité. Groupes de parentés et communautés confessionnelles assurent des médiations et des transactions entre l’individu et l’Etat qui favorisent l’échange clientéliste comme mode de fonctionnement politique et le clientélisme est à l’évidence une notion aussi indispensable que celle d’autocratie pour rendre compte des systèmes politiques arabes. Mais groupes de parenté et communautés confessionnelles peuvent également constituer des instruments de résistance au caractère intrusif de l’Etat autocratique moderne à l’égard de la société. L’une des raisons pour lesquelles les autocraties arabes, même les plus répressives comme celle de Saddam Hussein, ne peuvent être considérées comme des totalitarismes est peut-être à chercher dans la résistance des réseaux familiaux et claniques que le pouvoir au demeurant cherchait autant à clientéliser qu’à détruire. Les réseaux primaires de solidarité vont enfin jusqu’à développer des modes de régulation du social hors de l’Etat. Je pense aux multiples assemblées de conciliation destinées à résoudre des problèmes de crimes de sang ou d’atteintes à l’honneur, mais aussi toutes sortes de litiges de propriété ou de voisinage ou même les accidents de la route, toutes circonstances dans lesquelles on préfèrera souvent trouver un compromis entre familles pour éviter le recours à l’institution.
HISTORICISER LE PHENOMENE AUTOCRATIQUE ARABE
Si l’on récuse l’ensemble de ces approches culturalistes de l’autocratie, si l’on se refuse à accepter l’idée d’un quelconque « syndrome autoritaire » ancré dans des déterminismes religieux ou culturels pour tenter de « banaliser » l’aire culturelle arabe, autrement dit pour ne pas l’enfermer dans se spécificités, si l’on prétend rendre compte du politique par lui-même, il convient d’historiciser le phénomène autocratique. Pour ce faire il faut distinguer entre les causes et les conditions historiques de l’implantation des autocraties arabes d’une part et les logiques contemporaines de leur permanence d’autre part. Je prendrai pour le démontrer l’exemple de ces régimes que l’on a pu appeler « autoritaires-modernisateurs », des régimes républicains longtemps caractérisés par trois traits principaux : le prétorianisme, le règne d’un parti unique et la gestion étatisée de l’économie, au premier chef, l’Algérie, l’Egypte, la Syrie, l’Irak, le Yemen.
Le prétorianisme se définit on le sait par l’intervention directe de l’armée dans le champ politique mais aussi par une vision de la société et une culture de gouvernement marquées par l’exceptionnalisme de guerre. Or la propension des militaires à exercer le pouvoir politique, dans le monde arabe comme ailleurs, est à la fois liée à un contexte historique spécifique et aux caractéristiques des armées, de leur mode de recrutement et de leur composition sociologique. Le contexte de prise de pouvoir par les militaires fut généralement ici celui d’une décolonisation ou d’un moment de forte tension anti-impérialiste exacerbée par le système bipolaire de la guerre froide. Les militaires se donnent alors pour mission le combat pour l’indépendance et la souveraineté nationale et étatique. En Algérie, l’armée sort du mouvement de libération nationale et fondera longtemps sa légitimité politique sur la mémoire mythifiée de la guerre d’indépendance. La Syrie connaît trois coups d’état au cours de la seule année 1949 dans le contexte de déstabilisation qui suit la défaite arabe de Palestine en 1948. En Egypte, le coup d’état des « Officiers libres » en 1952 intervient dans un contexte de mobilisation nationaliste contre le maintien de la présence militaire britannique dans la zone du canal de Suez, l’unique programme initial des officiers putchistes, qui sont des patriotes plus que des idéologues, étant de conquérir une indépendance nationale pleine et entière. En Irak, c’est aussi un coup d’état nationaliste en 1958 qui renverse dans le sang la monarchie hachémite qui avait accepté d’entrer en 1955 dans le pacte de Bagdad, un pacte de défense lié à l’OTAN et dirigé contre l’URSS.
Mais le prétorianisme des armées s’enracine aussi dans leur nature propre. Contrairement aux armées latino-américaines souvent liées aux oligarchies dominantes, les armées arabes recrutent initialement dans les couches populaires, le plus souvent rurales. C’est qu’au long de la période ottomane, les grandes familles arabes se trouvaient pour l’essentiel cantonnées dans les filières du savoir religieux et juridique et écartées des carrières militaires. En Egypte, les carrières d’officiers furent longtemps réservées à une aristocratie turco-circassienne héritière des couches dirigeantes ottomanes. C’est au lendemain des indépendances que l’engagement dans l’armée est devenu l’un des principaux véhicules de la mobilité sociale et les régimes prétoriens se sont initialement fait l’instrument d’une revanche des campagnes sur les vieilles oligarchies urbaines. Armées populaires, armées jeunes aussi et sans tradition de corps, les armées arabes n’en étaient pas moins les forces les mieux organisées, susceptibles de se faire l’instrument du changement politique et du renouvellement des élites.
Le changement induit par l’arrivée au pouvoir de régimes prétoriens s’est accompagné d’une forte mobilisation idéologique orchestrée par un parti unique porteur d’un projet moderniste à la fois nationaliste et socialisant. Des partis d’avant-garde qui ont développé une forte capacité d’encadrement et de mobilisation des sociétés sur le modèle du
baas syrien ou irakien. Ce type de régime a rapidement donné naissance à un appareil bureaucratique pléthorique, nourri par un intense effort éducatif mené au nom de la modernisation des sociétés et de la justice sociale. Le gonflement de l’emploi public a assuré la promotion de nouvelles couches moyennes salariées qui ont formé l’assise politique du pouvoir, et permis de coopter une couche d’intellectuels organiques liés aux régimes en place. Or la faiblesse d’une intelligentsia critique ou dissidente paraît aujourd’hui un obstacle majeur à la sortie des autocraties.
Toutefois, ces autocraties militaro-partisanes ont profondément évolué avec le temps. Les armées ont changé de nature et modifié leur mode d’intervention dans le champ politique : en Egypte surtout, on ne peut plus parler de prétorianisme : l’armée s’est professionnalisée en même temps qu’elle devenait un puissant acteur économique et se transformait en caste privilégiée coupée du reste de la société. Son action politique relève moins aujourd’hui de la domination du système politique que du
lobbying au sein du système
pour défendre à la fois ses intérêts économiques, sa puissance de corps et l’indépendance de sa gestion interne. Elle n’en conserve pas moins une fonction répressive qui en fait le garant de la survie politique du régime.
Les partis uniques ou dominants se sont quant à eux largement dés-idéologisés. Ils conservent un rôle de patronage ( la carte du parti peut conditionner l’accès à l’emploi) et une fonction de contrôle social (en Tunisie comme en Syrie, le parti fonctionne comme un service de sécurité de plus, chargé de tenir le régime informé de l’état d’esprit de la société). Par ailleurs la culture politique, jadis fortement empreinte de populisme, a mal résisté au reflux des mobilisations nationalistes qui a ébranlé le mythe de l’unité du peuple comme à l’enkystement au pouvoir de
nomenklaturas corrompues qui a ruiné le rêve de transparence entre gouvernants et gouvernés et usé la charisme des chefs. Les régimes autoritaires arabes ont aujourd’hui largement épuisé leurs capacités de mobilisation et certains politologues proposent à cet égard de parler de post-populisme.
Dans ces conditions, comment expliquer la pérennité de ces régimes : par la répression, le laminage politique des sociétés, la démission des intellectuels ? Sans aucun doute, mais j’y ajouterai toutefois deux autres types de logiques, l’une interne, l’autre externe. Sur le plan interne, il faut faire la part de leur capacité à contrôler et à redistribuer les ressources, fût-ce de manière inégalitaire. Car on ne saurait penser ces autocraties sans penser les systèmes économiques qui les nourrissent.
Les régimes « autoritaires-modernisateurs » ont initialement mis en œuvre une véritable mystique du développement dans laquelle l’Etat entendait se substituer à une bourgeoisie nationale inexistante pour combler le retard des économies nationales. La vision des élites du tiers-monde était alors dominée par les théories de la dépendance et de l’échange inégal qui prônaient la rupture avec la division internationale du travail et la création d’un appareil productif intégré donnant la priorité à l’industrie lourde, sur le modèle soviétique. Sur le plan interne, l’enjeu était de combattre les oligarchies dominantes, relais économiques des centres dans les périphéries, par la réforme agraire et les nationalisations. Le projet développementaliste assurait ainsi à des régimes non-représentatifs une forme de légitimité politique alternative par les promesses de développement.
Là comme ailleurs pourtant, la gestion étatisée des économies a généré des crises structurelles, dont l’Algérie reste sans doute le meilleur exemple, tout en développant des prébendes au bénéfice de la clientèle politique des régimes. Dans la plupart des cas, ce sont des injections massives de rente qui ont permis de masquer les dysfonctionnements et d’assurer la redistribution sociale.
Car la majorité des Etats dont nous parlons, et des Etats arabes en général, ont des économies de type rentier ou semi-rentier : rentes extractives (pétrole, gaz, phosphates) mais aussi rentes de location (canal de Suez) et rentes géo-stratégiques sous la forme d’aides extérieures, civile ou militaire, ou de transferts financiers inter-arabes des régimes pétroliers de la péninsule et du Golfe vers les autres Etats au titre de l’aide au développement ou du financement de l’effort de guerre contre Israël. Or la rente alimente partout des politiques allocataires de redistribution, par l’emploi public sans souci de productivité, par les services d’éducation et de santé, par les subventions publiques aux produits de première nécessité, qui permettent aux régimes concernés de s’assurer le consensus social et de garantir une certaine stabilité politique appuyée sur le pacte rentier. Si l’on en croit les théories du lien entre taxation et représentation, le citoyen qui nourrit l’Etat par la fiscalité est à même d’exiger la participation politique et le contrôle des gouvernants. Pas de taxation sans contrepartie de représentation. Mais dès lors que l’Etat se nourrit de la rente et non de la fiscalité, il acquiert une certaine autonomie à l’égard de la société. En cela, l’économie politique de la rente constitue l’un des éléments de la persistance de l’autoritarisme politique avec ce paradoxe de régimes perçus comme lointains et non représentatifs auxquels le citoyen ne s’identifie pas mais de régimes nourriciers dont il dépend. Toutefois dès lors que la capacité redistributive de l’Etat baisse comme après le contre-choc pétrolier de 1986 ou que la redistribution est par trop inégalitaire au vu de la corruption endémique qui caractérise les élites arabes de pouvoir, le pacte rentier est remis en cause et la crise d’allocation des ressources se transforme immédiatement en crise politique de légitimité nous l’avons dit.
Aujourd’hui, la plupart des économies arabes sont entrées dans des transitions libérales plus ou moins avancées, mais des transitions qui se font à l’ombre de l’Etat et ne permettent pas à ce titre l’affirmation de forces sociales autonomes susceptibles de mener le combat politique contre l’autocratie. De fait ce que nous observons dans les pays arabes est précisément un capitalisme de clients (« crony capitalism »), dans lequel le secteur privé n’est pas seulement régi par les impératifs du marché et de la compétitivité des entreprises mais par les liens politiques que les entrepreneurs entretiennent avec le régime. Peu autonomes à l’égard de l’Etat, les acteurs économiques cherchent à bénéficier de politiques préférentielles (protections douanières, licences d’importation, bénéfice des marchés publics, accès au crédit…). Ils ne sont guère susceptibles dans ces conditions de se transformer en contre-pouvoir, moins encore de porter un combat politique contre l’autocratie en place. Ainsi en Egypte, l’un des pays arabes les plus avancés sur la voie de la libéralisation économique, une trentaine de conglomérats familiaux (agents régionaux de multinationales, magnats de l’immobilier, du tourisme, de l’agro-alimentaire, de la téléphonie mobile ou de l’assemblage électronique sous licence) tiennent l’économie nationale en entretenant des liens étroits avec le PND de Moubarak et de son fils Gamal, successeur présumé de son père à la tête du pays.
Mais dans une région du monde considérée comme vitale pour la stabilité de la planète, il faut également faire la part des causes externes de la pérennité des autocraties. Elles tiennent en quelques mots : le soutien de la communauté internationale aux régimes en place réputés plus « modérés » ou plus « laïques » que des oppositions qui partout se réclament d’une forme ou d’une autre d’islam politique.
Pour les Etats-Unis, priorité, depuis la guerre froide et jusqu’aux attentats du 11 septembre 2001, résidait dans la stabilité régionale et donc dans la préservation du statu quo ; mais les analyses semblent changer au lendemain du 11 septembre car à l’évidence la stabilité des gouvernements n e préjuge pas de la fiabilité des peuples ; ainsi l’Arabie saoudite, allié loyal des Etats-Unis s’est-elle révélée « porteur sain » de pathologies « terroristes ». Sous l’influence des néo-conservateurs, s’est donc imposée l’image d’un Moyen-Orient malade de deux maux : la dictature et le « terrorisme islamiste » qui mettent en danger l’allié israélien mais aussi l’Occident tout entier. Il en découle un double objectif, l’un immédiat : gagner « la guerre contre le terrorisme », l’autre à plus long terme : démocratiser le monde arabe. Pourtant au-delà des déclarations d’intention, les Etats-Unis sont loin d’avoir abandonné la politique de soutien aux régimes autocratiques qui sont leurs alliés stratégiques. Ils poursuivent en réalité des stratégies mixtes d’appui aux régimes en place en Arabie saoudite, en Jordanie, en Egypte, tout en favorisant des actions ponctuelles de soutien à la société civile. En Irak, les Etats-Unis ont initialement réduit la société à une équation communautaire simple : la communauté sunnite, abusivement assimilée au régime de Saddam Hussein, représentait l’ennemi à abattre et la communauté chiite, historiquement exclue et victime alors même qu’elle était majoritaire dans le pays, devait pouvoir prendre sa revanche historique et occuper une place politique dominante aux côtés des Kurdes. Depuis lors, la radicalisation d’une frange du chiisme politique, la peur des manipulations iraniennes et l’introduction des jihadistes d’al-Qaida sur le terrain irakien ont conduit Washington à rechercher le soutien de certaines forces politiques sunnites. Dans tous les cas, l’occupation étrangère n’a fait qu’exacerber des clivages communautaires qui recoupent plus que jamais les modalités de l’accès au pouvoir dans une communauté nationale peu intégrée dont l’appareil d’Etat a été largement détruit. L’échec américain en Irak ne tient pas seulement à la prétention naïve d’exporter la démocratie à la pointe du canon. Il tient aussi à la méconnaissance des dynamiques locales. Dans un contexte d’affaiblissement de l’Etat et de compétition entre des identités communautaires politisées, les procédures démocratiques libèrent des conflits de valeur qui touchent à la définition même des groupes et ne sauraient à ce titre laisser place au compromis. Autrement dit en l’absence de références communes fondatrices de la communauté politique, la démocratie peut se révéler porteuse de violence.
L’Europe quant à elle a soumis, au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt dix, les régimes autoritaires arabes à des pressions répétées sur la question des droits de l’homme. A compter de 1995, le processus euro-méditerranéen a ajouté au respect des droits de l’homme l’impératif de la bonne gouvernance qui vise à imposer des réformes de structure. Mais en s’appuyant sur les élites en place, cette politique a de fait contribué à les renforcer tout en prenant le risque de discréditer la notion même de réforme .
Plus largement, lorsque la communauté internationale intervient au nom de la défense des droits de l’homme ou de la démocratie, ses interventions courent le risque d’induire un certain nombre d’effets pervers. Ainsi en Syrie en 2001, lorsque le régime a brutalement mis fin à l’éphémère « printemps de Damas », les cadres du parti
Baas ont-ils multiplié les tournées en province pour mettre en garde le peuple syrien contre une poignée d’intellectuels non-représentatifs et « vendus à l’étranger » , dans un pays toujours en guerre contre le voisin israélien où la mobilisation nationaliste reste forte et où l’opinion, sans illusion sur la nature du régime, n’en soutient pas moins dans une certaine mesure la résistance qu’il oppose à l’hégémonie désormais exclusive des Etats-Unis au Moyen-Orient. Autrement dit dans certains contextes, l’interventionnisme extérieur prend le risque de compromettre les oppositions locales.
Dans des contextes de faible consensus national comme le Liban, les interventions étrangères courent un autre risque : celui d’exacerber les polarités de la scène politique locale voire d’aggraver le risque d’implosion. On l’a observé depuis l’adoption, le 3 septembre 2004, de la résolution 1559 du conseil de sécurité de l’ONU qui exigeait le retrait syrien du pays et le désarmement du
Hezbollah , agent de la Syrie et véritable Etat dans l’Etat pour les uns, fer de lance de la résistance à l’hégémonie israélo-américaine en même temps qu’acteur politique légitime sur la scène nationale pour les autres. La crise ouverte depuis lors et marquée par une série de meurtres politiques a débouché sur une impasse institutionnelle dont le pays n’est toujours pas sorti .
Dans le cas palestinien enfin, l’attitude de la communauté internationale a pris le risque de ruiner l’idée même de démocratie aux yeux de l’opinion locale dès lors que l’aide internationale à l’Autorité palestinienne a été suspendue au lendemain de la victoire du
Hamas aux élections législatives de janvier 2006. On ne saurait impunément prêcher la démocratie et en bafouer ainsi les principes les plus élémentaires.
L’une des principales difficultés de la sortie des autocraties et de la construction de systèmes politiques démocratiques dans le monde arabe ne réside à mon sens ni dans l’islam ni dans les spécificités de la structure clanique des sociétés, elle réside dans la concomitance voire le télescopage brutal entre trois processus historiques de longue durée, trois processus distincts aux exigences différentes sinon contradictoires : la construction des Etats, la maturation des nations et l’extension des procédures démocratiques à « l’âge de l’égalité », des processus rendus de surcroît plus complexes par l’irruption du temps mondial et les déséquilibres introduits par les formes multiples de l’intervention occidentale.