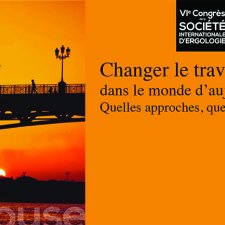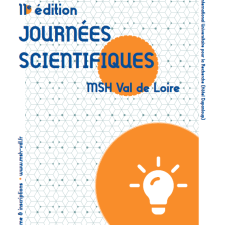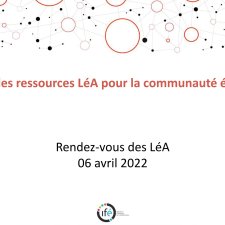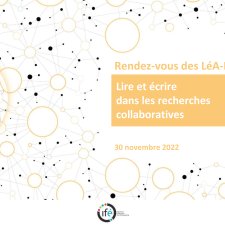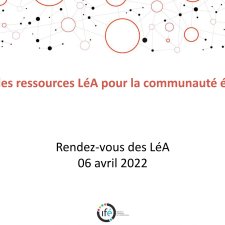Notice
Organologie de la sphère académique
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Bernard Stiegler - Directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou
Poser le problème du numérique dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est d'abord poser celui de l'organologie de la sphère académique dont le numérique est la dernière période. Bernard Stiegler définit le savoir académique, les conditions de sa production et de sa transmission et propose, pour que la France et l'Europe se saisissent réellement de ces enjeux, une démarche méthodique qui repose sur une nouvelle organologie académique numérique. Cette dernière s'appuie en premier lieu sur une politique massive de recherche sur le numérique, dans toutes les disciplines.
Repenser le système académique dans son ensemble
Universités, institutions de recherche ainsi que d'autres formes de sociétés savantes, comme Wikipédia, forment ce système académique que le numérique impose aujourd'hui de repenser. Il ne s'agit pas seulement de la question de la transmission mais aussi de celle de la genèse des savoirs que ce système est capable d'engendrer. L'organologie de la sphère académique a ainsi pour objectif d'étudier parallèlement les aspects physiologiques, techniques et sociaux qui interviennent dans la production des savoirs à l'heure du numérique.
Tout savoir académique est peer-to-peer, public et anamnésique
Un savoir académique est un savoir anamnésique, c'est-à-dire auquel on ré-accède. Pour pouvoir être réactivé, ce savoir doit nécessairement avoir été extériorisé et spatialisé ce qui le rend transmissible. C'est tout l'enjeu de la grammatisation, c'est-à-dire de la transformation des flux mentaux et corporels en extériorisations spatiales qui peuvent prendre des formes très différentes : peintures sur des parois rupestres, inscriptions hiéroglyphiques, livres, fichiers électroniques... Car en effet le savoir n'est reconnu comme tel qu'à la condition de s'exposer au regard des pairs (par exemple les docteurs de la même discipline) par le biais de la publication. La réflexion sur le savoir académique à l'heure du numérique entretient ainsi un lien essentiel avec les problématiques de l'industrie éditoriale. Mais à un autre niveau, la publication est aussi le résultat d'un processus essentiel dans la production des savoirs, celui de la controverse. Réactiver le savoir, c'est le réinterpréter, et toujours de manière polémique.
Un bon professeur est capable de ramener ses élèves aux origines du savoir qu'il transmet
L'école doit donc faire reparcourir aux élèves toute l'histoire des savoirs à différentes échelles en mettant en avant la notion de cursus, de parcours, de boucle de savoir. L'entrée dans le savoir ne peut se faire que par son origine ; du primaire au supérieur, l'enseignant introduit les élèves dans les conditions d'élaboration des savoirs qu'il veut transmettre, le met dans cette position idéale de celui qui viendra enchaîner sur ces savoirs, qui viendra les poursuivre en les interprétant.
Une nouvelle organologie académique numérique
Cette dynamique de boucle propre au savoir académique va à l'encontre de ce qu'on observe aujourd'hui en matière de catégorisation des savoirs. Les catégories sont des critères qui permettent d'organiser l'expérience et de la conceptualiser. Or, avec le numérique, le modèle de la causalité dans l'élaboration des savoirs laisse la place à celui de la corrélation. La catégorisation s'opère sans herméneutique, sans polémique. Il en résulte une organologie orpheline sur le plan de l'éthique et c'est d'ailleurs sur ce type d'organologie que se développent les MOOCs. Quelle alternative trouver à la catégorisation automatique par des algorithmes, d'autant plus que ce modèle se donne à voir comme une manière naturelle de traiter de l'information ? Bernard Stiegler propose la création d'un nouveau langage informatique qui permettrait l'indexation, l'annotation et l'éditorialisation contributives des différentes activités intellectuelles sur support numérique. Ce nouveau langage laisserait toute sa place à la confrontation autour des savoirs et donc à la genèse de leur production toujours renouvelée.
500 thèses sur le numérique, dans toutes les disciplines
Dans un même mouvement, il est fondamental d'étudier les effets du numérique sur ce savoir. Pour cela, il est nécessaire de faire preuve de méthode. Introduire le numérique à l'école sans l'avoir introduit à l'université n'est pas satisfaisant. Une politique massive de recherche sur le numérique, notamment dans le cadre des doctorats, doit être lancée. Ce saut épistémique majeur, caractérisé par des recherches contributives, menées sur des terrains de recherche-action, est essentiel pour la sphère académique toute entière, de l'université à l'industrie éditoriale.
Thème
Sur le même thème
-
Les invasions biologiques : quelles perceptions par le public ?
ArbieuHugoUgo Arbieu, chercheur post-doctorant à l'université Paris Saclay, montre dans cette vidéo l'intérêt de la culturomique pour étudier la perception sociale des invasions biologiques.
-
O trabalho docente frente à pandemia de COVID-19 : vivências, dramáticas dos usos-de-si e desenvolv…
CunhaDaisy MoreiraA pesquisa de doutoramento em curso intitulada “A atividade de trabalho docente no ensino fundamental frente à pandemia de COVID-19 : uma análise à luz da ergologia”, propõe realizar uma análise
-
Reconfigurations de l’aptitude à être affecté : de la réception à l’émancipation, Spinoza à l’épreu…
BaudeyMatthieuCe projet s’appuie sur une mission de terrain de quatre mois au Kazakhstan pendant laquelle il s’agit de mener des entretiens qualitatifs avec les membres de différents mouvements sociaux, culturels
-
JRSS 2022 - Session de clôture
Session de clôture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
JRSS 2022 - Session d'ouverture
Session d'ouverture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.
-
Repérer, coconstruire, reconnaître la valeur d’une recherche collaborative, enjeux de régulation po…
Mottier LopezLucieRepérer, coconstruire, reconnaître la valeur d’une recherche collaborative, enjeux de régulation pour les LéA et pour le Réseau des LéA-IFÉ
-
Conclusion du Rendez-vous des LéA-IFÉ 2021/2022
TrgalováJanaProduire des ressources LéA pour la communauté éducative
-
Lire et écrire dans les recherches collaboratives : RDV des LéA-IFÉ 2022/2023
PromonetAuroreLire et écrire dans les recherches collaboratives : RDV des LéA-IFÉ 2022/2023
-
Ouverture de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022
RiaLucPrieurMichèleOuverture de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022
-
Regard transversal sur les communications des LéA lors de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2…
NizetIsabelleRegard transversal sur les communications des LéA lors de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022
-
Produire des ressources LéA pour la communauté éducative
AlturkmaniMohammad DamesProduire des ressources LéA pour la communauté éducative
-
Ouverture institutionnelle de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022
Hérault-MoignardNathalieDarchy-KoechlinBrigitteBeaumontSophieOuverture institutionnelle de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022