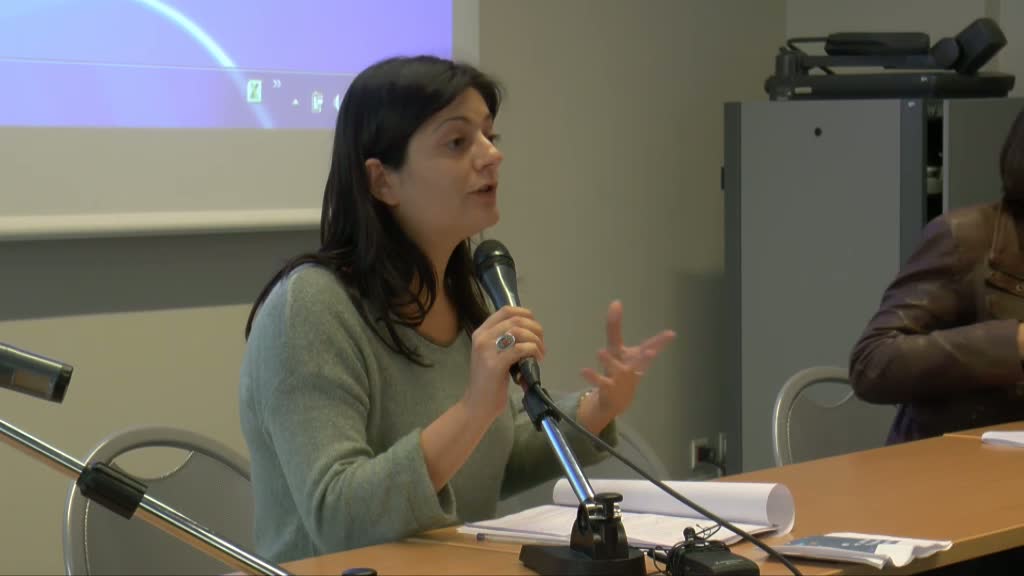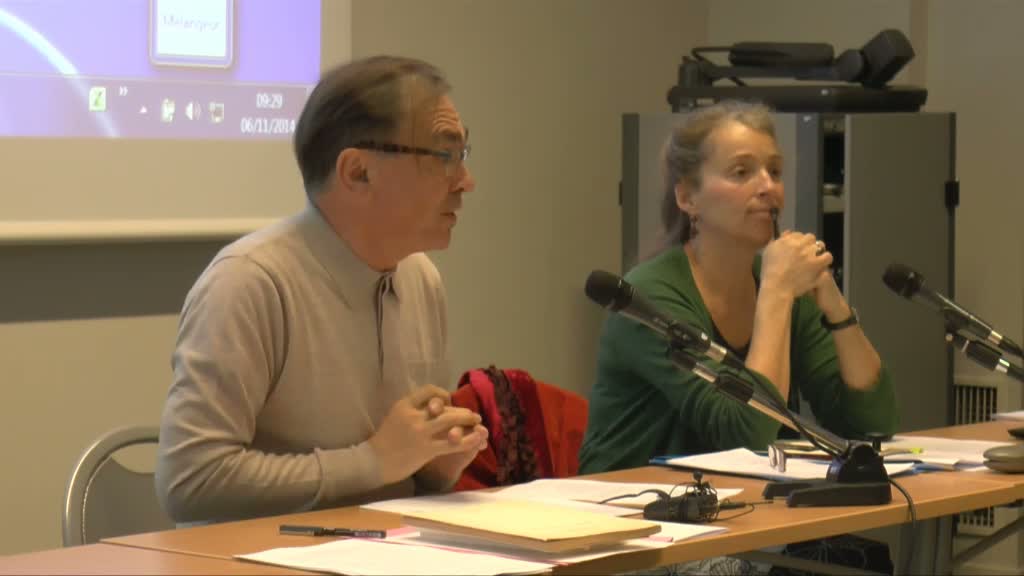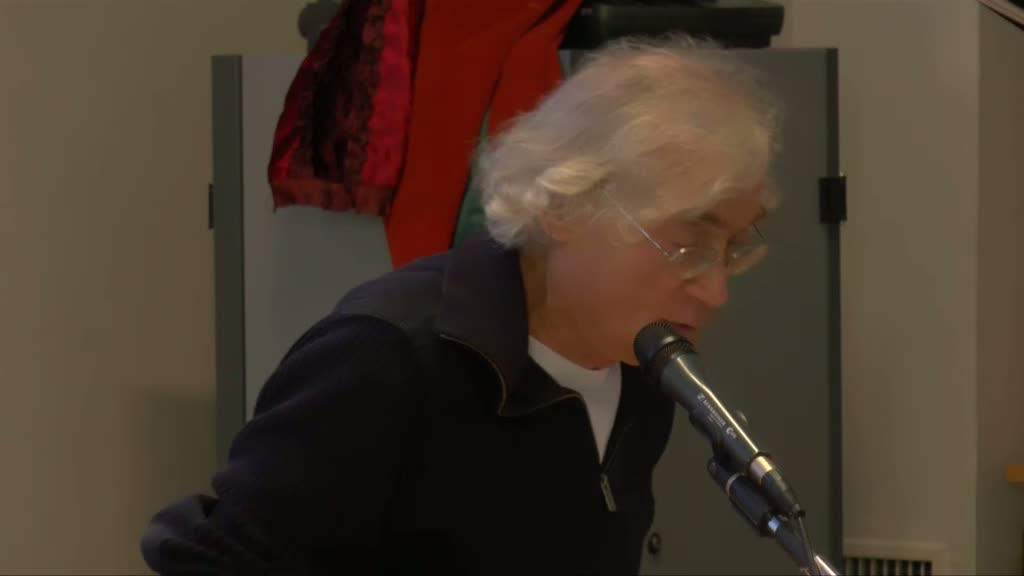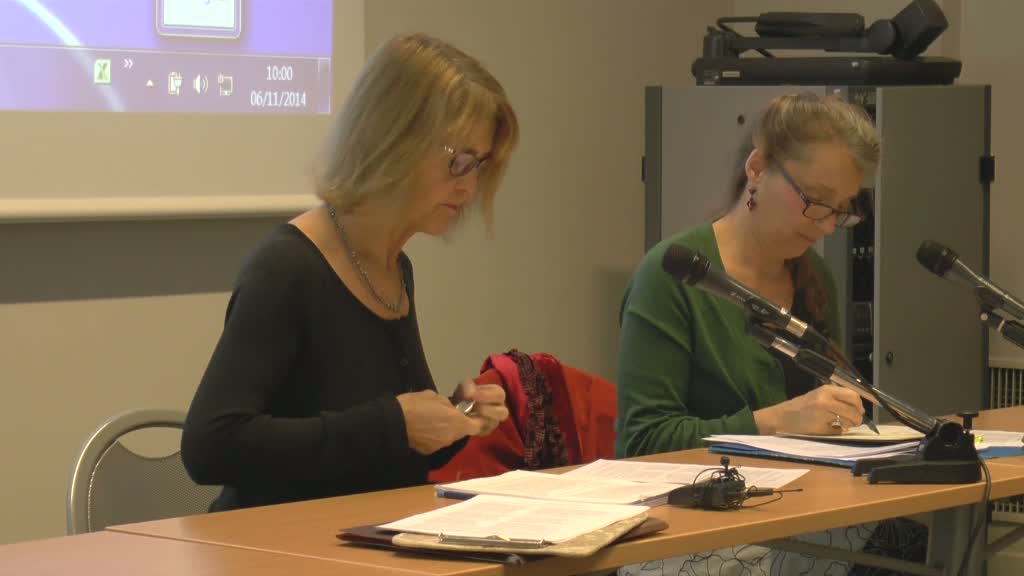L’inspiration au prisme des vies de poètes

Descriptif
À des époques et dans des civilisations différentes, les poètes se disent « inspirés » au moment de la création. Mais que signifie être « inspiré », par exemple, pour un aède de la Grèce Antique, un poète d’Afrique de l’ouest, un troubadour du Moyen-Age ou un barde himalayen ?
Cette journée d’étude a pour principal objectif de réfléchir à la notion d’inspiration et aux processus créateurs, à partir d’une approche ethno-biographique (Clifford 1978 ; Ferrarotti 1980 ; Momigliano 1998 ; Fabre 2010), qui apparait, à de nombreux égards, plus efficace pour cerner les questions cruciales et peu explorées liées à la création poétique, ainsi que les conceptions locales de l’inspiration poétique.
Si les études en littérature et poésie orale privilégient aujourd’hui l’analyse de la performance et de la création d’œuvres (entre autres, Tedlock 1983, Zumthor 1983, Baumgardt et Derive 2008, Baumgardt et Bornand 2009, Calame et al. 2010), rares sont les études qui interrogent les processus créateurs individuels (Casajus 2012, Dragani 2012, Leavitt 1997), les dimensions corporelles et sensorielles de l’inspiration ainsi que ses variations au cours de la vie ou encore l’impact qu'a l’acte créateur sur la construction de l’identité personnelle du poète (Fabre 1999, Dragani 2014).
En partant des données fournies par les récits de vie des créateurs, nous interrogerons les perceptions et les manifestations physiques de l’inspiration, les contextes privilégiés (lieux sacrés, solitude, obscurité, rêves, etc.), les agents non humains (esprits, ancêtres, animaux totémiques, etc.) ou les vecteurs de propriétés particulières (substances hallucinogènes, alcools, fluides sanguins, salives, etc.).
La comparaison entre d’anciennes biographies (les bioi grecques, vitae latines, vidas mediévales, etc.) et des biographies produites de nos jours par l’interaction entre le chercheur et le poète vivant (Dosse 2011) permet-elle de mettre la notion de « destin de poète » en perspective? L'analyse des biographies de créateurs peut-elle mettre en lumière d'éventuels invariants dans les dynamiques sociales et psychologiques à l’origine de la création ? Quels sont les apports d’une approche biographique à la connaissance du lien entre procédés poétiques et guérison chamanique, rêves, techniques thérapeutiques, transe ou possession (Belmont 2002, Leavitt 1997, Seppilli 1962) ?
Responsabilité Scientifique
Sandra Bornard (CNRS-LLACAN)
Amalia Dragani (IIAC-MQB, LabEx CAP)
Vidéos
Amalia Dragani (LABEX Création-Patrimoine, iiAC) : « Sang, rêve et maladie : biographies diurnes et…
Amalia Dragani (LABEX Création-Patrimoine, iiAC) : « Sang, rêve et maladie : biographies diurnes et nocturnes de poètes touaregs »
Synthèse par Jean Derive
Cette journée d'étude se termine par une synthèse de Jean Derive (LLACAN)
Serge Martin : Gestes du « vivre poème” dans l’œuvre de trois poètes de langue française nés dans l…
En lisant les œuvres de Henri Meschonnic (1932-2009), James Sacré (né en 1939) et Bernard Vargaftig (1934-2012), on peut observer comment dans ces trois œuvres s’opère un retournement du formalisme
Corinne Fortier (CNRS, LAS) : « L’inspiration poétique amoureuse des poètes maures de Mauritanie »
La Mauritanie est connue pour être le pays au million de poètes. Tout le monde est poète dans la société maure dans la mesure où personne ne l'est réellement, parce que la poésie n'est pas de l
Maria Manca (Université Paris Diderot) « Quand le poète s’inspire de la vie exemplaire des saints …
En Sardaigne, lors des fêtes patronales, des improvisateurs s’affontent au cours d’une joute poétique (gara poetica) offerte en don au saint patron du village, afin d’obtenir sa protection. Sur la
John Leavitt (Université de Montréal) : « Poètes inspirés et inspirants dans deux traditions de lan…
Les mots pour désigner le poète dans les langues du monde le présentent souvent soit comme un artisan du langage—rhapsodos grec ou "maker" écossais, ou bien le mot grec poietes lui-même, 'faiseur'
Dominque Casajus (CNRS. IMAF) : « Titre: Saudade, solitude et mélancolie »
Le maître mot de la poésie touarègue classique est esuf, un terme qui, par certaines de ses acceptions, se rapproche du français "solitude", lequel désigne lui aussi le sentiment du délaissé tout
Leili Anvar (INALCO) « Tu poseras tes lèvres sur les nôtres » : érotique de l’inspiration dans l’œu…
La question de l'inspiration se pose de manière particulièrement aigüe en littérature mystique persane car de la source de l'inspiration dépend la validité et la valeur du texte poétique. En effet,
Sylvie Perceau (Université de Picardie-Jules Verne, TRAME) « Muses, inspiration, création dans la p…
On a l’habitude d’assimiler l’inspiration des poètes épiques archaïques à la figure de la Muse ou des Muses. Or à l’épreuve du « texte » homérique, cette identification n’est pas satisfaisante :