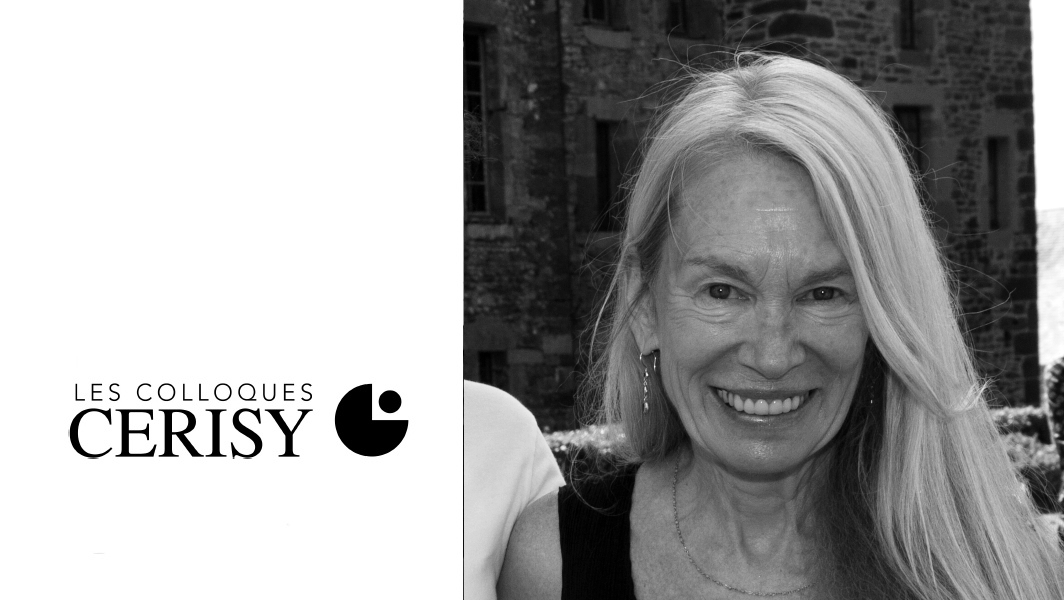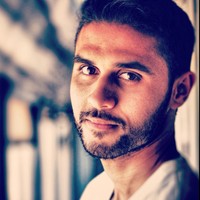Notice
MRSH Caen
L’a priori et l’idéalisme moderne
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été enregistrée dans le cadre du séminaire de l'équipe Identité et subjectivité , dont le thème de l'année 2021-2022 porte sur l'a priori.
Jocelyn Benoist est professeur de philosophie à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne. Médaille d’argent du CNRS en 2019. Eminent spécialiste de la phénoménologie husserlienne notamment, à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages, et de la philosophie analytique ou philosophie du langage qu’il a fait dialoguer avec la première, il développe, depuis les années 2000, ses recherches autour d’un réalisme contextualiste, inspiré notamment par le philosophe Charles Travis, qui s’oppose au réalisme spéculatif ou métaphysique. Son dernier livre en date : Toward a contextual realism (Harvard University Press, 2021).
Résumé de la communication
Dans cette conférence donnée le 2 février 2022 dans le grand amphi de la MRSH, Jocelyn Benoist, en prenant l’exemple des deux régimes de preuves de l’existence de Dieu dans la Somme théologique de saint Thomas, a souligné que la question de l'a priori est au croisement de la question épistémique et de la question ontologique. En donnant à la question de l'a priori un sens nouveau et décisif, la “révolution copernicienne” kantienne l'articule à l'empirisme et à la réceptivité du sujet: l'a priori est alors définitivement lié au “donné” et au primat du sujet. Mais s’il acquiert également une connotation nettement épistémique, il conserve pourtant une dimension ontologique (jugement synthétique a priori, statut de la phénoménalité dans l’esthétique transcendantale). Et la question massive du XXème siècle philosophique s'est caractérisé, selon J. Benoist, par une tentative de réontologiser l'a priori, au risque de rendre le concept équivoque, qu'il s'agisse de la voie de l'essentialisme (dans sa version phénoménologique avec l'a priori matériel husserlien, ou sa version analytique avec une philosophie comme celle de Kit Fine), ou de la voie du réalisme modal (dans sa version meinongienne ou kripkéenne). Qu’appelle- t-on le “donné”? En interrogeant à la manière radicale d'Austin, dans un texte de 1939, ce « donné » (the given), le réalisme contextualiste de Jocelyn Benoist montre que nous ne sommes pas encore libérés du mythe du donné, et de sa grammaire philosophique.
Thème
Sur le même thème
-
Entretien avec Astrid Lac
LacAstridEntretien avec Astrid Lac, professeur invitée dans le cadre du Programme de Recherche Interdisciplinaire : Les sciences sociales et le monde
-
La loi de l'attraction passionnée de Charles Fourier : un nouveau paradigme des sciences sociales
AntoineMaudeEntretien avec Maude Antoine réalisé par Nicolas Rault dans le cadre du programme pluriannuel de formation à l'audiovisuel (PPF-INOVA)
-
Francisco Varela et la conversation transformatrice
L'Institut Mind and Life et son organisation sœur, Mind and Life Europe, sont le fruit du dialogue entre le neuroscientifique Francisco Varela et Tenzin Gyatso, le quatorzième Dalaï-lama. Les
-
Écopoétique et résonance chez Glissant
Cette communication s'interroge sur l'écopoétique dans l'œuvre de Glissant à partir du concept de la résonance. Glissant propose une écopoétique ancrée dans la matérialité concrète du paysage, menant
-
La question de l'affectivité chez Marc Richir
L'objectif de cette intervention était de présenter — dans ses grandes lignes — la "phénoménologie de l'affectivité" de Marc Richir. Son idée de base est que nous vivons en permanence, dans les
-
Transhumanisme entre éthique, responsabilité et créativité
Dans un contexte d'intérêt croissant et de positionnements contrastés sur le transhumanisme, un cycle de séminaires plurisdisciplinaires est organisé par le Pôle Risques avec comme objectif de
-
Patočka et la question du sujet
Cette conférence inaugurale d’Émilie Tardivel met en lumière que, selon Patočka, le monde est nécessairement donné comme une totalité et possède une structure d’horizon, même si tout n’est pas donné
-
L’enjeu d’une phénoménologie politique : Patočka et Beauvoir
Dans le cadre du colloque sur le philosophe tchèque Jan Patočka, Natalie Depraz met en lumière comment Patočka met en place une phénoménologie politique. Dans une confrontation entre la philosophie de
-
La reprise de la Physique d’Aristote par Patočka et ses conséquences pour le projet de phénoménolog…
Cette conférence proposée dans le cadre du colloque sur Jan Patočka montre l’originalité de la perspective phénoménologique de Patočka, notamment dans son rapport avec la pensée d’Eugène Fink. En
-
Histoire et conservation de la vie : d’un principe de la philosophie de l’histoire Patočkienne
Roberto Terzi interroge la question de l’historicité dans la philosophie de Patočka. Cette conférence prononcée dans le cadre du colloque sur la pensée de Patočka interroge l’historicité de la vie
-
Patočka et le tragique
Cette conférence de clôture du colloque sur le philosophe tchèque Jan Patočka, qui s'est déroulé à la MRSH de Caen les 23 et 24 mars 2022, montre comment dans sa lecture d’Antigone Patočka se démarque
-
Il n’y a de pratique créatrice qu’inspirée : le sentiment dans L’inventaire des a priori de Mikel D…
Dans sa conférence du 30 mars 2022, Charles Bobant retrace les différentes étapes de la phénoménologie dufrennienne du sentiment jusqu’à L’inventaire des a priori. Dans Phénoménologie de l’expérience