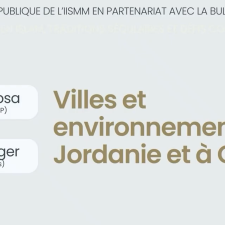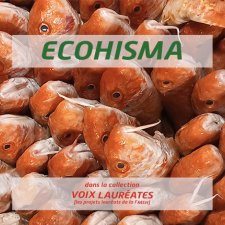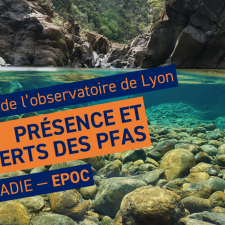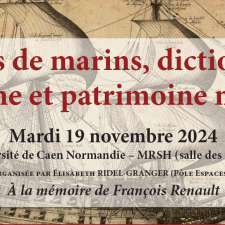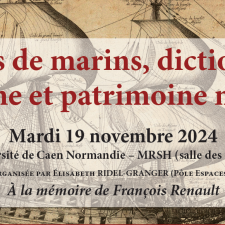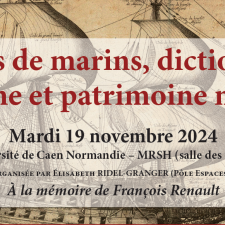Notice
MRSH Caen
Pêche et surpêche au cours des siècles
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été prononcée dans le cadre du séminaire annuel du pôle maritime de la MRSH, dont les thématiques 2010-2011 concernent les ressources marines.
Denis Binet, océanographe biologiste, a été directeur de recherches à l'IRD (Institut de Recherches pour le Développement) . Il a effectué des travaux sur l'écologie du zooplancton tropical à Madagascar et en Afrique (1965-1975) et sa thèse a porté sur l'écologie du zooplancton de Côte d'Ivoire (1977). En Nouvelle-Calédonie (1978-1983), il étudie le zooplancton lagonaire, et constate l'importance d'El Niño sur les écosystèmes marins.
En 1984, il lance le programme « Climapêche » avec l'Ifremer, à Nantes, afin d'étudier cette relation à une échelle plus large. Il poursuit des recherches sur l'histoire des pêches pour voir le rôle des changements climatiques sur les captures de sardine, hareng, thon, morue à partir des archives et statistiques du XVIIIe au XXe siècle. Ses travaux avec l'Orstom, au cours des périodes contemporaines, montrent une forte variabilité des pêcheries de sardine, sardinelle, maquereau, chinchard dans les eaux africaines, en phase avec les variations des alizés, des courants océaniques et des événements de type El Niño dans l'Atlantique.
En retraite depuis 2003, Denis Binet revient à l'histoire maritime (projet de publication des procès-verbaux des visites de Le Masson du Parc avec le CRHQ, étude historique de la surpêche) ainsi qu'à l'ethnographie navale.
Résumé
L'exploitation d'une ressource marine vivante au delà de ses possibilités de régénération intervient dès qu'un effort de pêche intense s'exerce sur elle. Depuis 1985 environ, les débarquements mondiaux de poissons et invertébrés marins stagnent vers 85 millions de tonnes, malgré une multiplication du nombre de navires de pêche. La surexploitation halieutique, limitée aux côtes des pays les plus développés jusqu'aux années 1970, est donc devenue mondiale. Les méthodes scientifiques de gestion des stocks ont été un échec. D'une part, le concept, très théorique, de « prise maximale équilibrée » a permis un emballement de l'industrie halieutique, générateur de surpêche. D'autre part, les données sur lesquelles se basent les modèles de production, les quantités capturées, étaient sous-estimés et ne tenaient pas compte des rejets (10 à 90 % des captures). Enfin, les innovations techniques incessantes accroissent insidieusement l'effort de pêche et biaisent les estimations de rendement. L'accroissement des prix et les subventions publiques empêchent une régulation économique par arrêt de la pêche et contribuent, en facilitant le renouvellement des navires, à aggraver la surpêche. L'ensemble de l'écosystème marin est perturbé par la disparition des prédateurs terminaux, l'accroissement relatif de poissons plus jeunes et de niveaux trophiques intermédiaires. La résilience des stocks en est diminuée, et l'instabilité de tout l'écosystème accrue.
On sait désormais que les récits faisant état d'abondances extraordinaires, avant le développement des pêches, ne relèvent pas du mythe. Le niveau des stocks vierges était incomparablement élevé. Mais des pêcheries anciennes les ont, localement, considérablement amoindries. L'archéozoologie montre que dans le nord de la France, les espèces dulçaquicoles ne suffisent plus à la consommation au XIe siècle. Elles sont presque totalement remplacées par des poissons de mer à partir du XIVe siècle. Les premiers signes de surexploitation ne tardent pas. Les sécheries de poisson situées à la pointe de la Bretagne, perdent de leur valeur à partir du début de la grande pêche morutière. C'est dire que les ressources en congre, raie et surtout merlu n'étaient plus florissantes. Sinon, aurait-on pris le risque d'aller pêcher outre-Atlantique ? La pêche à la morue illustre la progression de la surexploitation, avant la pratique du chalutage à vapeur. Au XVIe et XVIIe siècles les rendements sont excellents et la pêche se pratique surtout à partir de bases à terre (pêche sédentaire). Au XVIIIe siècle des crises apparaissent, la perte du Canada et de Terre-Neuve n'en sont pas les seules responsables puisque nous conservons le French shore. Les armements à la pêche errante (sur les bancs) deviennent de plus en plus nombreux, indice probable de la raréfaction des morues près des côtes. Les catégories de taille recouvrent, sous des appellations inchangées, des poissons de plus en plus petits. Après la Restauration, les pêches reprennent avec de nouvelles techniques. Les marins qui, autrefois, se tenaient le long du bordage de leur navire, chacun une ligne à la main, embarquent désormais dans une ou deux chaloupes pour mouiller des palangres autour du navire. Après 1875, les doris remplacent canots et chaloupes et accroissent encore la puissance de pêche individuelle. Un pêcheur qui tenait une ligne montée d'un seul seul hameçon au XVIe siècle, en manipule un millier au début du XXe siècle. La puissance de pêche, à nombre de marins constant, a été multipliée par 1 000. Et le poids moyen des morues débarquées à Fécamp de 1815 à 1900 est divisé par trois, signe incontestable de surexploitation.
La législation de l'Ancien Régime montre un constant souci de préserver les premiers stades du poisson (blanche, mélie, blaquet) dont il était fait un grand gaspillage dans les pêcheries littorales ; elle manifeste aussi une inquiétude pour les fonds bouleversés par les engins traînants (dreige, drague, ganguy), sans arriver à les interdire durablement. C'est d'ailleurs dans le golfe du Lion, surexploité par ces engins, qu'apparaissent de fortes baisses de rendement dès le début du XIXe siècle. Sur les côtes de l'Atlantique la surexploitation ne se fait gravement sentir qu'à la fin du siècle. En Grande Bretagne, l'idée que les ressources marines ne sont pas illimitées apparaît vers 1890, étayée par des calculs montrant la baisse de rendement des flottilles de smacks et de chalutiers à vapeur en mer du Nord.
L'exploitation halieutique s'est exercée dans les eaux intérieures puis sur l'estran et dans les eaux littorales. Quand ces fonds se sont épuisés, elle a progressivement gagné tout le plateau continental et des mers de plus en plus lointaines, grâce à l'amélioration des bateaux et des techniques de pêche. Mais aujourd'hui il n'y a plus de stocks à découvrir, tous sont exploités ou surexploités.
Pour en savoir plus :
-
BINET (D.), COUTANCIER (B.), 1989, « Les pêches côtières françaises sous la Restauration d'après les statistiques de 1814 à 1835. 1re partie », Équinoxe, n° 27, p. 44-51.
-
BINET (D.), COUTANCIER (B.), 1989, « Les pêches côtières françaises sous la Restauration d'après les statistiques de 1814 à 1835. 2e partie », Équinoxe, n° 28, 39-51.
-
BINET (D.), 1999, Les Pêches côtières de la baie du Mont-Saint-Michel à la baie de Bourgneuf au début du XIXe siècle, Ifremer, 186 p., tabl., illustr.
-
BINET (D.), 2007, « Évolution des techniques de pêche à Terre-Neuve et réduction des stocks de morue dès le XIXe siècle », dans Troisièmes journées d'histoire de la Grande Pêche (Granville, 18-19 mars 2005), St-Lô, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Manche (Études et documents, t. 25), p. 68-107.
Thème
Sur le même thème
-
La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre
GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...
-
Villes et environnement en Jordanie et à Oman
AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).
-
ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-X…
VermerenHugoProjet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une
-
Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.
Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud
-
Les océans ont une histoire !
HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH
-
Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques
LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation
-
Produits de la mer durables : quel rôle de l'information ?
LucasSterennSterenn Lucas, Maître de Conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de l'information, pour les consommateurs, relative aux produits de la mer.
-
Quels enjeux de durabilité en aquaculture ?
SadoulBastienBastien Sadoul, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo des enjeux de durabilité de l'aquaculture.
-
Les espaces marins au-delà des juridictions sont-ils un bien commun ?
QueffelecBettyBetty Queffelec, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la notion de bien commun appliquée à l'océan.
-
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
-
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.
-
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.