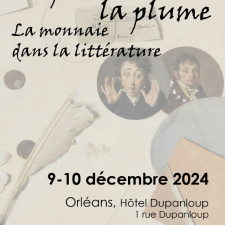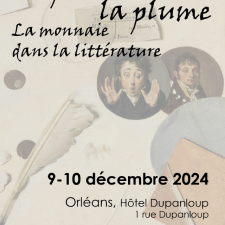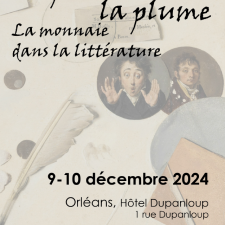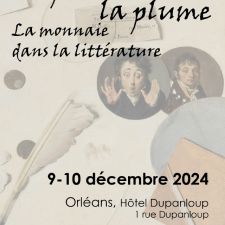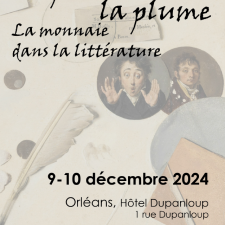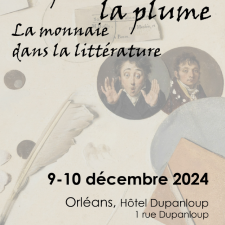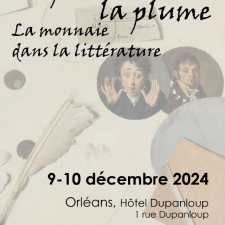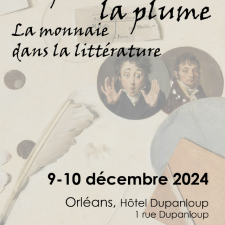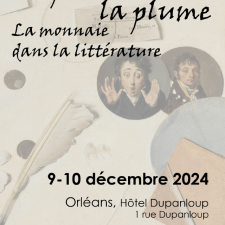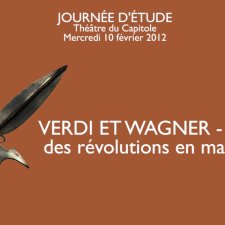Notice
L'aureus de Tibère d'Arthur Machen (1895) - monnaie fictive, débauches romaines et horreur gothique
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Comment l’invention d’une monnaie romaine peut servir d’assise matérielle à un récit horrifique ? Pivot du roman fantastique d’Arthur Machen (1863-1947) Les trois imposteurs, « l’aureus de Tibère » est une monnaie fictionnelle frappée d’un faune et commémorant une affreuse nuit d’orgie présidée par le célèbre empereur. Le roman raconte l'histoire de trois étrangers à la recherche d'un jeune homme « portant des lunettes » dans la Londres de l’époque édouardienne. Ce dernier s’est en effet rendu coupable du vol du fameux aureus, une relique vénérée par le culte ancestral auquel appartiennent les trois poursuivants. Ceux-ci interrogent tour à tour deux dandys – Dyson et Phillipps – leur comptant une suite d’histoires plus étranges les unes que les autres, convaincus que les deux protagonistes pourraient finir par les mettre sur la piste de l’homme aux lunettes. Le motif historiographique de la débauche des empereurs, matérialisé par la monnaie, sert ici de fondement tangible à la construction d’une fiction horrifique donnant chair aux faunes, satyres et autres créatures folkloriques. Un siècle plus tôt, les ouvrages du Baron d’Hancarville « Monumens de la vie privée des douze Césars » (1780) et « Monumens du culte secret des dames romaines » (1784) font usage de ces mêmes procédés – objets fictionnels (ici, des intailles inventées de toute pièce et illustrées) et orgies romaines – pour la construction de pastiches licencieux rédigés dans le goût des antiquaires du XVIIIe siècle. Prenant comme fondement une analyse du motif de l’aureus de Tibère dans la nouvelle Les trois imposteurs, nous nous intéresserons aux usages littéraires et narratifs d’une monnaie antique fictive.
Thème
Dans la même collection
-
Valeur objectale de la monnaie chez Tolstoï : quelques pistes à partir du Faux coupon
Noël-LemaitreChristineSi le rôle de l’argent dans les romans de Dostoïevski a pu susciter de nombreuses études, qui ont souligné la dimension omniprésente de la monnaie dans ses écrits (voir notamment Ollivier, 1971 ou
-
La circulation de la monnaie à travers les arts
PoirsonMartialL’ambition du colloque est de créer les conditions de dialogues interdisciplinaires en étudiant la place de la monnaie dans les sources littéraires à la fois au moyen d’une approche « documentaire »,
-
La valeur de la pièce rompue - une coutume de fiançailles dans la littérature anglaise
Vickermann-RibémontGabrielePeut-être en réminiscence de l’ancien sumbolon, morceau de poterie cassée en deux dont les parties devaient identifier les deux partenaires d’un contrat, on trouve dans la littérature anglaise des
-
La monnaie sur la scène irlandaise de Lady Gregory à Marina Carr
Roche-TiengoVirginieDans Ulysse (1922) de James Joyce, Leopold Bloom a 4 shillings et 9 pense en poche lorsqu’il quitte sa maison le 16 juin 1904. Car pour James Joyce, tout écrivain digne de renom se doit de connaître
-
La moneta di Akragas. La monnaie comme objet de fascination et de collection
LeblancThomasLiminaValentinaLa communication se fonde sur La moneta di Akragas (2011) écrit par Andrea Camilleri. Le premier chapitre ramène le lecteur au siège d’Agrigente par les Carthaginois (406 aCn).
-
Un monstre à Paris. L'image de l'assignat dans Le Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier (1798)
GIROTCyrielleL’assignat est le second échec de monnaie fiduciaire, après l’expérience de Law (1716-1720), mis en place en France entre 1789 et 1797 pour tenter d’éviter la banqueroute. Issu de la nationalisation
-
L'ombre de Persée : médaille et écriture historique dans l'Europe des Lumières
PinaultClémentLe 29 mai 1717, Mary Wortley Montagu écrit à Antonio Conti pour lui annoncer qu’elle vient d’acquérir, à Constantinople, une médaille du roi Persée. La communication propose d’interroger le regard
-
La pièce au cocher. Grammaire du geste monétaire dans le Paris de la Belle Époque chez Paul Bourget…
Ancelet-NetterDominiquePayer avec quelques pièces de monnaie est un des rares gestes qui mette en contact les gens du monde avec des personnes subalternes qui ne soient pas leurs domestiques. Parmi ceux-ci, les cochers des
-
Jeux de mots et de monnaies : autour du Dit du Florin de Jean Froissart
BompaireMarcLa diversité des monnaies circulant à la fin du Moyen Âge et leurs noms et surnoms imagés ont fourni la matière à des exercices de style comme le « Cri des monnaies » de Jehan Molinet où il est encore
-
La pièce et l'allégorie : tradition littéraire et réflexion 'économique'. Le Songe du Vieil Pelerin…
RibémontBernardLe Songe du vieil pèlerin est un ouvrage particulièrement complexe, qui, sous forme allégorique, traite de multiples problèmes, en particulier politiques et juridiques relatifs au royaume. Philippe,
-
Retrouver des monnaies dans les tombeaux de ses aïeux : réflexions autour de deux mythes évoquant d…
DucheminJean-PatrickEn dehors des quelques évocations mythologiques renvoyant au paiement d’une traversée payé au passeur grec des Enfers, Charon, les textes évoquant l’existence de monnaies déposées en contexte de
-
Victor Hugo et "Les Misérables" : mise en boîte
SchmittLaurentBOURBONXavierTHERETPhilippe« Les Misérables » sont une source inépuisable de référence à la monnaie. Le passage au système décimal à la Révolution n’a pas fait disparaître de notre vocabulaire courant, les sous qui y figurent
Sur le même thème
-
La légende de Tannhäuser réinterprétée par Ludwig Tieck (1799) : la puissance obsédante du sentimen…
KnopperFrançoiseVerdi et Wagner ont toujours affiché l’intention d’engager un processus de révolution au sein de l’opéra, révolution aussi bien idéologique qu’esthétique. 'Tannhäuser' (1845) et 'Il trovatore' (1853)