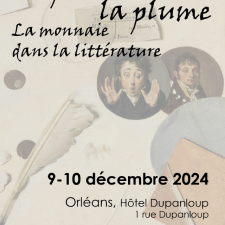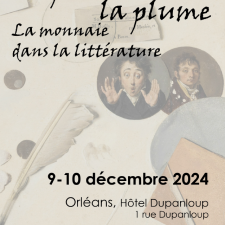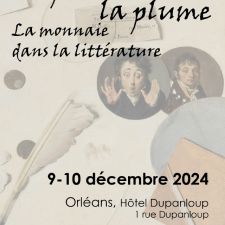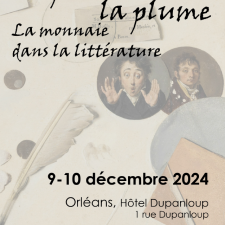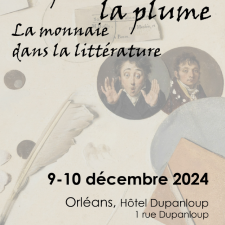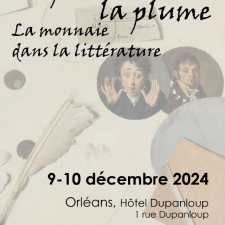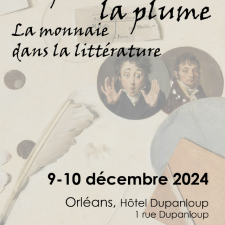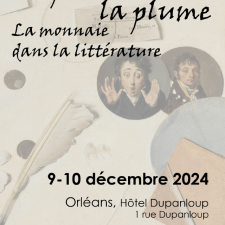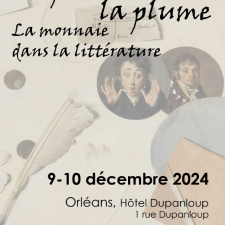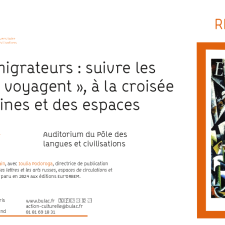Notice
Valeur objectale de la monnaie chez Tolstoï : quelques pistes à partir du Faux coupon
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Si le rôle de l’argent dans les romans de Dostoïevski a pu susciter de nombreuses études, qui ont souligné la dimension omniprésente de la monnaie dans ses écrits (voir notamment Ollivier, 1971 ou encore Haddad 2014), peu d’études se sont intéressées à la place de la monnaie dans l’œuvre de Tolstoï. Le romancier russe fut pourtant, à la fin de sa vie, l’auteur de plusieurs textes dans lesquels il expose sa critique des inégalités sociales de son temps et la place mortifère de l’argent dans un système qui confine à « l’exploitation et à la violence ». Dans les textes rassemblés sous le titre L’Argent et le Travail, qui furent publiés pour la première fois en 1892 aux éditions Flammarion grâce au travail de compilation réalisé par Ely Halpérine-Kaminsky, préfacés par Emile Zola, Tolstoï identifie ce qui constitue à ses yeux le problème central de la société russe de la fin du dix-neuvième siècle à savoir l’argent, symptôme et moyen d’asservissement du peuple.
Notre étude s’intéresse au statut de la monnaie comme objet dans les textes littéraires (romans et nouvelles) de Tolstoï en se concentrant sur une de ses dernières nouvelles, relativement peu connue, Le Faux-Coupon. Cette nouvelle d’une centaine de pages au rythme saccadé met en scène un ensemble d’acteurs réunis par les conséquences en chaîne de la circulation d’un faux coupon écoulé par un fils de bonne famille. Tolstoï ne s’appesantit pas sur les personnages qui se succèdent rapidement. Leur psychologie est à peine esquissée et ce qui les pousse à l’action est pour ainsi dire occulté. L’écrivain se contente de relater une succession d’événements affectant ceux qui ont à subir les conséquences du comportement malhonnête de Mitia. Le jeune homme a falsifié un coupon afin de rembourser une dette contractée auprès d’un ami. Le rythme rapide du récit accentue la force d’une parabole visant à montrer qu’aucune action n’est insignifiante et que l’homme est responsable de toutes les conséquences qui peuvent en découler sans qu’il soit possible de les imaginer a priori et encore moins de les anticiper toutes. Dans cette nouvelle le faux-coupon constitue un personnage crucial passant de mains en mains et apportant le malheur avec lui. Notre analyse mettra en relation la place particulière de ce faux-coupon avec le statut usuel que le romancier octroie aux objets dans ses autres œuvres, statut appréhendé comme foncièrement négatif selon les spécialistes de littérature russe à l’instar de Luba Jurgenson et Laure Troubetzkoy. Les objets décrits ou mis en scène par Tolstoï perdraient leur valeur d’usage pour mieux souligner les vérités immatérielles que l’auteur veut exprimer. Nous proposons ainsi en prêtant attention au statut et à la représentation de la monnaie dans le Faux Coupon de souligner sa portée éminemment critique et philosophique faisant écho aux analyses proposées dans L’argent et le Travail.
Dans la même collection
-
La circulation de la monnaie à travers les arts
PoirsonMartialL’ambition du colloque est de créer les conditions de dialogues interdisciplinaires en étudiant la place de la monnaie dans les sources littéraires à la fois au moyen d’une approche « documentaire »,
-
La valeur de la pièce rompue - une coutume de fiançailles dans la littérature anglaise
Vickermann-RibémontGabrielePeut-être en réminiscence de l’ancien sumbolon, morceau de poterie cassée en deux dont les parties devaient identifier les deux partenaires d’un contrat, on trouve dans la littérature anglaise des
-
La monnaie sur la scène irlandaise de Lady Gregory à Marina Carr
Roche-TiengoVirginieDans Ulysse (1922) de James Joyce, Leopold Bloom a 4 shillings et 9 pense en poche lorsqu’il quitte sa maison le 16 juin 1904. Car pour James Joyce, tout écrivain digne de renom se doit de connaître
-
La moneta di Akragas. La monnaie comme objet de fascination et de collection
LeblancThomasLiminaValentinaLa communication se fonde sur La moneta di Akragas (2011) écrit par Andrea Camilleri. Le premier chapitre ramène le lecteur au siège d’Agrigente par les Carthaginois (406 aCn).
-
Un monstre à Paris. L'image de l'assignat dans Le Nouveau Paris de Louis Sébastien Mercier (1798)
GIROTCyrielleL’assignat est le second échec de monnaie fiduciaire, après l’expérience de Law (1716-1720), mis en place en France entre 1789 et 1797 pour tenter d’éviter la banqueroute. Issu de la nationalisation
-
L'ombre de Persée : médaille et écriture historique dans l'Europe des Lumières
PinaultClémentLe 29 mai 1717, Mary Wortley Montagu écrit à Antonio Conti pour lui annoncer qu’elle vient d’acquérir, à Constantinople, une médaille du roi Persée. La communication propose d’interroger le regard
-
La pièce au cocher. Grammaire du geste monétaire dans le Paris de la Belle Époque chez Paul Bourget…
Ancelet-NetterDominiquePayer avec quelques pièces de monnaie est un des rares gestes qui mette en contact les gens du monde avec des personnes subalternes qui ne soient pas leurs domestiques. Parmi ceux-ci, les cochers des
-
Jeux de mots et de monnaies : autour du Dit du Florin de Jean Froissart
BompaireMarcLa diversité des monnaies circulant à la fin du Moyen Âge et leurs noms et surnoms imagés ont fourni la matière à des exercices de style comme le « Cri des monnaies » de Jehan Molinet où il est encore
-
La pièce et l'allégorie : tradition littéraire et réflexion 'économique'. Le Songe du Vieil Pelerin…
RibémontBernardLe Songe du vieil pèlerin est un ouvrage particulièrement complexe, qui, sous forme allégorique, traite de multiples problèmes, en particulier politiques et juridiques relatifs au royaume. Philippe,
-
Retrouver des monnaies dans les tombeaux de ses aïeux : réflexions autour de deux mythes évoquant d…
DucheminJean-PatrickEn dehors des quelques évocations mythologiques renvoyant au paiement d’une traversée payé au passeur grec des Enfers, Charon, les textes évoquant l’existence de monnaies déposées en contexte de
-
Victor Hugo et "Les Misérables" : mise en boîte
SchmittLaurentBOURBONXavierTHERETPhilippe« Les Misérables » sont une source inépuisable de référence à la monnaie. Le passage au système décimal à la Révolution n’a pas fait disparaître de notre vocabulaire courant, les sous qui y figurent
-
L'aureus de Tibère d'Arthur Machen (1895) - monnaie fictive, débauches romaines et horreur gothique
CharreyPierreQUÉRÉJulieComment l’invention d’une monnaie romaine peut servir d’assise matérielle à un récit horrifique ? Pivot du roman fantastique d’Arthur Machen (1863-1947) Les trois imposteurs, « l’aureus de Tibère »
Sur le même thème
-
Dostoïevski, de la consolation à la compensation
FeuilleboisVictoire"Dostoïevski veut guérir": voilà comment E-M de Voguë présentait le romancier russe aux premiers lecteurs de l'œuvre. Depuis, l'accent a été mis dans la critique sur le caractère inconsolable des
-
Concepts migrateurs : suivre les idées « qui voyagent », à la croisée des disciplines et des espaces
PodorogaIouliaMadelainAnneRichardotElenaCette rencontre avec Ioulia Podoroga, directrice de publication de l'ouvrage Concepts migrateurs : les lettres et les arts russes, espaces de circulations et métamorphoses (XVIIIe-XXe siècles), paru
-
Rencontre avec Andreï Kourkov. Discussion autour du Jardinier d’Otchakov - Rencontres autour du liv…
КурковАндрей ЮрьевичAndreï Kourkov est de passage à Paris à l'occasion de la parution de son nouveau roman le Jardinier d'Otchakov aux éditions Lian Levi. C'est Christine Mestre, directrice du prix Russophonie et des