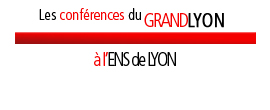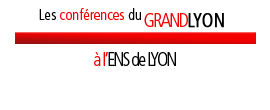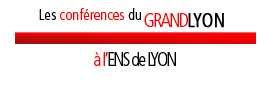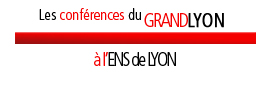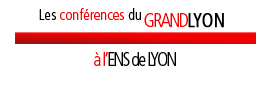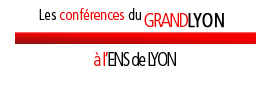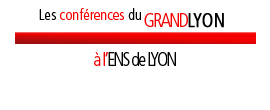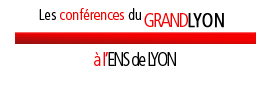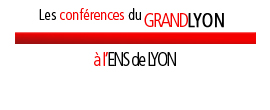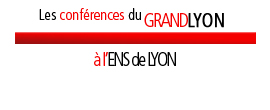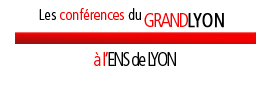Wormser, Gérard (1957-....)
Philosophe et éditeur, fondateur et directeur de la revue électronique internationale Sens Public et de son laboratoire « Editorialisation des SHS » à la MSH-Paris-Nord.
Membre du comité de rédaction des Temps modernes, Gérard Wormser est agrégé et docteur en philosophie.
A l'ENS de Lyon, il anime depuis 2005 un cycle permanent de conférences en partenariat avec le Grand Lyon, dont procèdent les entretiens filmés disponibles sur CanalU.
Spécialisé en phénoménologie, morale et politique, il a soutenu une thèse sur Jean-Paul Sartre.
Il préside le jury de la Bourse Max Lazard à Sciences Po. Paris.
Il est à l'origine de nombreux colloques, dont : La Représentation du Vivant, ENS-Lyon, nov. 2002, Tolérance et Différence, Slovaquie, 2006, L'internet, entre savoirs, espaces publics et monopoles (devenu n° 7-8 des Cahiers Sens public), Le Congrès européen des éditeurs de revue (Paris, CNHI, 2008), La gouvernance du numérique éditorial} (Paris, INHA, 2010).
contact : gwormser@sens-public.org
Auteur de :
"Sartre" (A. Colin, 1999, trad. italienne Marinotti, 2005)
"Du corps humain à la dignité de la personne humaine; genèse, débats et enjeux des lois d'éthique biomédicale" (CNDP, 1999, avec Claire Ambroselli)
"Sartre, du mythe à l'histoire" (Cahiers Sens public n° 3-4)
"Sartre, violence et éthique" (Cahiers Sens public n° 5-6)
"Europe, le miroir brisé", Parangon, coll. Sens public, 2006
"L'expérience de la durée", Parangon, coll. Sens public, 2006
"Malaise dans le capitalisme-De quoi sommes-nous contemporains ?" Cahiers SP, n° 11-12
Vidéos
A-t-on enterré l'espace public ? Partie 3
Journées d’études organisées par Publislam et le réseau Pratiques Politiques locales (Iris), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris. Le concept d’espace public – concept
La vulnérabilité urbaine mondiale (Michel Lussault)
Quoi que nous fassions, notre horizon urbain est celui de la vulnérabilité. Celle-ci n'est pas un dysfonctionnement, mais le régime normal du système urbain. Agir dans un monde incertain (Lascoumes),
La ville de l'après-pétrole (Cyria Emelianoff)
L'analyse des modes de vie est indispensable car ils sont à la source de toute évolution en matière environnementale. Les modes de vie sont un objet de préoccupations montantes du côté de la société
Prospective sociale et prospective urbaine (Pierre Veltz)
Dans les mouvements de la mondialisation, comme dans les turbulences de la crise, les villes vivent plus dangereusement, car elles sont soumises non seulement aux grandes tendances prévisibles de l
La ville de la pantoufle (Philippe Madec)
« À chaque projet, se coltinant le réel au plus près du local, les architectes avancent vers la ville durable, sans théorie préconçue ni Charte d’Athènes. « La ville durable sera celle de la
Istanbul, la ville du "passage" (Christiane Garnero-Morena)
Istanbul conserve la mémoire de la ville, et la nôtre, la mémoire de l’Occident. Mais cette ville vit au jour le jour tant ses changements sont rapides, drastiques. Trop occupées par la quête vers la
La mondialisation centrifuge (Saskia Sassen)
L'opposition du global et du local est trop simple. Une troisième sphère est plus difficile à théoriser que les grandes organisations mondiales. Nous manquons de mots pour parler des petites
Le migrant connecté (Dana Diminescu)
Partons de l'univers-maison d'une famille philippine de Paris : l'écran d'ordinateur donne accès à leur maison de Manille. D'où un paradoxe : au cœur du « déracinement », on trouve des attaches et des
La ville portuaire : modèle de productivité dans la mondialisation (Thierry Baudouin)
Les villes mondialisées ont besoin d'interfaces de plus en plus complexes : un port maritime, fluvial, aérien, routier, numérique... Disposer de beaucoup de ces ports dépend bien plus des stratégies
La condition urbaine (Olivier Mongin)
La question de la relation au territoire est aujourd’hui centrale. La mondialisation technologique et économique a des effets immédiats sur le territoire. Alors que les philosophes grecs ont pensé un
Conjuguer bien commun, aspiration à l'autonomie et refus des contraintes
L'individu a été longtemps encadré par des systèmes de valeurs qui donnaient du sens à sa vie. Il était inséré dans des groupes organisés : la famille, l’usine, le syndicat, le parti... Il était
Entre travail individuel et action collective.
Quel est le rapport entre le travail et l’action ? À quelles conditions les évolutions actuelles du monde du travail peuvent-elles être transformées ?« Individualisme et dynamiques collectives »