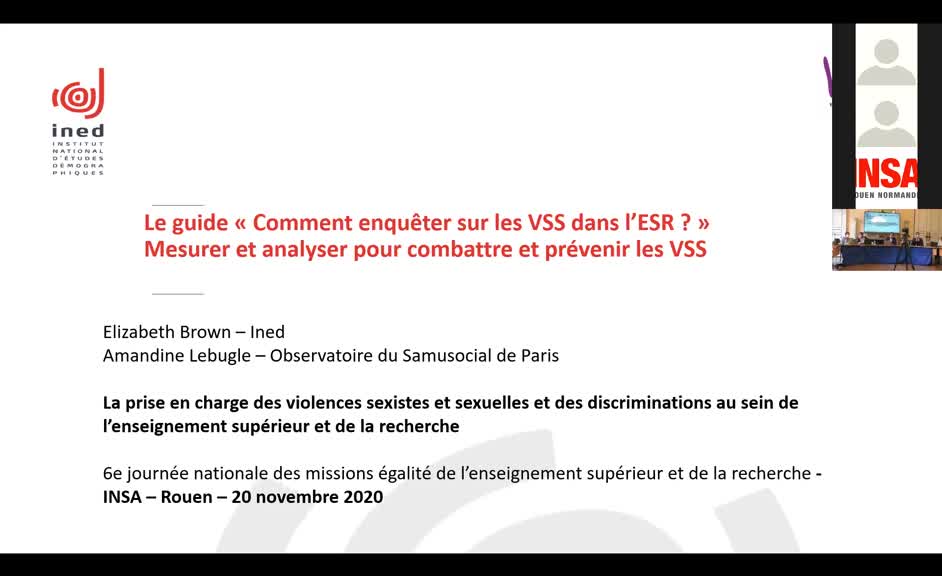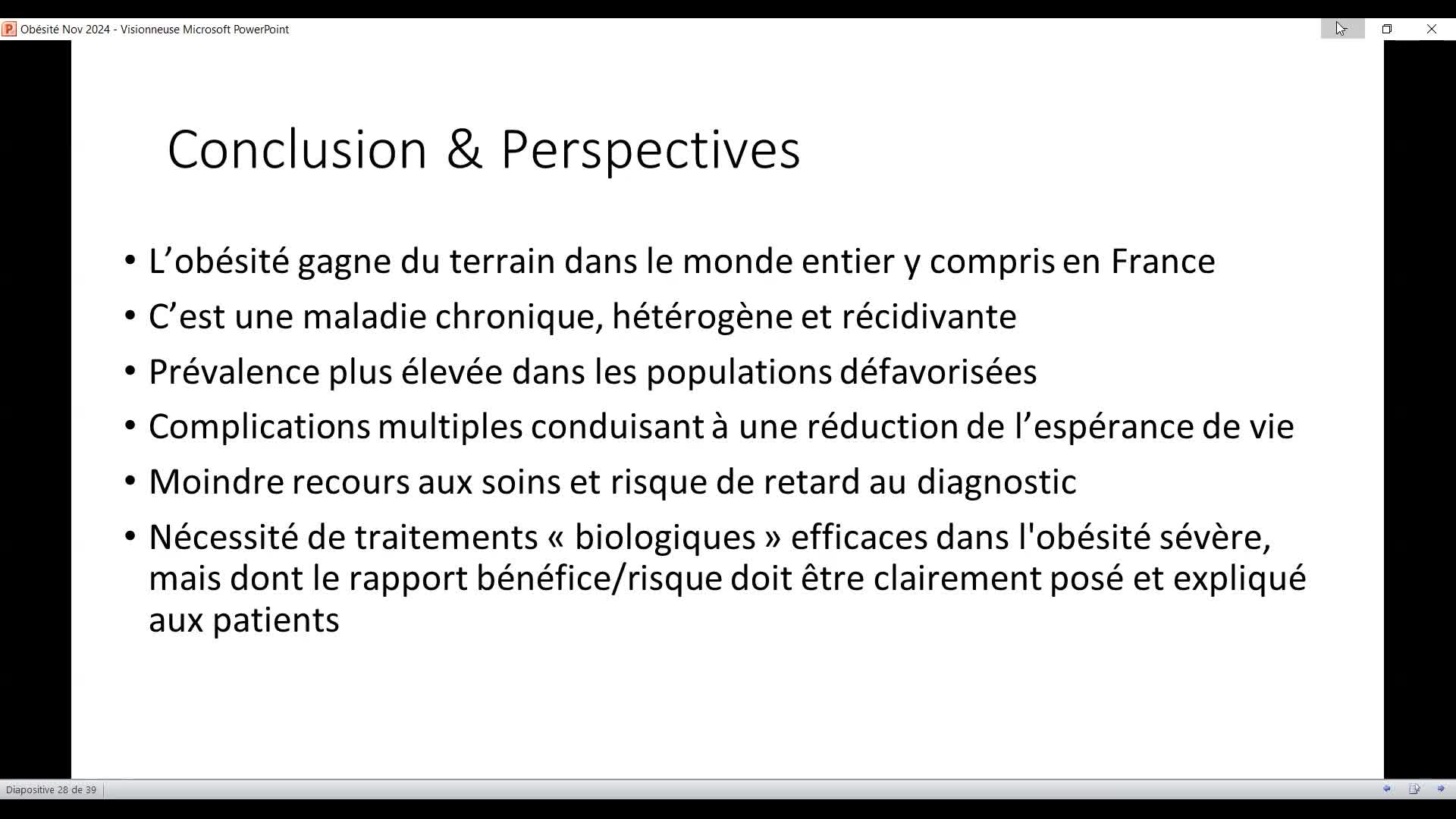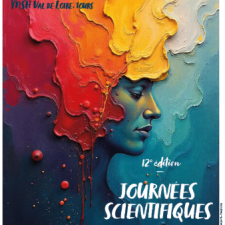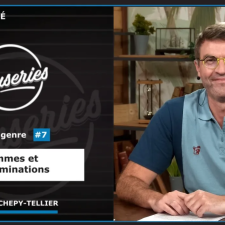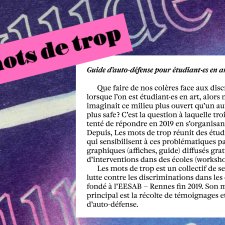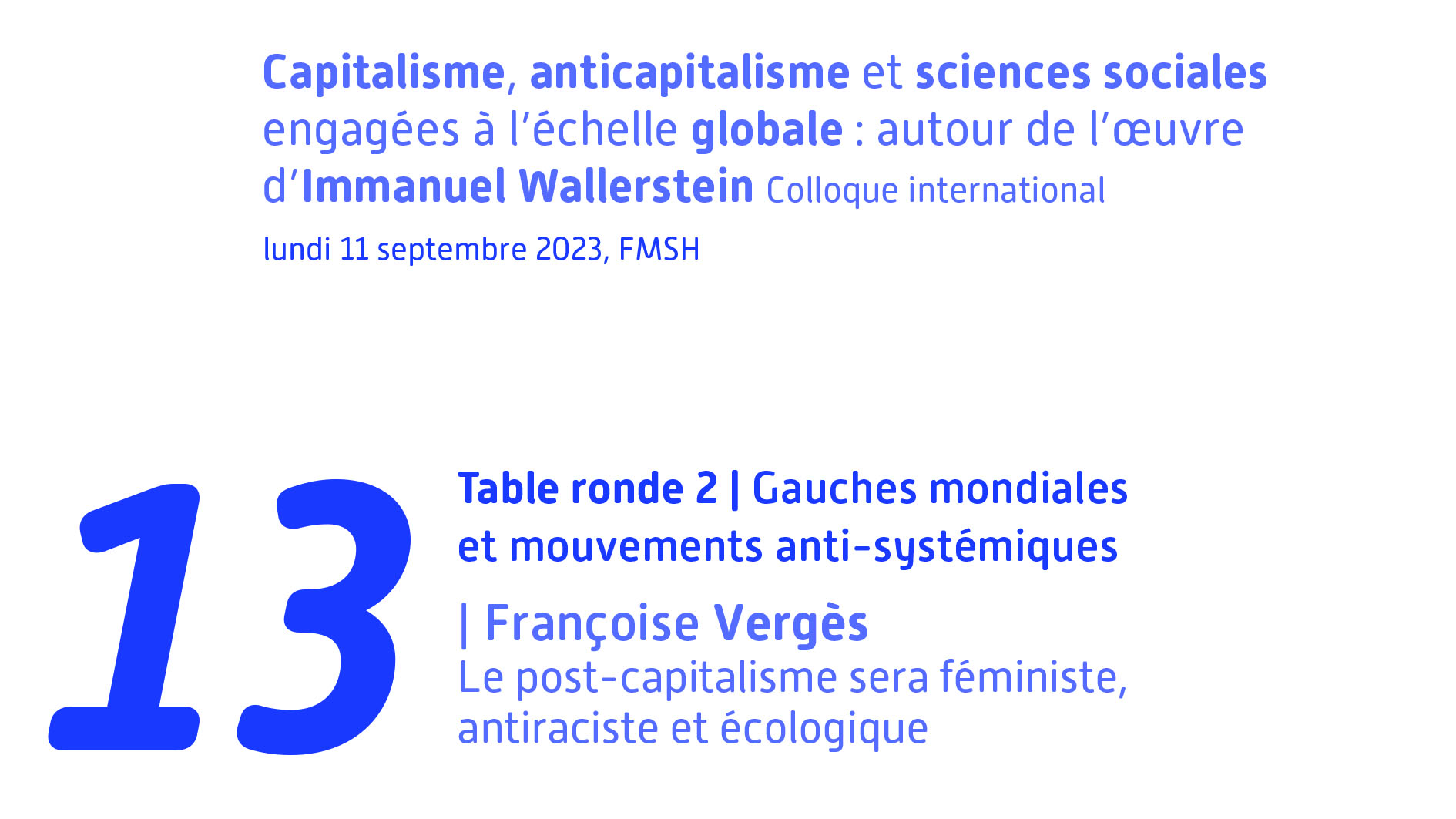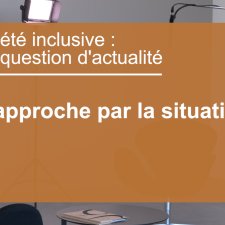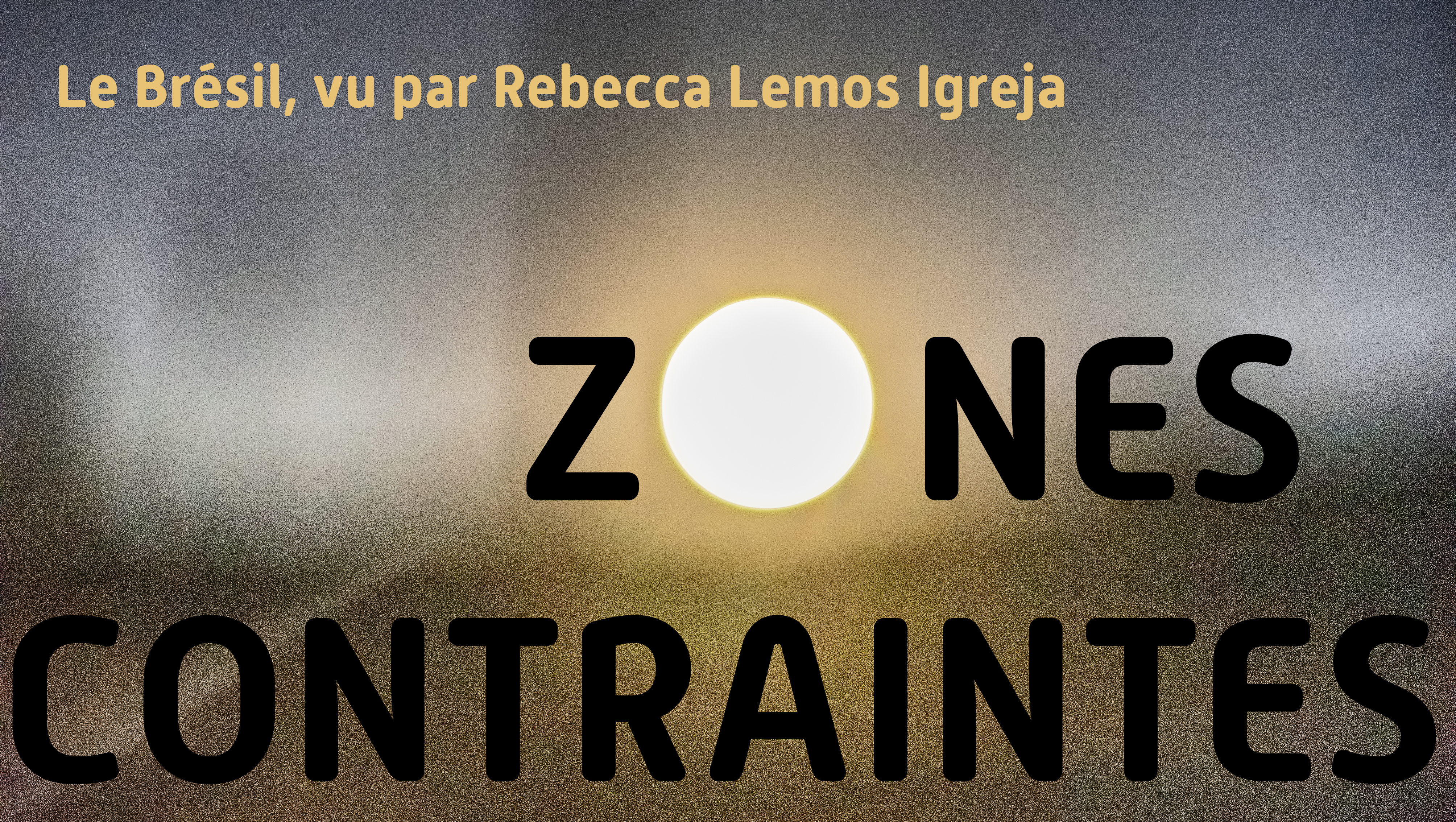Notice
2/6 Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au sein de l’ESR et le rôle du Défenseur des droits dans l’accompagnement des établissements 20 novembre 2020
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Ce second enregistrement contient deux parties de la journée :
1. Les dispositifs de signalement des violences sexistes etsexuelles et des discriminations au sein de l’ESR
2. Prendre en charge les discriminations au sein de l’ESR : lerôle du défenseur des droits dans l’accompagnement des établissements de l’ESR
Avec Béatrice Noël et Elise Brunel, ministèrede l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et FawouzaMoindjie, cheffe de pôle régional du Défenseur des droits
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Retranscription
Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au sein de l’ESR
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Les VSS s’entendent entre étudiants-étudiantes, entre enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, entre personnels non-enseignants (BIATSS) et entre chacune de ces catégories.
Nous savons que non seulement l’ESR n’est pas épargné par ces phénomènes, mais qu’en plus la tranche d’âge des 20-34 ans est l’âge au cours duquel le taux de prévalence des VSS est plus élevé. De plus, les rapports de pouvoir et de hiérarchie sein de ce milieu peuvent être un terreau favorable au développement de ces violences.
Les enquêtes VIRAGE (INED) et de l’IFOP nous fournisse des données nationales concernant les VSS : au cours de sa vie, une femme sur 26 est concernée par le viol, une sur sept est agressée sexuellement (VIRAGE en population générale) et une sur cinq est confrontée à une situation de harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle (IFOP).
L’enquête VIRAGE-Université montre que les étudiantes ont plus souvent déclaré des faits que les étudiants. Entre un tiers et un quart des étudiantes ont déclaré au moins un fait de violence au cours des 12 derniers mois. De plus, dans le cadre universitaire, les violences s’inscrivent dans la durée, un tiers ayant démarré avant les 12 derniers moins.
L’enquête « Conditions de vie des étudiants » de l’Observatoire national de la vie étudiante comporte un module sur la perception des discriminations. Il en ressort qu’un étudiant sur cinq déclare avoir été traité moins bien que ses camarades et que le principal motif de discriminations perçues demeure la nationalité ou l’origine supposée. A partir de 2020, cette enquête intègre une série de questions spécifiquement dédiée aux VSS.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies de ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Le colloque du 4 décembre 2017 a constitué une grande avancée sur le sujet des VSS dans l’ESR avec le lancement de quatre chantiers de travail : enquêter, former, communiquer et mettre en place un dispositif. Entre 2018 et 2019, ces groupes de travail réunissant des acteurs et actrices du terrain, du ministère, des conférences et des associations, ont abouti à la création des ressources.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Les travaux du groupe « Enquêter » ont abouti au guide « Enquêter sur les VSS dans l’enseignement supérieur et la recherche », qui vous sera présenté à 14 heures. Le groupe « Former » a conduit à la création du réseau VSS-Formation (CPED, ANEF, Jurisup). Le groupe « Communiquer » a mené à la création de sept affiches de sensibilisation dont le message s’adresse aux auteurs des violences. Le groupe « Mettre en place un dispositif » a élaboré un guide dédié, désormais moins d’actualité compte tenu de l’évolution de la loi et du travail de recensement à venir.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Des chantiers complémentaires ont vu le jour sur les LGBTphobies - notamment concernant l’utilisation du prénom d’usage pour les personnes trans au sein de l’ESR -, sur le racisme et l’antisémitisme (cf. le guide), ainsi que des discriminations. Le sujet reste très large, d’où l’idée de réfléchir au périmètre des discriminations.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
L’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduit l’obligation de création d’un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans chaque établissement. En conséquence, ce n’est plus une recommandation, mais une obligation légale, avec une pénalité financière. De plus, les discriminations entrent dans le champ du dispositif.
Les textes précisent que ces dispositifs doivent contenir trois procédures : le recueil des signalements, l’orientation vers des services d’accompagnement et de soutien, l’orientation vers les autorités compétentes pour les aspects disciplinaires.
Par ailleurs, la charte de fonctionnement des dispositifs donnent des indications sur le périmètre du public couvert (outre les agents publics, le public étudiant accueilli, mais aussi les personnels d’entreprises extérieures intervenant au sein de l’établissement), sa composition (comité de pilotage impliquant mission égalité, représentants du personnels, représentants administratifs, représentants étudiants, service RH, service de médecine préventive, instances de dialogue social,…), la confidentialité ainsi que les questions de mutualisation et d’externalisation. Toutes ces informations, ainsi que les exemples, sont repris dans la partie VSS du référentiel des plans d’action de l’ESR que je vous invite à consulter.
Le dispositif peut constituer un outil majeur d’avancées sur ces questions, car il coordonne une pluralité d’acteurs et d’actrices au sein de l’établissement, devient moteur d’un changement structurel et par sa présence dans chaque établissement apparait une ressource visible aux yeux de tous et toutes. Cependant, cette réussite reste conditionnée à une formation solide, une sensibilisation de la communauté et une communication efficace.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Pour assurer une meilleure visibilité nationale des initiatives mises en place par vos établissements, nous procédons au lancement d’une plateforme avec un espace dédié à chaque établissement. Cette plateforme sera mise en ligne prochainement.
Questions du public :
Samuel Ghilès-Meilhac, chargé de mission racisme et antisémitisme (MESRI)
Une personne demande si l’article 80 de la loi du 6 août 2019 concerne également les écoles de l’enseignement supérieur et de la recherche privées sous contrat.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Cet article de loi ne concerne que les écoles publiques. Cependant, les obligations en termes de lutte contre les VSS et les discriminations s’appliquent au droit privé. En outre, même si le dispositif n’est pas encadré de la même manière, des établissements privés ont mis en place des cellules d’écoute dont l’une nous sera présentée lors de la table-ronde de ce matin.
Samuel Ghilès-Meilhac, chargé de mission racisme et antisémitisme (MESRI)
Une autre question : « Le thème des VSS a émergé dans l’ESR récemment. Il va être fondu dans des problématiques plus larges (violence, discriminations, etc.). Comment s’assurer qu’il ne soit pas dilué ? Quelles recommandations pour qu’il continue à être porté en propre dans un dispositif large ? »
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Si chacune de ces problématiques (VSS, LGBTphobies, racisme et antisémitisme, discriminations) a des spécificités dont il faut avoir conscience et en développer la connaissance, ce sont aussi des problématiques qui s’entrecroisent et sont interdépendants. Le fait de ne pas les isoler les unes des autres peut enrichir la prise en charge des situations.
Prendre en charge les discriminations au sein de l’ESR : le rôle du Défenseur des droits dans l’accompagnement des établissements de l’ESR
Fawouza Moindjie, cheffe de pôle régional pour la Normandie, les départements des Hauts de Seine et des Yvelines, du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits, existant depuis 2011, tient sa légitimité de la Constitution. Il ne reçoit aucune instruction dans l’exercice de ses attributions. Claire Hédon occupe cette fonction depuis juillet 2020. Dans sa mission de veiller au respect des droits et des libertés, les cinq domaines de compétences du Défenseur des droits sont :
- défendre les droits des usagères et usagers des services publics ;
- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité ;
- veiller au respect de la déontologie de la sécurité ;
- orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte, veiller aux droits et libertés de cette personne.
Ses moyens d’action consistent à assurer la protection des droits et à promouvoir l’égalité et l’accès aux droits. En termes de protection des droits, l’action du Défenseur des droits prend la forme d’instructions, de règlements amiables, de rappels à la loi et de décisions. En termes de promotion, le Défenseur des droits produit des publications et pilote divers comités d’entente (LGBT, origine, dépendance, etc.) issus du terrain.
Le Défenseur des droits dispose de 510 déléguées-délégués bénévoles, de 12 chefs-cheffes de pôles régionaux et de 230 collaborateurs-collaboratrices au siège parisien.
Le Défenseur des droits peut être saisi directement et gratuitement par internet, courrier et via les déléguées-délégués territoriaux. 80 % des dossiers sont traités par les déléguées-délégués, 20 % au siège.
Au titre de la protection des droits, le Défenseur des droits dispose de larges pouvoirs d’investigation, plus ou moins contraignants, qu’il exerce en toute indépendance.
Le Défenseur des droits peut intervenir selon différentes hypothèses qui peuvent être combinées, de la médiation aux décisions qui contribuent à l’évolution de la législation. Il peut saisir l’autorité disciplinaire et publier des rapports spéciaux.
Ainsi, 80 % des règlements amiables aboutissent favorablement.
Le Défenseur des droits publie des études, des guides, des affiches et des dépliants, notamment sur le harcèlement sexuel et les discriminations. En outre, il formule des avis sur les propositions de loi, propose des réformes, des rapports ainsi que son expertise devant les juridictions.
La discrimination
Du point de vue juridique, la discrimination est caractérisée juridiquement comme une inégalité de traitement en raison d’un critère prohibé dans des domaines définis par la loi. Aujourd’hui, 25 critères existent, dont la « vulnérabilité résultant de la situation économique » (précarité), l’origine, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Le Défenseur des droits participe à un groupe de travail piloté par la CPED sur l’élaboration d’un guide pratique sur la lutte contre les discriminations dans l’enseignement supérieur. Il participe aussi à une enquête scientifique sur la mesure statistique et l’analyse qualitative des traitements inégalitaires dans le monde académique.
Par rapport à l’enseignement supérieur, notre prospective porte sur l’analyse intersectionnelle. En effet, alors que des jeunes femmes d’origine étrangère arrivent dans un milieu difficile à appréhender, il convient d’accompagner ce public davantage exposé aux discriminations, mais éloigné des institutions.
Pour le 25 novembre, nous préparons un livret de formation sur le harcèlement sexuel au travail, afin de guider les employeurs souhaitant répondre à leurs obligations et toutes les personnes souhaitant lutter contre ce fléau en réalisant une session de formation sur le sujet.
Enfin, parmi les décisions emblématiques du Défenseur des droits qui ont abouti à des jurisprudences, celle de la reconnaissance du harcèlement discriminatoire d’ambiance (décision 2016-212). Un arrêt de la cour d’appel d’Orléans, rendu en février 2017, suivant les observations du DDD a reconnu qu’une salariée, sans être directement visée par les agissements de harcèlement sexuel (photographies pornographiques sur le lieu de travail, blagues grivoises fondées sur le sexe, circulation de vidéos suggestives, propos dégradants sur les femmes) subissait au quotidien un environnement de travail particulièrement hostile rendant ses conditions de travail insupportables. La cour a considéré qu’elle avait été victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance.
Questions du public :
Samuel Ghilès-Meilhac, chargé de mission racisme et antisémitisme (MESRI)
Une question : « Est-il possible de bénéficier d’une permanence du Défenseur des droits sur un campus ? »
Fawouza Moindjie, cheffe de pôle régional pour la Normandie, les départements des Hauts de Seine et des Yvelines, du Défenseur des droits
Oui, si le besoin existe et la disponibilité est possible. Contactez la cheffe ou le chef de pôle de la région concernée.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Une participante pose la question suivante : « Est-ce que les femmes d’origine étrangère sont plus touchées que les autres par ces violences ? Avez-vous des données sur ce point ? »
Fawouza Moindjie, cheffe de pôle régional pour la Normandie, les départements des Hauts de Seine et des Yvelines, du Défenseur des droits
Les études menées montrent que le caractère étranger des femmes accentue leur sentiment de discrimination, d’où la nécessité de se pencher sur la question de l’intersectionnalité des discriminations.
Dans la même collection
-
1/6 Discours d'introduction du Ministère, des Conférences d'établissements et de la Direction régio…
BarthezAnne-SophieBalaudéJean-FrançoisDépincéPhilippeRaoult-WackAnne-LucieDemoulinHuguesAvec : Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation ; Philippe
-
4/6 Présentation du guide « Comment enquêter sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseign…
Lebugle-MojdehiAmandineBrownElizabethCondonStéphaniePrésentation du guide « Comment enquêter sur les VSS dans l’ESR ? » - Intervenantes : par Amandine Lebugle, Elisabeth Brown et Stéphanie Condon Recommandations méthodologiques pour mener
-
6/6 Clôture de la journée par Mourad Boukhalfa, directeur de l’INSA de Rouen 20 novembre 2020
BoukhalfaMouradAvec Mourad Boukhalfa, directeur de l’INSA de Rouen
-
3/6 Table-ronde : exemple de dispositifs de signalement et de traitement des VSS et des discriminat…
LiotardPhilippeTisserantPascalTessierNathalieTitre : Table-ronde : exemple de dispositifs de signalement et de traitement des VSS et des discriminations au sein de l’ESR Avec : Anissa Benaissa et Philippe Liotard( CPED); Marion Bulot
-
5/6 Table-ronde : la prise en charge disciplinaire des situations de violences sexistes et sexuelle…
BrunelEliseReynaudThierryAstierJulieTexier PicardRozennGhiles-MeilhacSamuelLes règles de fonctionnement des procédures disciplinaires : Présentation par Thierry Reynaud, DGRH-MESRI et Adrien Levrat, DAJ de Paris Saclay, Jurisup des procédures disciplinaires concernant
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
5/6 Table-ronde : la prise en charge disciplinaire des situations de violences sexistes et sexuelle…
BrunelEliseReynaudThierryAstierJulieTexier PicardRozennGhiles-MeilhacSamuelLes règles de fonctionnement des procédures disciplinaires : Présentation par Thierry Reynaud, DGRH-MESRI et Adrien Levrat, DAJ de Paris Saclay, Jurisup des procédures disciplinaires concernant
Sur le même thème
-
La laïcité vue par des étudiantes et étudiants internationaux de l'EHESS
InoueSubaruSürat AksanMüberraVillaniDavidHermon-BelotRitaPortierPhilippeEn France, le principe de laïcité, bien que globalement perçu positivement, demeure source de débats en raison d’interprétations divergentes.
-
Discriminations à l’ère des plateformes numériques. Le cas de la grossophobie
BourdeloieHélèneLarochelleDimitra LaurenceFerréNathalieCaretteClaireBellichaAliceColloque organisé par Hélène Bourdeloie (maîtresse de conférences à l’Université Paris Nord, chercheuse au LabSIC, en délégation au CIS-CNRS en 2024/25) et Dimitra Laurence Larochelle (maîtresse de
-
Colloque international « (In)justice reproductive : Les droits reproductifs au prisme des rapports …
CarayonLisaSantos RodriguezVictorDans cette vidéo, Lisa Carayon anime une table ronde portant sur les enjeux de justice reproductive et de travail.
-
La discrimination ethno-raciale dans la corporation des Avocat.es
ZribiYasmineLa recherche porte sur la manière dont les rapports sociaux ethno-raciaux participent à la division sociale d’une corporation professionnelle, celle des avocats. Si la formation et la réussite à l
-
Le handicap au pouvoir - Avec Cyril Desjeux
BaudotPierre-YvesDesjeuxCyrilDans le cadre des émissions en direct "Autonomie : l'actu de la recherche", organisées par le Programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie. Lire le compte-rendu écrit : https://ppr-autonomie
-
Les Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
DucretMarie PatriciaDechepy-TellierJohanLes Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
-
Les mots de trop – Guide d’auto-défense pour étudiant·es en art
AlvèsAnaïsBaierlEstelleVelaSophieQue faire de nos colères face aux discriminations subies lorsque l’on est étudiant·es en art, alors même que l’on imaginait ce milieu plus ouvert qu’un autre, peut-être plus safe ?
-
Handicaps et travail #2 - Discriminations en raison du handicap dans l'emploi
DucretMarie PatriciaLefevreDidierDidier Lefevre - Causeries Handicaps - Handicaps et travail #2 - Discriminations en raison du handicap dans l'emploi
-
Table ronde 2/ Le post-capitalisme sera féministe, antiraciste et écologique
VergèsFrançoiseDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
Société inclusive : une question d'actualité - L’approche par la situation
WalkerAlanMeistermannChristianHôteJean-MichelFougeyrollasPatrickComment la primauté à l’interaction entre l’environnement et la personne participe à la refondation de l’action publique et des pratiques professionnelles qui construisent la société inclusive ?
-
Entretien avec Christian Meistermann sur la Société inclusive
MeistermannChristianEntretien avec Christian Meistermann, représentant régional Grand-Est de APF France handicap
-
Le Brésil, vu par Rebecca Lemos Igreja
Lemos IgrejaRebeccaLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire elle accompagne des chercheurs