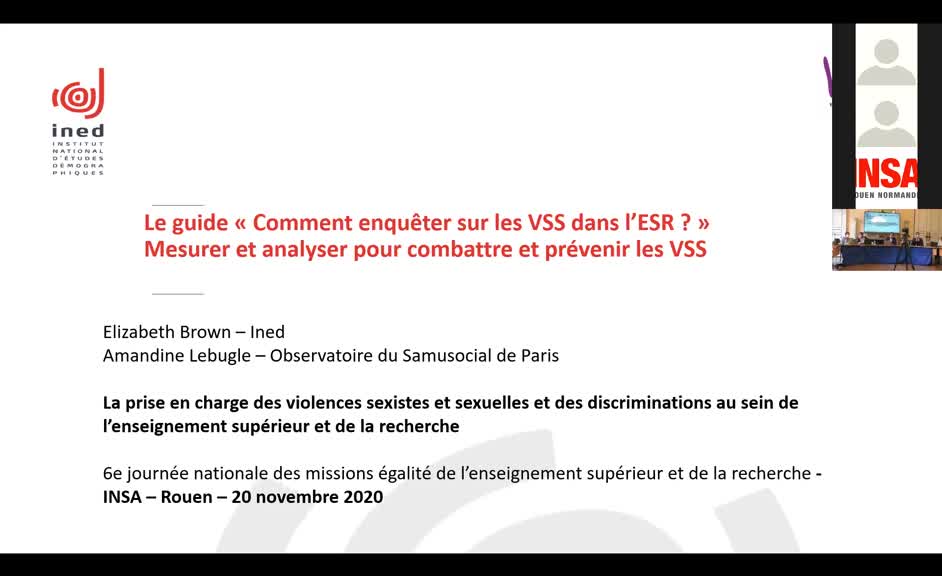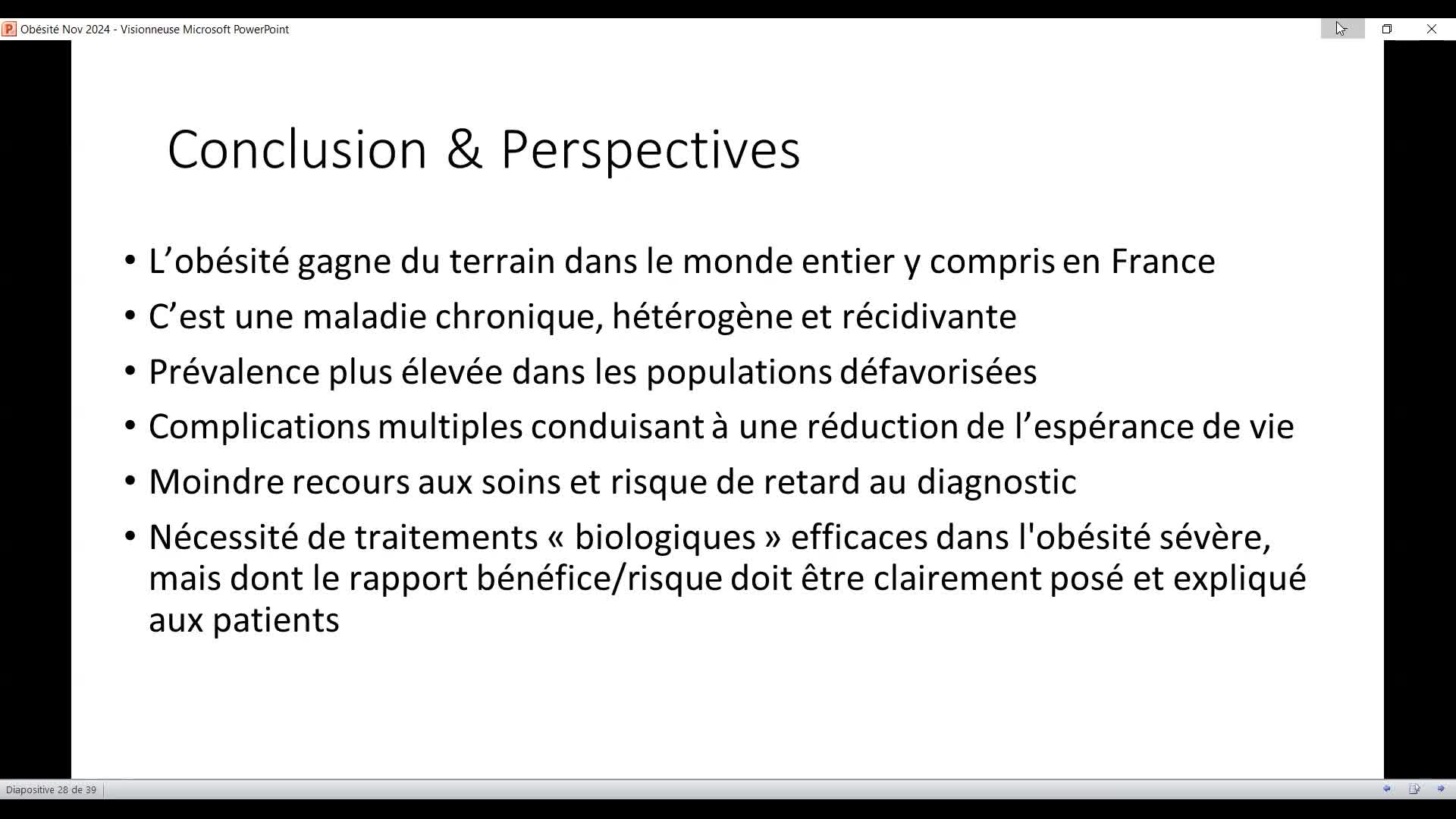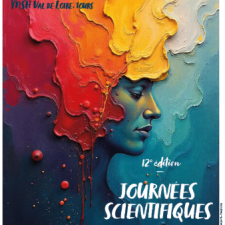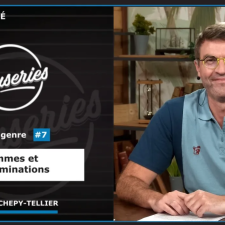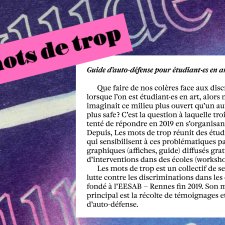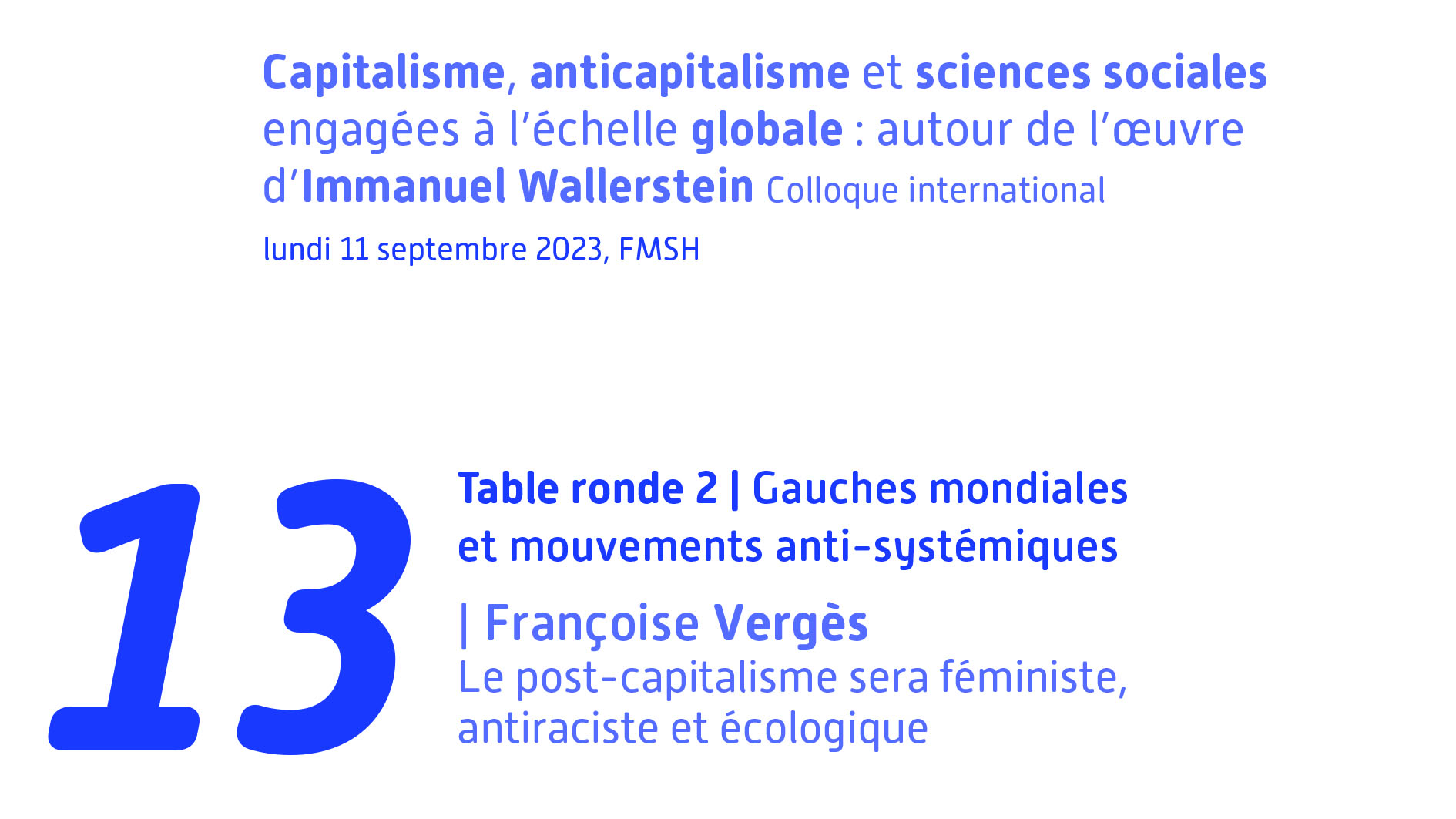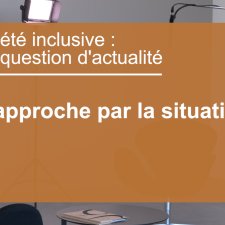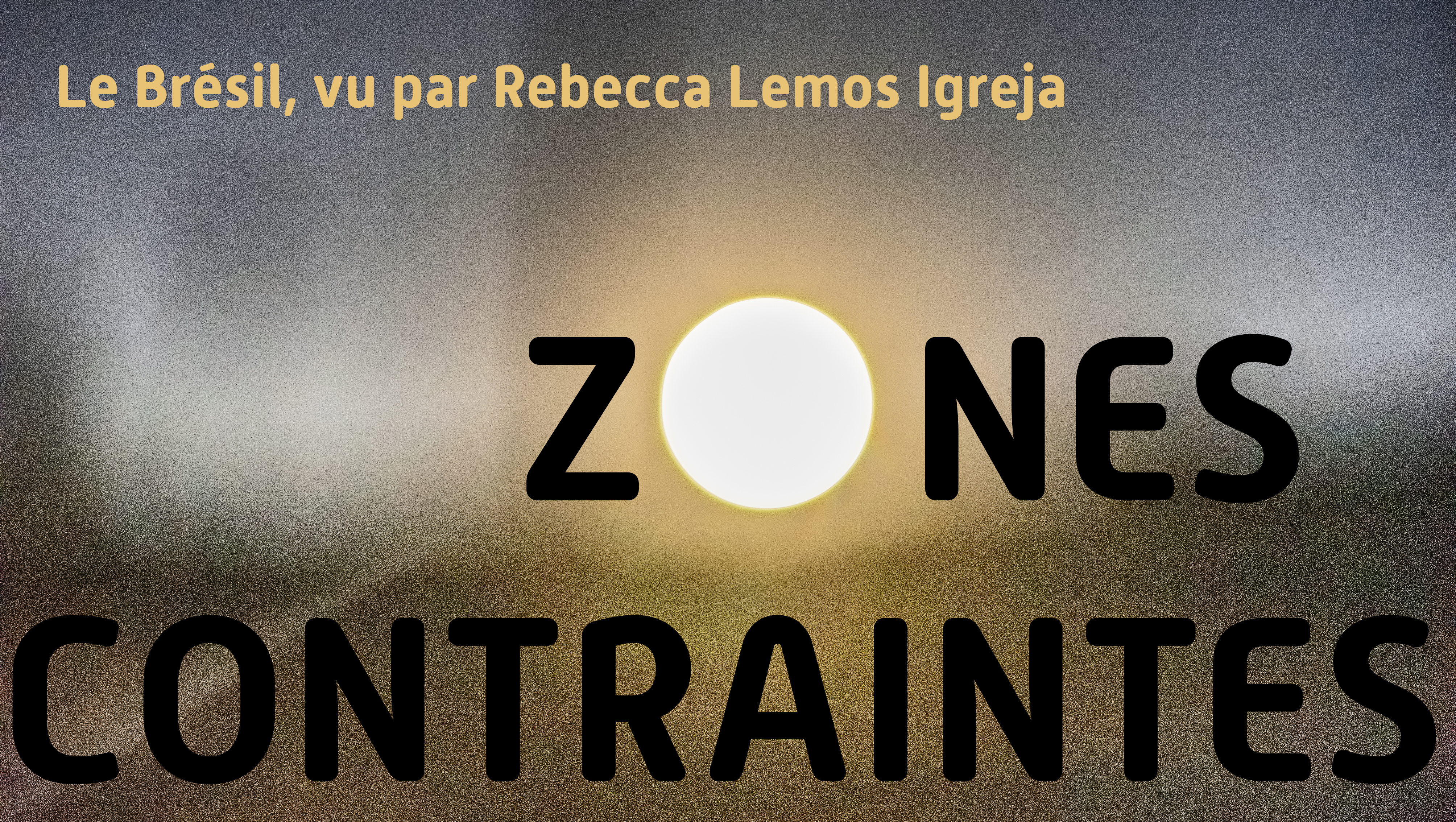Notice
5/6 Table-ronde : la prise en charge disciplinaire des situations de violences sexistes et sexuelles et de discriminations 20 novembre 2020
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Les règles de fonctionnement des procédures disciplinaires : Présentation par Thierry Reynaud, DGRH-MESRI et AdrienLevrat, DAJ de Paris Saclay, Jurisup des procédures disciplinaires concernantles personnels enseignantes-enseignants : Présentation du guide Jurisup/DGRH etperspectives réglementaires.
Présentation par Evelyne Testas et Julie Astier, service dela réglementation MESRI : présentation du guide sur les procéduresdisciplinaires concernant les étudiantes et étudiants.
Point sur la prise en charge de situations :
Présentation par Hélène Moulin-Rodarie, DGRH-MESRI, dechiffres issus du recensement des décisions disciplinaires dans lesétablissements et du travail de constitution d’une base de données desdécisions disciplinaires.
Les dysfonctionnements repérés au cours des différentesétapes de la procédure disciplinaire par Rozenn Texier-Picard
Témoignages : deux exemples de prise en charge de situationde VSS au sein d’établissement de l’ESR.
Témoignages relayés par Elise Brunel et SamuelGhilès-Meilhac
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Retranscription
<p>Table ronde : la prise en charge disciplinaire des situations de VSS et de discriminations, par le réseau VSS-Formation (Jurisup, ANEF, CPED) et le MESRI
Les règles de fonctionnement des procédures disciplinaires
1) Les procédures disciplinaires concernant les personnels enseignantes-enseignants : présentation du guide Jurisup/DGRH et perspectives réglementaires
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
La procédure disciplinaire applicable au public étudiant, modifiée récemment, nous a conduits à nous interroger sur un guide disciplinaire pratique dédié à la communauté enseignante et enseignante-chercheuse avec des adaptations aux situations de VSS.
La section disciplinaire
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire. […] » (Article L.712-6-2 du Code de l’éducation).
La section disciplinaire constitue une juridiction indépendante au sein de l’établissement. Ses membres sont élus par et parmi les membres du Conseil académique, selon une composition paritaire femmes-hommes. Sa présidence est assurée par un ou une membre professeur d’université de la section disciplinaire. Tout jugement est rendu par des membres d’un niveau égal ou supérieur.
La compétence de la section disciplinaire
La notion de faute disciplinaire est large, selon l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
L’établissement compétent est celui au sein duquel les faits ont été commis. Si les faits ont été commis en dehors d’un établissement, l’établissement d’affectation de l’enseignant-chercheur est compétent.
Parmi les exemples de faits relevant de la compétence de la section disciplinaire, on relève le harcèlement moral, le harcèlement d’un professeur des universités à l’encontre de plusieurs étudiantes ou des propos déplacés à connotation sexuelle sans nécessité pédagogique tenus pendant les enseignements.
La première étape correspond à l’engagement des poursuites.
Avant la procédure, l’enquête administrative doit établir la matérialité des faits reprochés. L’engagement des poursuites se fait par le président ou la présidente de l’université ou, en cas de défaillance, par le recteur ou la rectrice de région académique. La saisine est alors adressée à la présidence de la section disciplinaire.
Engagement des poursuites : quelles obligations ?
Selon l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, la responsabilité de l’établissement peut être engagée lorsqu’il laisse se produire des agissements de harcèlement moral se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser. L’employeur doit enquêter sur des faits de harcèlement moral portés à sa connaissance.
Déroulement de la procédure
L’instruction doit être conduite par deux membres de la section disciplinaire désignés par le président ou la présidente de la section. Le rendu du rapport d’instruction est établi par le rapporteur de la commission. Le jugement est rendu par quatre membres de la section disciplinaire.
Les sanctions
La sanction la plus fréquente est l’interdiction d’exercer pendant une durée limitée avec privation de la moitié du traitement. La sanction la plus lourde est la révocation assortie de l’interdiction d’exercer.
A l’issue de la procédure, la décision doit être publiée, en version anonyme si la formation de jugement le décide. L’appel s’effectue dans un délai de deux mois devant le CNESER en formation disciplinaire. Puis, le cas échéant, le recours en cassation s’effectue dans un délai de deux mois devant le Conseil d’Etat.
Parmi les exemples de sanction, on relève une interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans pour des faits de harcèlement d’un professeur d’université à l’égard d’étudiantes, une interdiction d’exercer pour une durée de 8 mois, pour avoir tenu des propos déplacés à connotation sexuelle sans nécessité pédagogique pendant des enseignements, une interdiction d’exercer pour une durée de 4 ans avec privation de la moitié du traitement (relations ambiguës d’un enseignant-chercheur avec ses étudiantes, SMS à caractère sexuel…), une interdiction d’exercer pendant une durée d’un an avec privation de la moitié du traitement (SMS à connotation sexuelle, attouchements, relations inappropriées…) et une exclusion définitive de l’université pour des propos à connotation sexuelle devant des étudiantes et étudiants, propos homophobes et sexistes, défaillances pédagogiques, dénigrement systématique.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
L’idée de ce guide dédié aux procédures disciplinaires est née d’un rapport de décembre 2018 du Conseil d’Etat sur les juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur. Ce rapport, non publié, comportait une préconisation sur la déjuridictionnalisation des sanctions disciplinaires des étudiantes et étudiants, et une autre sur la présidence du CNESER statuant en matière disciplinaire. Deux préconisations de ce rapport ont été retenues et sont désormais traduites dans la loi :
- 1. Le CNESER n’est plus compétent à l’égard des usagers
Article L232-2 du Code de l’éducation : le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
- 2. Le CNESER sera présidé par un Conseiller d’Etat
Article L232-3 du Code de l’éducation : le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
L’article précise également :
- Hormis son président, le CNESER statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui ;
- Le président du CNESER statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire ;
- Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement ;
- La récusation d'un membre du CNESER peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par la présidence ou direction de l'établissement, par la rectrice ou le recteur de région académique ou par la médiatrice - le médiateur académique ;
- Sont fixés par décret en Conseil d'Etat : la composition, les modalités de désignation des membres du CNESER statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres.
Le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur est déjà paru.
Aux termes de l’article R. 811-10, c’est désormais le Conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, qui est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
Les autres pistes suggérées dans le rapport sont, pour le CNESER :
- préciser les règles procédurales (délai de remise du rapport d’instruction, organisation du contradictoire, fixation plus précise des délais de convocation et leur computation, prévoir une clôture d’instruction) ;
- revoir l’échelle des sanctions (introduire une sanction réparatrice).
Pour les organes disciplinaires de première instance :
- prévoir des suppléants ;
- parité en fonction des effectifs dans la discipline ;
- organiser un véritable contradictoire ;
- prévoir une procédure allégée avec un seul membre (président ?) pour l’avertissement ou le blâme.
Enfin, une troisième modification, très importante pour les personnes victimes, a été apportée au fonctionnement des sections disciplinaires, via l’article 31 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article précise que : « Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assistée, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »
2) Le guide sur les procédures disciplinaires concernant le public étudiant
Evelyne Testas, chargée d’études au service de la réglementation (MESRI)
Les principales évolutions de la procédure disciplinaire à l’égard des usagers
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique fait que la section disciplinaire pour les usagers est désormais une instance administrative et non plus juridictionnelle. D’où la possibilité d’introduire des dispositions plus souples et du recours devant le tribunal administratif (non suspensif).
Le décret du 26 juin 2020 comprend des dispositions permettant d’alléger la charge de travail de la section disciplinaire ou de la répartir : composition de la section permettant plusieurs formations en parallèle, possibilité d’instruction seulement écrite et procédure sur reconnaissance de culpabilité. En outre, ce décret crée une nouvelle sanction : la mesure de responsabilisation, qui consiste à faire participer l’usager sanctionné à des activités de solidarité, culturelles ou éducatives pendant un maximum de 40 heures.
Julie Astier, chargée d’études au service de la réglementation (MESRI)
Le guide relatif à la procédure disciplinaire à l’égard des usagers
Les nouveautés du guide portent sur les points suivants :
- le champ d’application de la procédure est élargi avec la notion d’atteinte à la réputation de l’établissement, ce qui inclut des faits produits à l’extérieur des établissements ou des propos tenus sur les réseaux sociaux ;
- l’ouverture de la possibilité de saisine de la section disciplinaire directement par la rectrice-le recteur ;
- pour l’instruction, assistance par un conseil pour le témoin qui s’estime victime et rappel des conditions d’audition des témoins (auditions possibles hors de la présence de la personne poursuivie dans le respect de la procédure contradictoire) ;
- l’interdiction d’accès aux locaux (rappel).
Le guide devrait être prochainement diffusé aux établissements, puis enrichi par des fiches selon les remontées des établissements.
Questions du public :
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Un participant demande si les BIATSS sont concernés par ces évolutions.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Les BIATSS ne sont pas concernés par les changements évoqués.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Peut-on faire appel d’une décision du président ou de la présidente d’université auprès du recteur ou de la rectrice ? »
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Au cas où le président d’université n’engage pas de procédure disciplinaire, après mise en demeure du président, le recteur peut mettre en œuvre la procédure. Par ailleurs, chacun reste libre d’écrire au recteur.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Les arrêts présentés par Adrien Levrat sur le harcèlement moral valent-ils pour le harcèlement sexuel ? »
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
Je vous le confirme, le harcèlement sexuel constituant un facteur aggravant.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Un participant s’étonne que le CNESER soit exclusivement composé d’enseignants-chercheurs hormis le président.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Cette composition répond au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Une question : « Les propos discriminatoires tenus hors établissement relèvent-ils du disciplinaire ? »
Evelyne Testas, chargée d’études au service de la réglementation (MESRI)
Dès lors qu’un lien est établi avec l’établissement, la section disciplinaire est compétente.
Point sur la prise en charge de situations
1) Les chiffres issus du recensement des décisions disciplinaires dans les établissements et le travail de constitution d’une base de données des décisions disciplinaires
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
2017 a marqué une accélération dans les démarches, les enquêtes et la prise de conscience pour lutter contre les VSS.
Concernant le recensement des décisions disciplinaires, la notion de "harcèlement sexuel" 'apparaît pour la première fois lors de l'enquête annuelle de la DGAFP de 2017 (données de l’année 2016) dans une rubrique, "Mœurs (dont harcèlement sexuel)". Auparavant, seule une rubrique intitulée "mœurs" y figurait. En 2019, apparaît la rubrique « violences sexuelles et sexistes » regroupant 8 types de « fautes », enrichie en 2020 de 3 types de fautes supplémentaires.
Sur 1,650 million d’agents de la fonction publique, 80 sanctions ont été prises au titre des mœurs en 2017 et 98 en 2018, dont environ 40 % de révocations.
Pour les enseignants-chercheurs permanents et non permanents, sur 91 400 agents, seules quatre sanctions au titre des mœurs ont été prises en 2017 et deux en 2018. En 2019, 10 sanctions pour VSS ont été prises (8 exclusions temporaires de fonctions d’une durée de 3 mois à 2 ans, 1 blâme et 1 licenciement).
En 2020, on relève 148 sanctions (pour VSS) pour la fonction publique d’Etat, pour environ 40 % de révocations ; 9 sanctions pour les enseignants-chercheurs (2 exclusions, 1 interdiction d'exercer pour une durée supérieure à deux ans, 1 exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 mois à 2 ans ,1 exclusion temporaire de fonction d'une durée de 2 mois, 1 abaissement d'échelon, 2 blâmes, 1 rappel à l'ordre).
Juridiction administrative d’appel, le CNESER disciplinaire a été saisi au cours des trois dernières années de 40 dossiers en appel concernant le corps enseignant et de plus de 200 dossiers concernant les étudiantes-étudiants. Les décisions prononcées par le CNESER disciplinaire sont régulièrement publiées au BOESRI.
Avec l’article 33 de la loi de transformation de la fonction publique, le CNESER disciplinaire devient désormais compétent pour les seuls enseignants-chercheurs et assimilés puisque le caractère juridictionnel des sections disciplinaires et la compétence en appel de cette juridiction sont supprimés pour les usagers.
Concernant le partage de l’information sur les décisions disciplinaires, deux choses évoluent :
- A compter de cette année, la DGRH élaborera et publiera au bulletin officiel un document recensant, de manière anonyme, toutes les sanctions prononcées par les sections disciplinaires des établissements à l’encontre des enseignants-chercheurs et assimilés (types de manquement, faits, sanctions prononcées, statut et genre du déféré).
- Par ailleurs, pour le personnel hospitalo-universitaire, l’article 7 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020 a également intégré la notion de publicité.
Pour les BIATSS, les CAP interviennent en formation disciplinaire et remontent à la DGAFP des informations sur les procédures ainsi que sur les sanctions prises.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Cette intervention apporte une réponse à une question posée sur l’existence de statistiques nationales sur les procédures disciplinaires.
2) Les dysfonctionnements repérés au cours des différentes étapes de la procédure disciplinaire
Rozenn Texier-Picard, enseignante-chercheuse à l’ENS Rennes, membre du réseau VSS-Formation
Le réseau VSS-Formation a été mis en place en 2018 par l’ANEF, la CPED et JuriSup, avec pour objectif de former et sensibiliser les étudiantes-étudiants et personnels des établissements d’ESR et organismes de recherche, selon les thématiques suivantes : appréhender les VSS, mettre en place un dispositif, élaborer un plan de prévention, écouter les victimes de violences, etc.
Le réseau propose ou bien des formations ouvertes aux personnels de plusieurs établissements ou bien des formations spécifiques à un établissement, en présentiel ou à distance.
Le sujet des VSS et notamment des procédures disciplinaires a fait l’objet d’un vade-mecum (2015 et 2017, ANEF, CLASCHES, CPED) et d’un séminaire en 2018 (ANEF, CLASCHES, CPED, JuriSup). Des formations pour les sections disciplinaires sont en cours de mise en place et un guide sur le disciplinaire dans les situations de VSS est en projet.
Dans le cadre d’un groupe de travail composé du département des stratégies RH, parité et lutte contre les discriminations, de Jurisup et du réseau VSS formation, nous avons repéré les dysfonctionnements ou problématiques que rencontrent les établissements pour la prise en charge disciplinaire des situations. Nous proposons de répondre aux questions que cela soulève au cours des trois étapes de la prise en charge disciplinaire :
Avant la saisine de la section disciplinaire :
- Le champ de compétence de l’instance disciplinaire (faits
graves hors établissement) :
- Exemple de dysfonctionnement : « La présidence/direction d’un établissement a connaissance de faits de viols lors d’une soirée étudiante. En application de l’article 40 du Code de procédure pénale, elle en informe le procureur de la République. Cependant, considérant que cela ne relève pas de la compétence de la section disciplinaire, car les faits se sont passés hors de l’établissement au cours d’une soirée étudiante, la section disciplinaire n’est pas saisie. »
à Réponse : l’établissement peut engager des poursuites disciplinaires (art. R. 712-10 et R 811-11 du Code de l’éducation) pour des faits hors établissement (soirée étudiante, etc.), entre membres de la même communauté. En effet, ces faits sont de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. De plus la notion d’atteinte à la réputation de l’établissement a été ajoutée (article R.811-11) ;
- La confusion entre l’enquête préalable et l’instruction de la
procédure disciplinaire :
- l’enquête préalable (ou administrative) est une enquête effectuée en amont de la saisine de la section disciplinaire. Elle sert à éclairer la décision de la présidence/direction de l’établissement dans la saisine ou la non-saisine de la section disciplinaire ;
- l’instruction disciplinaire, juridique, est intégrée à la procédure disciplinaire et répond à des exigences (contradictoire, levée de l’anonymat, etc.), nous verrons cela dans la 2ème étape.
- La protection fonctionnelle pour les personnes mises en cause :
- la protection fonctionnelle peut être accordée à l’agent concerné, sauf en cas de « faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ». Ainsi, si l’établissement dispose d’éléments qui supposent des faits de harcèlement sexuel, l’administration peut refuser la protection fonctionnelle. En l’absence d’éléments matériels irréfutables, il est recommandé que l’établissement accorde la protection fonctionnelle aux agents concernés dans un premier temps. En effet, il pourra retirer cette protection si la matérialité des faits est prouvée (art. 11, loi 83-634).
Pendant la procédure disciplinaire, les problématiques repérées et les réponses apportées sont les suivantes :
- La communication à l’ouverture de la procédure disciplinaire :
- obligation d’informer de la saisine la personne poursuivie : cheffe-chef d’établissement, recteur-rectrice, médiateur-médiatrice d’académie ;
- importance d’informer l’auteur-autrice du signalement et la cellule (transparence, selon la charte des dispositifs de signalement).
- Le niveau d’informations recueillies lors de l’instruction de
la procédure disciplinaire :
- la section disciplinaire ne peut pas se contenter des informations recueillies lors l’enquête préalable ;
- la commission d’instruction doit recueillir tous les éléments qui permettront d’éclairer la section, à charge et à décharge.
- Le travail de la section disciplinaire : accès au dossier,
confrontation, choix des témoins, nouvelles pièces, arrêt de la procédure :
- les pièces du dossier doivent être accessibles à toute la section disciplinaire, si possible via des espaces numériques sécurisés ;
- la confrontation n’est pas indispensable, le contradictoire n’impose pas la confrontation. Par ailleurs la victime peut désormais être assistée (loi 2019-828, art 31) ;
- la commission d’instruction apprécie l’intérêt de chaque audition : risque de recours si des éléments importants sont écartés ;
- de nouvelles pièces doivent rouvrir l’instruction ;
- toute procédure engagée doit aller à son terme, avec relaxe ou sanction.
Après la procédure disciplinaire, les problématiques repérées et les réponses apportées sont les suivantes :
- Obligation d’affiche de la décision
- Exemple : un affichage tardif ou peu visible de la décision à l’affichage doit être immédiat et dans un lieu accessible (exemple : page internet). La décision peut être anonymisée.
- Des recours possibles souvent méconnus :
- le recours contre les décisions visant un enseignant ou un enseignant-chercheur se fait devant le CNESER statuant en matière disciplinaire. Ce recours est suspensif ;
- le recours pour des décisions visant un usager se fait devant le tribunal administratif (poursuites engagées après le 27 juin 2020). Ce recours est non-suspensif.
3) Témoignages : deux exemples de prise en charge de situation de VSS au sein d’établissements de l’ESR
Samuel Ghilès-Meilhac, chargé de mission racisme et antisémitisme (MESRI)
Le premier exemple s’est présenté dans un organisme de recherche de plusieurs centaines d’agents, où la question du rapport de genre et d’égalité femmes-hommes a fait l’objet d’études et dont les résultats ont été partagés en interne. Or cette situation illustre le décalage entre la théorie et la pratique.
Plusieurs personnes ont signalé des comportements inappropriés, des insultes, des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. La direction a demandé une enquête externalisée et l’éloignement provisoire de la personne mise en cause à titre conservatoire, avec une suspension de quatre mois avec maintien de la rémunération. L’enquête, menée pendant deux mois par deux inspecteurs généraux de l’IGAENR, a permis de recueillir des récits convergents de harcèlement sexuel, recommandant un signalement au procureur de la République, effectué par la direction, qui a réuni un conseil de discipline. Afin de préparer ce conseil de discipline, une formation des membres de la CAP disciplinaire sur les VSS a été réalisée par des intervenants extérieurs. Dix mois après le signalement, le conseil de discipline, après remise du rapport et audition des victimes et témoins, a décidé à l’unanimité une sanction prenant forme d’une exclusion avec retenue de salaire pendant 2 ans dont 6 mois de sursis. La direction a pris la sanction conformément à l’avis de la CAP disciplinaire. Puis, l’organisme a décidé de développer des actions de sensibilisation et de formation, dont certaines obligatoires, concrétisées un an après le signalement. Par ailleurs, l’année de la sanction, une structure d’écoute externalisée a été mise en place. De plus, une charte pour la prévention et le signalement des VSS est en cours d’élaboration.
Cet organisme a donc connu un moment collectif difficile. Il a fallu entendre les victimes et leurs proches, agir face au signalement, informer le personnel tout en respectant l’anonymat des victimes et de la personne mise en cause, ainsi que gérer la rumeur et éviter la division en interne. A plus long terme, se pose la question du soutien aux victimes, aux témoins, aux collègues proches de la personne mise en cause et aux membres du conseil de discipline. De même que celle de préparer le retour de la personne, avec la mise en place d’un accompagnement des unités de recherche et du collègue sanctionné.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
L’exemple à venir a créé une jurisprudence sur la liberté des modes de preuve en matière disciplinaire. Dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, la situation implique une doctorante et son directeur de thèse. La doctorante étant invitée à parler de sa thèse dans le cadre d’un comité de suivi, celui-ci relève que son travail traîne, puis repère des faits pouvant s’apparenter à du harcèlement sexuel. Le comité de suivi de thèse oriente alors la doctorante vers les personnes en charge des VSS au sein de l’établissement. La doctorante est reçue par ces personnes et constitue petit à petit un dossier factuel reprenant les échanges avec son directeur ainsi que les faits et gestes inappropriés. Elle donne son accord pour transmission à la présidence. La présidence découvre un dossier avec des preuves permettant de soupçonner un « comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l’encontre de sa doctorante au moyen de propos et de gestes déplacés » : remarques sur la tenue vestimentaire, caresses, pratiques pédagogiques déplacées ainsi que des pratiques administratives illégales. Ce récit s’accompagne d’enregistrements d’échanges téléphoniques entre le directeur de thèse et la doctorante, enregistrements effectués par la doctorante. En fin d’année, la présidence saisit la section disciplinaire et informe le rectorat. Dans les deux mois suivants sa saisine, la section organise trois audiences, puis se réunit quatre mois après la saisine. L’auteur des faits conteste la légalité des enregistrements, invoquant l’obligation de loyauté de l’employeur public. Les membres de la section réfutent cet argument, conviennent de faits inappropriés et décident d’une sanction, à savoir l’interdiction d’exercer toute fonction dans l’établissement pendant 12 mois avec privation totale du traitement. L’avocat de l’auteur demande un sursis d’exécution, invoquant les enregistrements téléphoniques. Parallèlement, l’affaire est largement médiatisée nationalement. Trois mois plus tard, le CNESER rejette la demande de sursis. En cassation, l’auteur demande l’annulation de la décision, le sursis d’exécution et 4 000 euros. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et demande le versement de 2 500 euros à l’établissement. Le Conseil d’Etat reconnaît donc la validité de l’usage d’enregistrements de conversation téléphonique faits à l’insu de l’enseignant-chercheur et estime la sanction justifiée. Il rejette le non-respect supposé de l’obligation de loyauté de l’employeur, l’établissement n’ayant pas lui-même procédé à ces enregistrements. De plus, l’intérêt public majeur (la lutte contre les VSS) les justifie. En conséquence, contrairement au droit civil, en droit pénal et en droit administratif, l’enregistrement des communications à l’insu de leur auteur peuvent être pris en compte dans un cadre disciplinaire.
Cet exemple met en évidence les bonnes pratiques, à savoir la tenue du comité de suivi des thèses et la vigilance des membres, l’écoute de la doctorante par les personnes en charge des VSS dans l’établissement, ainsi que la réactivité de l’établissement puisque la commission a été saisie dès que la présidence a eu connaissance des faits et la décision est intervenue quatre mois après la saisine. Il met aussi en lumière la liberté des modes de preuve en matière disciplinaire.
Questions du public :
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une question : « La longueur des procédures ne fragilise-t-elle pas le dispositif ? »
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Certes, mais la nomination d’un conseiller d’Etat à la présidence du CNESER et l’implication de rapporteurs déjà magistrats visent à professionnaliser la procédure, ce qui devraient réduire les délais à l’avenir.
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
Les obligations réglementaires imposent des délais incompressibles. De plus, se posent aussi des difficultés pratiques pour la tenue des séances disciplinaires, à mettre en lien avec la valorisation de ces missions.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Qu’en est-il des établissements privés ? »
Evelyne Testas, chargée d’études au service de la réglementation (MESRI)
Les établissements privés de relèvent pas du Code de l’éducation pour les dispositions disciplinaires. Celles-ci figurent dans le règlement intérieur de chaque établissement.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
S’agissant de salariés de droit privé, le droit du travail s’applique. On y retrouve les mêmes notions de respect du droit, y compris pour les sanctions.
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
Pour revenir à la longueur de la procédure disciplinaire, nous observons que les établissements ont tendance à attendre l’aboutissement de la procédure en pénal quand intervient l’article 40. Or ces deux procédures peuvent s’engager parallèlement.
Elise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre (MESRI)
Nous savons que le fonctionnement disciplinaire n’est pas idéal, d’où la réforme du CNESER disciplinaire. Ainsi, s’agissant de l’exemple présenté précédemment (exemple 2), dans un recrous sur le fond de la part de l’auteur le CNESER disciplinaire a relaxé le demandeur. Le Conseil d’Etat devrait annuler cette relaxe récente.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Un participant souhaiterait aborder l’externalisation de la procédure disciplinaire (« dépaysement »).
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
Il s’agit, pour de petites structures où tout le monde se connaît, de transmettre le dossier à un autre établissement. Le CNESER l’accepte systématiquement pour un enseignant-chercheur et le refuse parfois pour un étudiant.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Nous avons observé des demandes de dépaysement systématiques, d’où le refus du CNESER pour responsabiliser les établissements.
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
Pour information, le CNESER se réunit tous les mois sauf l’été.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « En ce qui concerne la formation des membres des commissions disciplinaires, existe-t-il des formations dispensées par le ministère ? »
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
Un projet de formation régionale des présidentes et présidents est en réflexion, en s’inspirant de l’esprit de professionnalisation du CNESER. Cependant, une première étape consiste à disposer de guides pratiques et évolutifs pour l’ensemble des acteurs et actrices des procédures disciplinaires. Sur l’enquête administrative, un vade-mecum interne de l’Inspection générale pourrait les aider. Quant au délai de la procédure, une difficulté provient aussi du délai de décision de son engagement.
Rozenn Texier-Picard
En termes de formation sur les VSS, les établissements peuvent contacter le réseau VSS-Formation.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Quand la matérialité des faits est établie et que la protection fonctionnelle est retirée, l’intéressé doit-il rembourser les éventuels frais de justice à l’établissement ? »
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
La protection fonctionnelle, généralement accordée en début de procédure en l’absence d’éléments, crée des droits et doit être retirée dans les quatre mois maximum. Tout dépend donc de la date de la matérialisation des faits.
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
Il existe la possibilité d’une protection fonctionnelle à durée renouvelable.
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Il est aussi possible d’indiquer, dans la décision, que la protection est accordée au vu des éléments disponibles à date.
Hélène Moulin-Rodarie, sous-directrice du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants et enseignants-chercheurs (DGRH-MESRI)
Je précise que la protection fonctionnelle ne peut être accordée qu’au personnel, pas à un étudiant.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Existe-t-il des recommandations de bonnes pratiques sur la communication en interne quand un cas est connu et une enquête en cours, afin de montrer l’action de l’établissement tout en préservant l’anonymat des personnes concernées ? »
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
Pour la bonne conduite de la procédure, nous recommandons une retenue dans la communication.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Comment apporter la preuve de propos sexistes ? » et « S’agissant des VSS, au-delà de la qualification pénale, comment qualifier la faute disciplinaire en cause ? De manière précise, quels droits et obligations peuvent être spécifiquement invoqués ? »
Evelyne Testas, chargée d’études au service de la réglementation (MESRI)
Dans la procédure disciplinaire, il convient de ne pas qualifier pénalement les faits : « tous faits de nature à troubler l’ordre de l’établissement », « faute d’un enseignant », etc.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Comment éviter que l’enquête préalable influence la section disciplinaire ou remette en cause la présomption d’innocence ? »
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Le guide à venir de Jurisup insiste sur ce point : l’enquête préalable doit éclairer la décision du président ou de la présidente de passer à une instruction disciplinaire ou pas. Cependant, si l’enquête administrative est ensuite incluse dans l’instruction disciplinaire, chaque élément devra être soumis au principe contradictoire et l’anonymat levé.
Adrien Levrat, directeur des affaires juridiques de l’université Paris Saclay, Jurisup
La nécessité de s’assurer de faits matériels s’impose pour lancer une procédure disciplinaire. Pour éviter toute confusion, il est recommandé que les personnes menant l’enquête administrative ne fassent pas partie de la section disciplinaire.
Béatrice Noël, cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (MESRI)
Une autre question : « Est-il possible de supprimer la PEDR quand un enseignant-chercheur est sanctionné pour des faits concernant une doctorante ? »
Thierry Reynaud, sous-directeur de la gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires (DGRH-MESRI)
Seules des sanctions existantes peuvent être prises. De plus, cesser de verser la PEDR à un enseignant-chercheur n’est pas possible, car la PEDR récompense une activité passée de recherche et d’encadrement doctoral.
Liens
Vous trouverez à l'adresse ci-dessus les guides relatifs aux sections disciplinaires
Dans la même collection
-
1/6 Discours d'introduction du Ministère, des Conférences d'établissements et de la Direction régio…
BarthezAnne-SophieBalaudéJean-FrançoisDépincéPhilippeRaoult-WackAnne-LucieDemoulinHuguesAvec : Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation ; Philippe
-
2/6 Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au se…
BrunelEliseNoëlBéatriceCe second enregistrement contient deux parties de la journée : 1. Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au sein de l’ESR 2. Prendre en
-
4/6 Présentation du guide « Comment enquêter sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseign…
Lebugle-MojdehiAmandineBrownElizabethCondonStéphaniePrésentation du guide « Comment enquêter sur les VSS dans l’ESR ? » - Intervenantes : par Amandine Lebugle, Elisabeth Brown et Stéphanie Condon Recommandations méthodologiques pour mener
-
3/6 Table-ronde : exemple de dispositifs de signalement et de traitement des VSS et des discriminat…
LiotardPhilippeTisserantPascalTessierNathalieTitre : Table-ronde : exemple de dispositifs de signalement et de traitement des VSS et des discriminations au sein de l’ESR Avec : Anissa Benaissa et Philippe Liotard( CPED); Marion Bulot
-
6/6 Clôture de la journée par Mourad Boukhalfa, directeur de l’INSA de Rouen 20 novembre 2020
BoukhalfaMouradAvec Mourad Boukhalfa, directeur de l’INSA de Rouen
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
2/6 Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au se…
BrunelEliseNoëlBéatriceCe second enregistrement contient deux parties de la journée : 1. Les dispositifs de signalement des violences sexistes et sexuelles et des discriminations au sein de l’ESR 2. Prendre en
Sur le même thème
-
La laïcité vue par des étudiantes et étudiants internationaux de l'EHESS
InoueSubaruSürat AksanMüberraVillaniDavidHermon-BelotRitaPortierPhilippeEn France, le principe de laïcité, bien que globalement perçu positivement, demeure source de débats en raison d’interprétations divergentes.
-
Discriminations à l’ère des plateformes numériques. Le cas de la grossophobie
BourdeloieHélèneLarochelleDimitra LaurenceFerréNathalieCaretteClaireBellichaAliceColloque organisé par Hélène Bourdeloie (maîtresse de conférences à l’Université Paris Nord, chercheuse au LabSIC, en délégation au CIS-CNRS en 2024/25) et Dimitra Laurence Larochelle (maîtresse de
-
Colloque international « (In)justice reproductive : Les droits reproductifs au prisme des rapports …
CarayonLisaSantos RodriguezVictorDans cette vidéo, Lisa Carayon anime une table ronde portant sur les enjeux de justice reproductive et de travail.
-
La discrimination ethno-raciale dans la corporation des Avocat.es
ZribiYasmineLa recherche porte sur la manière dont les rapports sociaux ethno-raciaux participent à la division sociale d’une corporation professionnelle, celle des avocats. Si la formation et la réussite à l
-
Le handicap au pouvoir - Avec Cyril Desjeux
BaudotPierre-YvesDesjeuxCyrilDans le cadre des émissions en direct "Autonomie : l'actu de la recherche", organisées par le Programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie. Lire le compte-rendu écrit : https://ppr-autonomie
-
Les Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
DucretMarie PatriciaDechepy-TellierJohanLes Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
-
Les mots de trop – Guide d’auto-défense pour étudiant·es en art
AlvèsAnaïsBaierlEstelleVelaSophieQue faire de nos colères face aux discriminations subies lorsque l’on est étudiant·es en art, alors même que l’on imaginait ce milieu plus ouvert qu’un autre, peut-être plus safe ?
-
Handicaps et travail #2 - Discriminations en raison du handicap dans l'emploi
DucretMarie PatriciaLefevreDidierDidier Lefevre - Causeries Handicaps - Handicaps et travail #2 - Discriminations en raison du handicap dans l'emploi
-
Table ronde 2/ Le post-capitalisme sera féministe, antiraciste et écologique
VergèsFrançoiseDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
Société inclusive : une question d'actualité - L’approche par la situation
WalkerAlanMeistermannChristianHôteJean-MichelFougeyrollasPatrickComment la primauté à l’interaction entre l’environnement et la personne participe à la refondation de l’action publique et des pratiques professionnelles qui construisent la société inclusive ?
-
Entretien avec Christian Meistermann sur la Société inclusive
MeistermannChristianEntretien avec Christian Meistermann, représentant régional Grand-Est de APF France handicap
-
Le Brésil, vu par Rebecca Lemos Igreja
Lemos IgrejaRebeccaLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire elle accompagne des chercheurs