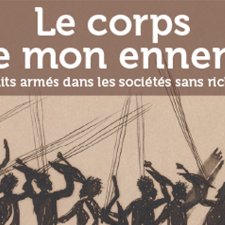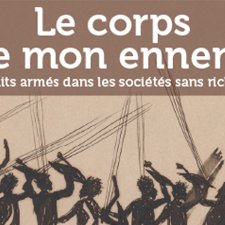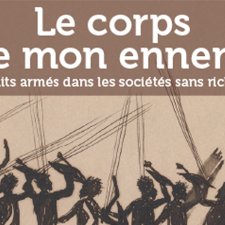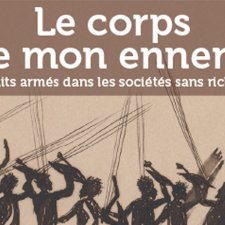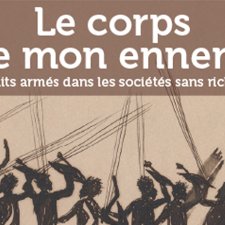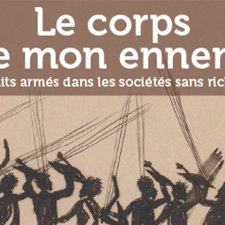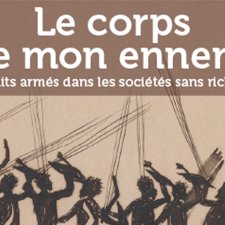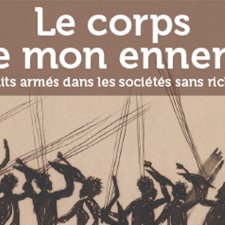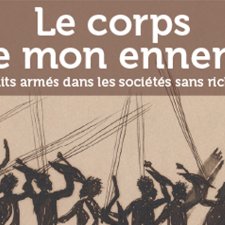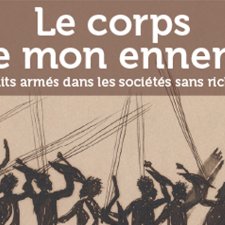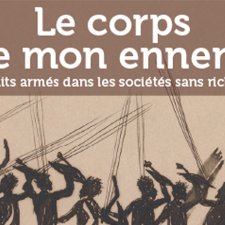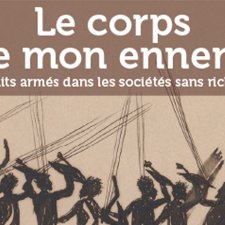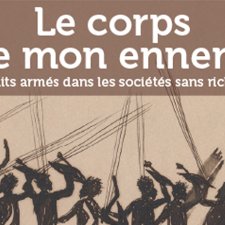Le corps de mon ennemi : conflits armés dans les sociétés sans richesse
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- document 1 document 2 document 3

Descriptif
La guerre provient-elle du fond des âges, voire de notre héritage biologique, ou est-elle apparue à un stade déterminé de l'évolution des sociétés ? À cette vieille interrogation, une partie importante du monde scientifique tend de nos jours à répondre par la seconde proposition, arguant notamment de l'absence de traces convaincantes de conflits collectifs armés pour les périodes reculées et situant l'émergence de la guerre quelque part entre la fin du Néolithique et l'Âge du Bronze.
Pourtant, dans les dernières années, et pour ne parler que de la France, divers travaux sont venus contester cette vision, que ce soit sur la base d'arguments ethnologiques ou archéologiques. À l'échelle internationale, la découverte du charnier de Nataruk, qui fait suite à celle du site de Djebel Sahaba, récemment réétudié, a remis en cause le pacifisme supposé des sociétés de chasseurs-cueilleurs, à tout le moins des plus tardives d’entre elles.
Le sujet est d'autant plus complexe que d'une part, la guerre est un concept souvent mal défini, et que d'autre part les sociétés humaines ont inventé bien des modalités d'affrontements collectifs : l'anthropologie sociale s'efforce depuis longtemps de comprendre comment s'articulent, entre autres, les guerres proprement dites, les feuds (vendettas), les combats dits « ritualisés » pratiqués dans maintes sociétés, mais aussi (liste non limitative) des expéditions parfois qualifiées de « guerre à petite échelle » s'inscrivant dans des relations d'hostilité perpétuelle. Cette variété des formes se double de celle des objectifs poursuivis : la vengeance représente ainsi un motif privilégié d'affrontements. Quant à l'acquisition de ressources, dans laquelle on voit parfois la raison ultime et universelle des hostilités, elle soulève au moins le problème de ces substances corporelles aux effets imaginaires, à commencer par les têtes qui constituent le but premier de nombre d'expéditions militaires, en particulier dans l'Asie du Sud-Est précoloniale.
Ce colloque, tenu dans le cadre des séances de la Société préhistorique française, a réuni préhistoriens et anthropologues sociaux et a laissé une large part à la discussion collective. Il a tenté d'éclairer ces questions en traitant aussi bien des concepts utilisés, des enseignements de la primatologie, de divers cas ethnologiques, que les difficultés soulevées par l'interprétation des traces matérielles.
Vidéos
Le corps de mon ennemi : Introduction générale
La guerre provient-elle du fond des âges, voire de notre héritage biologique, ou est-elle apparue à un stade déterminé de l'évolution des sociétés ? À cette vieille interrogation, une partie
La guerre des concepts
les conflits collectifs échappent encore à une typologie raisonnée. On proposera une classification permettant d'aborder les confrontations sociales, qui se fonde à la fois sur leurs mobiles et sur
Préhistoriographie de la guerre
Il en est un peu de la question de la guerre comme de celle de la pensée symbolique de nos ancêtres préhistoriques : l’inventaire des interprétations produites à son égard en dit souvent plus long sur
Guerre et paix en Australie aborigène
La question de savoir si les groupes de chasseurs-cueilleurs se font la guerre ou non est aussi - et surtout - la question de savoir ce que sont les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les concepts de
Violences sociales à Sumba (Indonésie). Quelle place pour les frontières ethno-linguistiques ?
Les sources antérieures à la prise de possession de l’île de Sumba par les néerlandais, au début du 20e siècle, décrivent un ensemble morcelé formé d’environ 25 groupes ethniques qui se partagent un
La guerre chez les Anga de Nouvelle-Guinée
En Nouvelle-Guinée comme ailleurs la violence collective contre autrui – rixe, vendetta, guerre – ne peut se comprendre qu’en rapport avec d’autres aspects d’une organisation sociale et d’un mode de
Les guerres amazoniennes
À la fin des années 1990, Eduardo Viveiros de Castro a proposé de définir les sociétés amazoniennes et les dynamiques relationnelles qui les caractérisent comme le résultat d’une « économie symbolique
Guerres et conflits dans les mythes
La guerre est une activité si répandue que l’on s’attend à ce que d’innombrables mythes en exposent l’origine. Pourtant, de tels récits sont relativement rares, alors qu’au contraire les divinités
Violences interpersonnelles dans la Vallée du Nil à la Préhistoire
Les ensembles funéraires nous renseignent sur la biologie des sociétés passées, leurs relations sociales et leurs comportements rituels et symboliques. Ils peuvent également nous permettre d’examiner
Les massacres de masse dans le Néolithique centre-européen (5200 - 4000 BC). Un état de la question
Depuis la retentissante et inaugurale découverte du dépôt humain de Talheim, en 1983, les fouilles de structures renfermant des groupes d’individus décédés de mort violente se sont multipliées dans le
La visibilité archéologique des guerres préhistoriques
Discuter de l'existence possible de guerres pendant la Préhistoire pose immédiatement le problème de la faible visibilité archéologique de ces éventuels conflits : comme beaucoup de phénomènes sociaux
Les conflits chez les primates
Depuis Hobbes et Rousseau, la question de l’origine de la guerre chez les humains a suscité de multiples débats et conjectures. L’étude des conflits entre groupes chez nos plus proches cousins, les
La guerre dans tout son état. Discours normatifs sur les conflits armés dans le monde gréco-romain
Il s’agit d’explorer les conceptions dominantes de la guerre dans l’Antiquité classique, en mettant en lumière leur lien avec l’organisation sociale et politique propre au monde des cités-États
Intervenants et intervenantes
Maître de conférences en archéologie préhistorique à l'université de Toulouse-Le-Mirail (en 2009). Professeur à l'Université Toulouse Le Mirail (en 2019)
En poste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès (depuis 2001) et membre du laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (en 2022)
Paléoanthropologue, directrice de recherche au laboratoire PACEA -- De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie -- Université de Bordeaux (en 2024)
Titulaire d'un doctorat en co-tutelle entre l'Université Bordeaux 1 et la Katholieke Universiteit Leuven, spécialité : Anthropologie biologique (Bordeaux 1, 2006)
Maître de conférences HDR en anthropologie sociale à l'Université Paris Cité, membre du Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des Espaces (en 2024). Doctorat : Université Paris 10, 1991
Doctorant au laboratoire Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (en 2024)
Anthropologue, Professeur à l'Université de Lucerne, Suisse (en 2024)
Anthropologue social, membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (en 2024)
Doctorant en anthropologie sociale à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Responsable d'un projet de documentation des pratiques linguistiques yucaré de la fondation DoBes (en 2007)
Conservateur du patrimoine. En poste à la Direction des affaires culturelles d'Alsace, Service régional de l'archéologie (en 1993). - Enseigne l'archéologie à l'Université de Strasbourg (UDS), Antiquités Nationales (en 2012). - Professeur émérite de Préhistoire à l‘Université de Strasbourg, Membre du laboratoire Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (en 2024)
Diplômé de l'École pratique des hautes études (Paléoécologie du quaternaire), docteur en ethnologie, anthropologie et préhistoire (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Préhistorien et mythologue, directeur de recherche émérite au CNRS (en 2024)
Primatologue, Université de Cambridge, Royaume Uni (en 2024)
Ethnologue et anthropologue social, directeur de recherche émérite au Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie (en 2024)
Attaché de recherche en ethnologie au Centre national de la recherche scientifique, Groupe Écologie et sciences humaines (en 1986-1987).
Collaborateur à la Maison du Paludier (Guérande, Loire atlantique), association spécialisée en technologie et arts et traditions populaires (en 1986-1987)
Auteur d'une thèse en Histoire et civilisation de l'antiquité à Paris 4 en 2017
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) en histoire romaine à Sorbonne Université (en 2024)
Titulaire d'un doctorat en Préhistoire-ethnologie-anthropologie à Paris 1 en 2004
Chargé de recherche au CNRS (en 2016)
Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (depuis 2008) et membre du laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (en 2023)
Thèmes
- Guerre et conflits armés
- Conflit (sociologie)
- Mythe
- Restes humains (archéologie)
- Aborigènes d'Australie
- Analyse linguistique
- Anga (peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée)
- Armes préhistoriques
- Chasseurs-cueilleurs
- Civilisation -- Égypte
- Civilisation antique
- Conflits ethniques
- Guerre préhistorique
- Guerre primitive
- Historiographie
- Massacres
- Mythologie comparée
- Néolithique
- Paléoanthropologie
- Primatologie
- Sites archéologiques
- Sumba (Indonésie ; île)
- Tupi (Indiens)