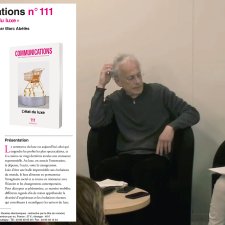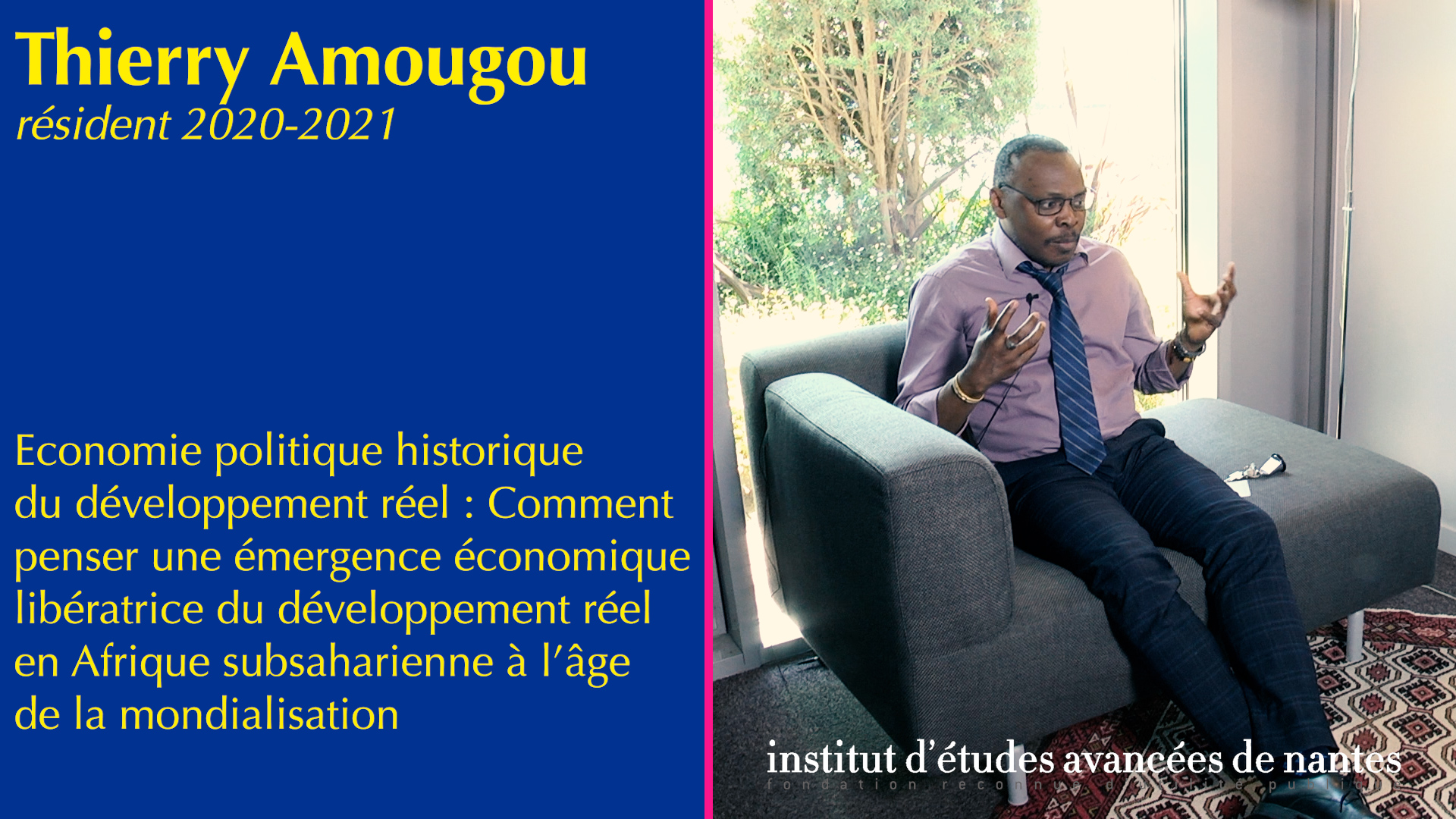Chapitres
Notice
L'économie mondiale à l'ère des flux
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Flux de marchandises, de capitaux, de technologies, d'images, de références culturelles : l'économie mondialisée est celle de toutes les mobilités, à l'exception notable des personnes les moins qualifiées, ou nées dans les pays les plus pauvres. Cette fluidité s'accompagne d'une fragmentation des systèmes productifs qui se déploient désormais à l'échelle du monde, en s'appuyant sur des réseaux de sites de plus en plus homogènes en termes de niveau technologique. Elle s'accompagne aussi d'une concentration croissante des activités au sein d'un archipel de grands pôles interconnectés, par delà la mosaïque des nations et des économies nationales.
Mais ce n'est pas seulement la répartition géographique des activités qui se trouve ainsi bouleversée : c'est la relation entre les espaces qui se transforme en profondeur. L'articulation traditionnelle entre centres et périphéries, pôles et arrière-pays, se délite. Les périphéries et les arrières pays deviennent des charges plutôt que des ressources pour les centres les plus riches et les plus insérés dans l'économie mondiale. Dans les pays développés, comme la France, des mécanismes de redistribution puissants jouent en faveur des zones rurales ou des villes moyennes. Ailleurs, s'applique le « paradoxe de Robin des bois » : la redistribution est la plus faible là où elle serait la plus nécessaire
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Texte de la 599e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 3 janvier 2006
Pierre Veltz : « L'Economie mondiale à l'ère des flux »
L'économie moderne en voie de « mondialisation » est une économie des flux, de la circulation généralisée, de l'extension des mobilités dans l'ordre spatial, de la croissance des vitesses dans l'ordre temporel. Partout, dans les comportements des entreprises et dans nos comportements de consommateurs, s'affiche la préférence pour la liquidité, au sens propre comme au sens figuré. Les entreprises préfèrent désormais louer leurs flottes de voitures, leurs bureaux, voire leurs usines, plutôt que de les posséder. Elles apparaissent de plus en plus comme des assemblages de ressources (fournisseurs, collaborateurs et salariés) qui doivent être aussi flexibles que possible, c'est-à-dire se prêter sans trop de résistance à d'incessantes reconfigurations. Nous-mêmes, citoyens-consommateurs du premier monde, rechignons de plus en plus à ce qui nous ligote trop rigidement à un espace, à une structure sociale ou professionnelle - même si ce besoin de « liquidité » des attaches comporte aussi fréquemment sa face d'inquiétude, voire d'angoisse vis-à-vis de l'ouverture du champ des possibles.
Dans cette conférence, je m'attacherai surtout aux mobilités géographiques qui caractérisent la société planétaire actuelle - mobilité des biens, des services, des capitaux, des idées, des personnes. Je passerai d'abord en revue les grandes composantes du système des mobilités, pour en montrer l'extension, mais aussi pour apporter quelques bémols au discours sur la fluidité universelle. Puis, je présenterai un tableau schématique des implications de ces mobilités sur la géographie d'ensemble des activités : je montrerai que les circulations accélérées et étendues ne créent pas du tout un monde homogène où les activités se disperseraient harmonieusement sur la planète (comme elles pourraient le faire « techniquement », compte tenu des possibilités nouvelles de communications), mais un monde très divisé, fortement polarisé, où un réseau de pôles puissants coexiste avec de vastes espaces « débranchés », espaces de friches plus ou moins exclus du jeu de la croissance mondiale.
- Un monde de mobilités
Nous sous-estimons souvent l'ampleur des circulations qui sont cachées derrière les objets les plus courants que nous manipulons. Quand on dit que le monde s'invite désormais dans nos appartements ou nos maisons, ce n'est pas une métaphore. Et ceci ne résulte pas seulement du nombre d'objets qui sont importés de l'étranger ( made in China, ou in USA, etc.), mais de la fragmentation du système de production et de distribution qui rend ces indications d'origine plus ou moins factices. Car, pour un nombre rapidement croissant d'objets, c'est désormais le « made in monde » qui domine[1]. Donnons quelques exemples. Les fleurs qui ornent votre salon peuvent venir du Kenya, du Maroc, de la banlieue parisienne, du Midi de la France, ou d'ailleurs encore. Mais la chose extraordinaire est que, avec une très forte probabilité, elles sont toutes passées par le marché aux fleurs d'Aalsmeer, en Hollande, qui jouxte l'aéroport d'Amsterdam et qui, tous les jours, voit converger et repartir les fleurs de 7 000 producteurs mondiaux. Une simple brosse à dents, il est vrai un peu sophistiquée, a vu ses 38 composants parcourir au total près de 30 000 kilomètres, avec des pièces venues de Chine, de Taïwan, du Japon, d'Autriche, de Suède, de France, avec des tests aux Philippines, pour être finalement montée en Californie[2]. Le PC portable que vous achetez sous une marque américaine combine des pièces provenant d'une dizaine de pays, et qui sont principalement assemblées par l'un des grands producteurs taïwanais dont vous ignorez probablement les noms mais qui sont les premiers fabricants du monde. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Mais il est utile, pour comprendre la logique d'ensemble de cette fragmentation, de distinguer les divers plans où elle s'exerce (commerce, finance, industrie) et de dresser sommairement le tableau de l'arrière-plan historique.
Les flux à longue distance ne sont pas, évidemment, une nouveauté de la fin du 20ème siècle. Chacun connaît les « routes de la soie », les « routes des épices » et le développement du commerce mondial postérieur aux grandes découvertes du 16ème siècle. Mais il faut mesurer le changement d'échelle de ces opérations lointaines, depuis la mondialisation du 16ème siècle à la période actuelle, pour comprendre que nous sommes en présence d'une rupture qualitative et pas seulement quantitative. Ainsi, de 1500 à 1635, 912 bateaux sont partis de Lisbonne vers les comptoirs de l'empire portugais. 768 d'entre eux sont arrivés à bon port. Cela représente 6 à 7 bateaux, bon an, mal an, partant à la période favorable des vents de mars et d'avril[3]. Le 23 décembre 2005, entrait dans le port du Havre le nouveau porte-conteneurs Othello, capable de transporter 8 488 « boîtes » - soit l'équivalent d'une file de 600 km de camions se suivant sur une autoroute en respectant les distances de sécurité. Et une noria continue de bateaux de ce type relie en permanence les grands ports d'Asie, d'Europe et d'Amérique.
Changement d'échelle radical, donc. Mais aussi, caractère non linéaire d'un processus d'extension des flux qui a connu dans l'histoire ses temps d'ouverture et ses temps de repli. Pour rester dans les périodes contemporaines, on a vu ainsi se succéder trois grandes phases : une très forte ouverture durant les dernières décennies du 19ème siècle, ouverture qui a duré jusqu'à la première guerre mondiale (période souvent appelée « première mondialisation » ou encore « mondialisation anglaise » ou « européenne ») ; un fort repli des échanges internationaux jusque dans les années 1970, avec la constitution d'espaces économiques nationaux très intégrés, dont la France des « trente glorieuses » est un bon exemple ; la phase actuelle de réouverture que certains appellent « deuxième mondialisation » ou « mondialisation américaine ». Mais les deux grands mouvements d'ouverture qui se déroulent à presque un siècle d'intervalle sont très différents, comme on le voit lorsqu'on examine les diverses composantes de l'internationalisation des échanges et de l'extension des interdépendances.
Passons en revue rapidement ces composantes.
Première composante : le c om merce international, l'échange de biens manufacturés, et, à un niveau plus limité, de services. Le ratio habituellement utilisé pour analyser l'intensité de ce commerce est celui des exportations rapportées au produit intérieur brut. Ce ratio (voir graphique) varie globalement selon les pays : les USA, par exemple, sont aujourd'hui encore beaucoup plus tournés vers leur énorme marché domestique que les pays moyens d'Europe, ou a fortiori, des petits pays comme les Pays-Bas ou le Danemark. Mais partout, la période qui va des années 30 aux années 50 marque un point bas. On voit aussi qu'en 2000, l'ouverture des économies européennes est très supérieure à celle de la « première mondialisation ». Ceci s'explique en partie par la création du marché unique européen, mais en partie seulement : car les échanges avec le reste du monde ont également explosé.
Deuxième composante : les mouvements des capitaux, très largement libéralisés depuis les années 80. Ces mouvements sont très complexes, car ils couvrent à la fois les flux à très court terme, qui représentent une énorme circulation quotidienne, et des flux à moyen et long terme. L'internationalisation des entreprises et de la production peut être approchée par l'indicateur des « investissements directs à l'étranger » (IDE ou « FDI », pour Foreign Direct Investment). Ceux-ci sont distingués conventionnellement des « investissements de portefeuille » en ce qu'ils consistent soit à financer des actifs matériels nouveaux (usines, infrastructures, centres logistiques, hôtels, etc.), soit à prendre des participations permettant de peser sur le contrôle de firmes existantes (avec un seuil généralement fixé à 10 %) ces prises de participation pouvant aller bien sûr jusqu'aux fusions transnationales. Or, contrairement à l'évolution du commerce international, dont l'augmentation depuis le milieu du 20ème siècle est continue, sans rupture de rythme notable, ces flux d'investissements sautant par dessus les frontières nationales ont véritablement décollé à partir du milieu des années 80, avec un énorme emballement au moment de la bulle de la « nouvelle économie ». On est ainsi passé de 50 milliards de dollars environ en 1985, soit un montant très faible à l'échelle mondiale, à des montants annuels de 600 à 1 400 milliards de dollars ! Et, alors que les IDE de la fin du 19ème siècle étaient en grande partie consacrés à des équipements d'infrastructure dans les pays émergents de l'époque (Argentine, Russie, Australie, etc.), les IDE actuels traduisent surtout le processus de mondialisation des entreprises elles-mêmes, la place croissante des multinationales, c'est-à-dire des firmes qui ne se contentent pas d'exporter à partir d'une base nationale, mais organisent leur production elle-même à une échelle de plus en plus planétaire. Bien entendu, c'est cette multinationalisation des firmes qui explique la fragmentation des systèmes de production et de distribution évoquée plus haut. On est donc là en présence d'une rupture majeure, qui est d'ailleurs fortement sous-évaluée par le seul chiffre des « investissements directs ». Ceux-ci ne prennent pas en compte, par exemple, le poids des multinationales vis-à-vis des réseaux locaux de sous-traitance, ni les autres formes de croissance à l'étranger, par le réinvestissement des profits, l'appel aux marchés bancaires ou financiers nationaux, etc.. Il faut d'ailleurs noter que, dans ce déploiement non plus international mais véritablement transnational des firmes, les investissements nouveaux pèsent moins que les prises de participation et les fusions-acquisitions[4]. Et il faut surtout souligner que, contrairement aux idées reçues, l'essentiel de ces mouvements qui donnent naissance et remodèlent en permanence d'immenses réseaux de production transnationaux se réalise entre pays du Nord, et même entre zones riches des pays du Nord ! Certes, la part des pays en émergence comme récepteurs d'investissements internationaux est en forte croissance, surtout depuis 2002. Mais ces flux du Nord vers le Sud et l'Asie en émergence ne dépassent pas un tiers du montant global des IDE. Ainsi, les investissements étrangers en Chine représentent bon an mal an l'équivalent des investissements étrangers en France, pays toujours bien placé dans le palmarès de l'attractivité, malgré le discours pessimiste sur le « mauvais climat des affaires » ! De plus, ces flux en direction des pays en développement sont concentrés sur une liste très réduite de pays. Les autres pays, c'est-à-dire l'immense majorité des pays en développement, comprenant pratiquement toute l'Afrique, sont totalement ou quasi-totalement exclus du jeu. Enfin, ce tissage mondial de sites appartenant aux mêmes entreprises et se répartissant les phases de production des mêmes produits a complètement changé la nature du « commerce international » évoqué plus haut. On estime, en effet, qu'un tiers des échanges dits « internationaux » sont en réalité des flux internes aux multinationales (flux de composants ou de biens intermédiaires, comme lorsque Renault fait venir une pièce d'une usine espagnole pour la monter en France) et qu'un autre tiers est constitué de flux reliant ces multinationales à des fournisseurs ou à des clients.
Troisième grande composante : les idées, les connaissances, les technologies. On se ferait une image très fausse de la mondialisation en pensant qu'elle se borne à des échanges marchands ou financiers. Même en restant strictement dans le domaine de l'économie - sans parler, donc, des dimensions essentielles de la culture, des représentations, de la politique - la circulation des idées, des informations et des technologies en dehors de la sphère marchande (c'est-à-dire en dehors des accords de licence ou des redevances liées à la propriété intellectuelle) joue un rôle essentiel. La connaissance directe des produits, les voyages, le rôle médiateur de la science, qui dans beaucoup de domaines est désormais très proche des techniques industrielles, les médias, l'Internet : autant de vecteurs qui permettent une circulation sans précédent des composantes immatérielles de l'économie et qui font que la distance géographique ne joue plus vraiment un rôle de frein à la diffusion de l'innovation (et donc aussi, cesse de jouer un rôle de protection face à l'imitation et au rattrapage technique par les pays moins avancés). Les nouveaux produits, biens ou services, se copient et se disséminent très vite. Le « synchronisme » technologique est la norme - même si les courbes d'adoption des nouveaux produits sont encore parfois décalées selon les pays. Mais, parallèlement, les foyers où se forgent les innovations marquantes sont de plus en plus concentrés géographiquement. Chaque grand domaine d'innovation (l'informatique, la biotechnologie, etc.) s'appuie ainsi sur un nombre limité - et de plus en plus limité - de pôles fonctionnant en réseau à l'échelle mondiale. Ces pôles sont très majoritairement concentrés dans les zones riches du Nord (par exemple, pour l'informatique : la Californie, Boston, Israël, les pays scandinaves). Mais, de plus en plus, les grands pays du Sud (Inde, Chine, Brésil) entrent dans la ronde, grâce à leur matière grise et au dynamisme de leur jeunesse. Et c'est un changement majeur pour la planète.
Quatrième et dernière grande composante : les hommes. C'est ici que le bémol par rapport à l'idée d'une fluidité universelle s'impose le plus. Car, dans ce monde où tout bouge, les hommes restent de loin la ressource la moins mobile. Par choix parfois : comme en Europe, où la mobilité résidentielle est faible et où les entreprises vont à la rencontre des populations, plus que l'inverse. Par obligation, souvent : pensons aux barrières opposées à la mobilité des plus pauvres, contradiction profonde installée au sein de la vision « libérale » dominante du monde. Le contraste est ici spectaculaire avec « la première mondialisation ». Rappelons que de 1846 à 1924, 55 millions de personnes ont quitté l'Europe ! Hervé Le Bras a calculé que, si les paysans chinois quittaient la Chine pour des régions aux salaires plus élevés au même rythme que les Italiens du sud ont quitté l'Italie dans les années 1910, ils seraient 25 millions par an à quitter la Chine ![5] Avec le problème du changement climatique, ce problème de la pression migratoire des pays pauvres et des énormes écarts qui se focalisent sur certaines frontières (USA- Mexique, Afrique-Europe surtout) est sans doute le plus aigu des problèmes que la société mondiale doive affronter dans les décennies qui viennent. Car, sans parler même des difficultés que vont rencontrer les pays du Nord pour garder une capacité de travail compatible avec le vieillissement de leur population, l'endiguement actuel des mobilités n'est pas « soutenable », ni éthiquement, ni pratiquement. Comme le note P. Van Parijs[6], si on veut éviter que les pauvres du Sud migrent trop massivement vers le capital du Nord, il faut sans doute accélérer, et non freiner, le déplacement du capital vers le Sud, c'est-à-dire encourager les « délocalisations » qui en réalité, comme je l'ai dit, ne vont aujourd'hui qu'assez faiblement vers les pays en émergence et très marginalement vers les pays les moins développés.
Pour achever ce tour d'horizon, disons enfin un mot des raisons qui ont rendu possible cette extension des échanges et ce déploiement mondial transnational des systèmes productifs. La première est bien sûr la diminution progressive des obstacles financiers et réglementaires aux échanges, diminution continue depuis la deuxième guerre mondiale en ce qui concerne les tarifs douaniers, plus récents en ce qui concerne les mouvements de capitaux. Jusque dans les années 80, cette « libéralisation » a surtout concerné les pays riches du Nord. Avec l'éclatement du bloc soviétique, l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'abandon progressif des politiques protectionnistes des pays émergents (en Amérique latine notamment), elle s'est aujourd'hui pratiquement généralisée.
Le deuxième grand facteur est la réduction continue et spectaculaire des coûts de communication, pour les transports physiques, de voyageurs comme de marchandises, pour l'information, qui circule aujourd'hui quasi gratuitement, réduction qui va de pair avec l'augmentation des capacités de coordination à distance des activités grâce à l'informatique. Une mention spéciale doit être faite ici pour le transport maritime qui constitue la véritable colonne vertébrale de la mondialisation manufacturière. Grâce à l'invention géniale du conteneur (c'est-à-dire d'une « boîte » normalisée pouvant utiliser toutes les infrastructures portuaires du monde, les navires et les camions)[7] et grâce à la massification des flux résultant de l'utilisation de navires de plus en plus gigantesques, tout se passe, en termes de coût, comme si les océans n'existaient pratiquement plus, du moins pour des marchandises de dimension modeste. Par exemple, le coût de transport de Singapour à Marseille ne dépasse guère 4 dollars pour un poste de télévision. Et on estime souvent, pour faire image, que le coût de transport d'une marchandise sur une longue distance se décompose grosso modo en trois tiers : un tiers pour le transport à longue distance proprement dit (Singapour-Marseille, par exemple), un tiers pour les corridors terrestres permettant une certaine massification (Marseille-Lyon, par exemple), un tiers pour le transport terminal (Lyon-Annecy, par exemple). On peut donc penser que, même dans l'hypothèse d'une augmentation très forte du coût de l'énergie, le transport maritime à longue distance, qui est relativement écologique en termes d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre, serait moins affecté que les transports terrestres à moyenne distance, confortant ainsi l'intérêt d'un regroupement d'activités à proximité des zones côtières. En revanche, le transport aérien de marchandises, qui s'est aussi considérablement développé (il représente aujourd'hui 25 % en valeur des échanges mondiaux), devrait sans doute être sérieusement réduit. Pour finir, notons que, s'il y a bien des changements profonds dans les transports, on ne peut cependant pas parler d'une « révolution » des transports comparable à ce qu'a été la révolution du chemin de fer au 19ème siècle. Le train a vraiment bouleversé l'économie et la géographie du monde après 1850. Aujourd'hui, la réduction du coût des transports est au moins autant une conséquence de la mondialisation (qui permet la massification et des économies d'échelle considérables) qu'une véritable cause. La révolution contemporaine comparable à celle du chemin de fer est incontestablement celle des télécoms et d'Internet - et ses conséquences sont encore loin d'être complètement déployées.
- Une nouvelle géographie ?
Si l'on regroupe, en les synthétisant, les données précédentes, on voit qu'elles dessinent une organisation économique du monde sensiblement différente de celle des décennies d'après-guerre. On peut résumer les tendances principales en se référant à trois grands schémas traditionnels, qui sont tous trois déstabilisées par la mondialisation actuelle.
Le premier est le schéma fondamental de l'économie internationale, c'est-à-dire le modèle « à la Ricardo » du monde comme un ensemble d'économies nationales échangeant entre elles sur la base de leur spécialisation et de leurs « avantages relatifs ». L'idée essentielle, qui constitue le socle des théories classiques du commerce international et qui s'est incarnée assez largement dans la réalité, est que chaque pays est caractérisé par une dotation relativement fixe des facteurs de production et qu'il a intérêt à se spécialiser dans le secteur où il est « relativement » (en interne) le plus productif (c'est-à-dire où il réalise le plus de produits avec le moins de ressources). Mais aujourd'hui les firmes sont mobiles, de même qu'une grande partie des actifs-ressources (la possession des matières premières, par exemple, n'est plus un déterminant essentiel de l'économie, sauf pour la minorité des pays vivant de rentes comme la rente pétrolière). Les firmes comparent les pays et se localisent en fonction d'avantages « absolus » (c'est-à-dire, par exemple, des coûts comparatifs des ressources dans les divers pays, des réglementations et des fiscalités comparées, etc.). En réalité, les entreprises mettent d'ailleurs de plus en plus directement en concurrence des sites (des villes, des régions) plutôt que des espaces nationaux. Certes, il serait faux de dire, comme on l'entend parfois, que les « économies nationales » ont disparu. En particulier, les systèmes d'acteurs, les relations banque-industrie, par exemple, ou les relations entreprises-universités, restent très fortement marqués du sceau national. Mais les tissages transnationaux des grands réseaux d'entreprises ont profondément changé la donne.
Le deuxième schéma classique est celui du « cycle international du produit ». L'idée essentielle, qui traduit bien la situation des années 1950 à 1970, est que les innovations, de produit comme de procédé, naissent dans un pays donné (celui du marché le plus vaste et le plus riche, donc le plus sophistiqué : en l'occurrence les USA), puis se diffusent en couches successives vers des pays moins avancés (l'Europe, puis les pays du Sud) au fur et à mesure que produits et procédés se banalisent et se standardisent. Ceci était parfaitement illustré par le décalage temporel entre les courbes d'adoption des nouveaux produits dans les années du « rattrapage » européen, entre les USA et l'Europe. Grosso modo, il suffisait alors de voir ce qu'était le marché américain dans le domaine des machines à laver ou des télécommunications pour savoir ce qu'il serait 5 ans plus tard en France, 10 ans plus tard en Grèce. Or, là encore, ce schéma est complètement remis en cause par le synchronisme actuel. Les innovations se diffusent en même temps dans les pays riches, et même dans les pays pauvres, pour la partie aisée de la population. Et, comme on l'a dit, leur développement est très lié à des pôles régionaux (comme la Silicon Valley) plutôt qu'à des pays.
Le troisième schéma est celui qui étageait clairement les pays selon qu'ils appartiennent à l'ensemble démocratique du Nord, au bloc de l'Est, au Tiers-Monde fournisseur de matières premières ou aux pays émergents placés sous le régime du « protectionnisme éducateur » (ou des industries dites de « substitution d'importation »). Entendons par là les pays comme l'Argentine ou le Brésil, entrés dans l'ère industrielle, mais protégeant leur secteur productif moderne pour lui permettre de se développer malgré une productivité sensiblement plus basse que celle des vieux pays développés. Là aussi, ces distinctions ont volé en éclat, en raison de l'ouverture généralisée. Les sites productifs des pays émergents sont désormais en concurrence frontale avec des pays du Nord. Ils sont d'ailleurs souvent aussi productifs, voire plus productifs car plus récents, que les sites historiques des vieux pays industriels. Par exemple, avant l'ouverture du début des années 90, les usines brésiliennes de production automobile (même appartenant à des multinationales comme VW ou General Motors) était sensiblement moins productives que celles des pays du Nord. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : les nouvelles usines brésiliennes de l'automobile sont parmi les plus efficaces du monde, et les unités sidérurgiques brésiliennes d'Arcelor figurent dans le peloton de tête des usines du groupe.
Le point commun à ces bouleversements, on le voit, est que l'échelle pertinente d'analyse semble être de moins en moins l'économie nationale - chaque pays étant considéré comme une sorte de plaque relativement homogène - mais le « site » ou la « région ». De fait, l'ouverture générale des échanges se traduit par l'émergence d'un archipel mondial d'îlots de haute efficacité, intégrés dans des réseaux transnationaux, mais souvent décalés par rapport à l'environnement général des pays où il se trouvent. Les inégalités internes aux pays deviennent souvent plus importantes que les inégalités moyennes entre pays : les cas de la Chine, de l'Inde ou du Brésil, illustrent cela parfaitement. Il y a autant, et sans doute plus, de différence entre Bangalore, métropole high tech indienne faisant partie de l'archipel des zones les plus avancées, et un état comme le Bihar qu'entre l'Inde « moyenne » et l'Europe, par exemple. Et les entreprises d'informatique vont à Bangalore, pas en Inde !
Cet effet de la transnationalisation de l'économie avancée qui dessine une sorte de vaste réseau mondial, au prix de contrastes saisissants entre les sites modernes et leur environnement, se conjugue avec d'autres effets de polarisation, plus généraux, pour renforcer le poids des principales régions urbaines dans l'économie mondiale. J'ai développé et détaillé ce thème dans mon livre « Mondialisation, villes et territoires », (Puf, 2005) et je ne rappelle ici que les faits les plus saillants : concentration rapidement croissante de la richesse, mais aussi de la pauvreté, dans les plus grandes agglomérations, souvent « hybrides » (partagées entre le premier et le tiers monde, comme Bombay ou Sao Paulo) ; dynamisme remarquable des cités-Etats et, de manière plus générale, des petits pays dotés d'une forte cohérence institutionnelle et culturelle ; caractère extrêmement inégal de la croissance dans les pays émergents au profit des grands pôles, souvent côtiers ; fonctionnement en réseau horizontal des grandes villes-régions, qui, pour une large part de leur activité, sont traversées par les mêmes réseaux mondiaux (par exemple, dans la finance ou la haute technologie) et reliés par des diasporas multiples (Chinois, Indiens, etc.). Il y a de bonnes raisons, évidemment, à cette polarisation. La principale d'entre elles, paradoxalement, est la fluidité même des échanges à longue et moyenne distance ! Cette fluidité, en effet, permet de traiter de vastes marchés extérieurs pratiquement comme des marchés domestiques. Le marché « intérieur » de Singapour, c'est le monde ! Et elle permet, en même temps, la libération et l'expression de tous les avantages de l'agglomération, avantages qui ne peuvent pas se révéler lorsque les communications ne sont pas fluides. C'est d'ailleurs ce qui s'était déjà passé avec le chemin de fer : loin de conduire à l'étalement généralisé des activités et à la fin des villes, scénarios prédits à l'époque par de nombreux observateurs, le développement du rail avait conduit, au 19ème siècle, à une vague de concentration urbaine sans précédent. Aujourd'hui, « télécommuniquer » avec un interlocuteur est aussi facile à 10 000 kilomètres qu'à 100 mètres. Ceci, par contraste, accentue la valeur de ce qui n'est pas télécommunicable, et l'intérêt de discuter en face-à-face des points compliqués ou litigieux. Même les internautes ont besoin de se rassembler physiquement. Ainsi, il est étonnant de voir que la communauté Linux - c'est-à-dire ces informaticiens qui construisent collectivement, selon des procédures très strictes mais parfaitement « délocalisées », un système d'exploitation concurrent de Microsoft, s'est trouvé une base physique à Beaverton, dans la banlieue de Portland (Oregon), où se crée un éco-système particulier de l' « open source », auquel participent d'ailleurs IBM ou Intel[8]. Au bout du compte, il ne faut donc pas s'étonner de constater que, loin de provoquer la dispersion générale des activités sur le territoire, l'économie moderne de fluidité s'appuie sur des tissus fortement concentrés, qui fonctionnent un peu comme les foyers nerveux et les centres commutateurs du système mondial. Ceci amène à compléter l'image de la fragmentation généralisée des activités présentée en commençant, et qui ne présente en fait qu'une des faces de la mondialisation productive. D'une part, il faut souligner que cette fragmentation est plus ou moins praticable selon le type d'activité dont il s'agit. Des activités routinières, très fortement normées et formatées, peuvent être scindées géographiquement et coordonnées à distance. Pour d'autres activités, cette coordination à distance est beaucoup plus difficile, malgré la panoplie d'outils de télécommunications dont on dispose aujourd'hui, et ces activités se développent plus facilement au sein d'écosystèmes locaux, où les relations informelles jouent un grand rôle. D'autre part, même les réseaux d'activités standardisées et très fragmentées s'appuient le plus souvent sur des pôles très concentrés, parmi lesquels ont trouve à la fois des centres spécialisés (on parle souvent, à ce sujet de grappes ou « clusters ») mais aussi et surtout les grands tissus métropolitains. Fragmentation et polarisation, réseaux planétaires et métropoles mondiales sont donc les deux faces d'une même réalité.
Pour terminer, interrogeons-nous sur ce que devient dans ce contexte le traditionnel rapport entre les pôles et leurs arrière-pays, entre les centres et leurs périphéries, à diverses échelles. Cette articulation centre-périphérie est au cSur de l'image que nous nous faisons spontanément de la structure géographique. Or il importe de bien prendre la mesure de sa remise en question actuelle.
Le modèle de base est ici celui du rapport ville-campagne, tel qu'il fonctionne depuis des siècles. La campagne nourrit la ville (au sens propre d'abord, mais aussi au sens figuré, notamment par l'exode rural, temporaire ou définitif). Inversement, la ville redistribue vers la campagne, lui fournit des outils manufacturés, la connecte au reste du monde. Ce schéma a prévalu à de multiples échelles : le bourg rural et sa petite région, Venise et sa Terre ferme, Paris et les campagnes françaises, etc. Avec le chemin de fer, au 19ème siècle, ce schéma se dilate bien au-delà des limites que lui a longtemps imposées l'extrême viscosité des transports terrestres - y compris dans un pays comme la France, doté depuis longtemps d'un bon réseau de routes. Un cas exemplaire est ici celui de Chicago qui, grâce au chemin de fer, va passer en un temps record de statut de petite bourgade à celui de métropole commandant et façonnant, dans une étonnante réciprocité d'influence, tout le Centre-Ouest américain. Le livre de W. Cronon, qui montre comment Chicago crée littéralement cette nouvelle Amérique rurale, puis industrielle, et comment, en retour, tout cet immense arrière-pays fait vivre la mégalopole, en est une démonstration fascinante[9]. On pourrait aussi évoquer, plus près de nous dans le temps et l'espace, la façon dont le territoire français s'est organisé durant les décennies d'après guerre en arrière-pays industriel des métropoles (surtout Paris), à travers un couplage étroit entre les centres de décision métropolitains et des ateliers de production se déployant dans les anciennes provinces rurales, en captant la main-d'Suvre disponible : par exemple en transformant les filles du fermier normands en ouvrières de Moulinex.
Or il me semble que les choses ont commencé à changer en profondeur et pourraient évoluer dans le sens d'un découplage croissant, à diverses échelles, entre les centres et les arrière-pays. D'abord, la dissociation fonctionnelle avec les espaces ruraux proches est achevée. Les liens rapides, comme le TGV, étendent les espaces centraux en réseau en enjambant et en traversant comme dans un tunnel les espaces intermédiaires. L'arrière-pays des villes, de plus en plus, est constitué d'autres villes, parfois lointaines. Mais surtout, il se passe ceci : les villes riches n'ont plus besoin, en partie pour des raisons technico-économiques d'évolution des systèmes productifs, des arrière-pays plus pauvres. Du statut de ressources, ceux-ci basculent vers le statut de charges ! Dans la France actuelle, par exemple, ce sont les métropoles (l'Ile-de-France en tête) qui assurent désormais l'essentiel de l'insertion dans l'économie mondiale, les autres territoires vivant souvent grâce à des effets de redistribution liés d'une part aux dépenses publiques et aux transferts de l'Etat-providence, mais aussi aux transferts privés (par la mobilité de la consommation, le tourisme, les résidences secondaires, etc.). Pour l'heure, ceci n'est guère ressenti en France comme une charge indue pour les zones métropolitaines. Mais, comme chacun sait, ce n'est pas le cas en Italie du Nord, qui considère comme inutile et néfaste la redistribution opérée vers le Sud. L'ancien responsable du Mac Kinsey pour le Japon, K. Ohmae, a théorisé ce nouveau modèle de centre débarrassé d'une périphérie devenue charge inutile. Pour lui, le schéma idéal est celui d'une région urbaine autonome de quelques millions d'habitants (pas trop, pour ne pas augmenter les effets de congestion et les dérives bureaucratiques) s'adressant directement au marché mondial et concentrant les talents. C'est un modèle séduisant. Mais que devient le reste du monde ? Que deviennent les immenses espaces laissés en friche par les transformations géopolitiques des dernières décennies (le déclin de l'empire russe par exemple) ? Que deviennent les masses pauvres d'Afrique et des autres continents dans une mondialisation technologique qui n'a plus besoin, pour satisfaire la demande pourtant rapidement croissante des riches, d'une main-d'Suvre nombreuse et peu qualifiée ? Allons-nous vers un monde où l'archipel développé devra reconstruire des murailles pour se protéger des barbares ? N'y sommes-nous pas déjà ?
[1] Voir à ce sujet les résultats d'une grande enquête menée par le MIT, Suzanne Berger, Made in monde, Seuil, 2006.
[2] Exemple emprunté à Der Spiegel - Numéro spécial. « Die Neue Welt », n° 7, 2005.
[3] Voir Jean Meyer, L'Europe et la conquête du monde, Armand Colin, 1996
[4] Ainsi, le très fort pic de 2000 et la chute de 2001 traduisent la bulle dite de la nouvelle économie et son éclatement, de nombreuses acquisitions transnationales ayant été réalisées au prix très surévalué des actions de l'époque.
[5] Voir Hervé Le Bras, L'adieu aux masses, Editions de l'Aube, 2003
[6] Voir P. Van Parijs, in Ethique et marché (F. Mertz, ed), L'Harmattan, 2004
[7] La première ligne de porte-conteneurs a été créée en 1956 entre Newark et le Texas, par Mac Lean.
[8] Linux s'enracine dans la Silicon Forest, Les Echos, 21 septembre 2005, p. 23.
[9] William Cronon. Nature's Metropolis. Chicago and the Great West, Norton, 1991
Liens
Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences
CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur
UTLS sur Lemonde.frLe monde
La conférence du 03/01/06 en mp3partenaire des UTLS
Le texte de la conférence du 03/01/06 en pdfdiffuse en audio les conférences en partenariat avec le CERIMES
Dans la même collection
-
Variétés du déplacement - Yves Michaud
MichaudYvesL'ensemble de ces conférences aura permis de se faire une idée d'un monde où les déplacements à grande échelle tiennent une place essentielle - un monde mobile et fluide, pour ne pas dire liquide. Ce
-
Tourisme et culture surgelée
TilroeAnnaL'art et la culture deviennent de plus en plus des produits comme les autres, et les stratégies de marketing commencent à égaler celles du commerce. Le monde de l'art, par exemple, se manifeste
-
Le tourisme et les institutions culturelles
FourteauClaudeL'irruption du tourisme culturel de masse, il y a une trentaine d'années, a pris au dépourvu musées, monuments et sites. C'est alors que les opérateurs professionnels du tourisme, détenteurs du choix
-
Le tourisme culturel - Claude ORIGET DU CLUZEAU
Herrmann-Origet du CluzeauClaudeLe tourisme culturel tient une place exceptionnelle tant dans l'activité touristique en Europe que dans l'audience des musées, monuments et évènements culturels. Les contenus des séquences culturelles
-
Les industries du voyage
LanquarRobertPeut-on parler d'industrie pour un secteur économique où 99% des entreprises sont des PME, et à plus de 90% des microentreprises ? L'importance actuelle du tourisme est la conséquence d'une mesure
-
Le touriste - Jean Didier URBAIN
UrbainJean-DidierBien que tôt reconnu dans son ampleur sociale et économique, à travers ledit « phénomène » touristique et la précoce « industrie » du tourisme qu'il a suscités, le touriste a cependant été longtemps
-
Mobilité et inégalités sociales - Eric LE BRETON
Le BretonÉricDans notre société dispersée, les positions sociales des personnes dépendent, pour partie, de leurs capacités à se déplacer. Les classes sociales sont en quelque sorte redéfinies par les mobilités. Le
-
Les nouveaux visages du migrant - Dana Diminescu
DiminescuDanaTous les courants de réflexion sur le phénomène migratoire contemporain (et notamment les théories des réseaux transnationales) s'accordent sur le fait que les migrants d'aujourd'hui sont les acteurs
-
Les courants migratoires vers l'Europe - Jean-Claude CHESNAIS
ChesnaisJean-ClaudeLes migrations sont un facteur central de la régulation démographique, qui change la face des continents. La "transition migratoire", si oubliée, fait partie de la "transition démographique"
-
Ville compacte, ville diffuse - Francis Beaucire
BeaucireFrancisLa forme des villes, entendue comme la forme de l'espace urbanisé et de la répartition de ses fonctions, a évolué au fil du temps en fonction des opportunités offertes par les moyens de transport mis
-
Quelle mobilité pour quelle urbanité? - Jacques LEVY
LévyJacquesLa mobilité ne se réduit pas au simple déplacement. Rapport social au changement de lieu, elle comprend une partie non actualisée, d'autant plus importante que l'accessibilité s'étend. La mobilité est
-
Le mouvement dans les sociétés hypermodernes - François ASCHER
AscherFrançoisLa modernité a toujours eu indissolublement partie liée avec le mouvement, qu'il s'agisse du mouvement des idées, des biens, des personnes, des informations, des capitaux . Mais l'entrée dans la «
Sur le même thème
-
Le vin argentin au défi de la mondialisation
CerdáJuan ManuelGuibertMartineÀ la fin du XIXe siècle, la structure agraire de la province de Mendoza, au pied des Andes argentines, s’est organisée autour de la petite propriété vitivinicole.
-
Table ronde 2/ Gauches mondiales et mouvements anti-systémiques : Discussion générale
MassiahGustaveVergèsFrançoiseBojadžijevManuelaAguirre RojasCarlos AntonioEn 2023, la Fondation Maison des sciences de l’homme fête ses 60 ans. Dans ce cadre, un colloque international autour de l’œuvre de Immanuel Wallerstein et sur son impact, intitulé « Capitalisme,
-
La mondialisation et les transformations récentes de la société marocaine
LabariBrahimBrahim Labari nous présente une étude qui s'est appuyée sur trois cas dans la région d'Agadir : un centre d'appel, une usine d'habillement et une entreprise agricole. Il explique les facteurs
-
Istanbul, ville-monde
PeraldiMichelA Istanbul, ville monde, placée comme une sorte de pivot en Méditerranée, à la jonction de deux continents, trait d’union de multiples courants, Michel Peraldi évoque l’économie de bazar pratiquée par
-
Marrakech, ville des possibles
PeraldiMichelMarrakech, ville de tous les possibles, qui d’une petite ville provinciale est devenue un des « spots » du tourisme mondial.
-
L'état du luxe : soirée autour du numéro 111 de la revue communication
AbélèsMarcCarnevaliBarbaraD'ErcoleMaria CeciliaGuindaniSaraDarrigrandMarietteLe commerce du luxe est aujourd’hui l’un de ceux qui engendrent les profits les plus spectaculaires, et il a été marqué ces vingt dernières années par une croissance exponentielle. La
-
Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation
PliezOlivierConférence d’Olivier Pliez (CNRS, ArtDev), « Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation ».
-
L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ?
ValletÉricConférence d'Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ? ».
-
Un conteur syrien à Paris en 1709
HeybergerBernardConférence de Bernard Heyberger, Historien (EHESS, EPHE, CéSor), "Un conteur syrien à Paris en 1709".
-
Le café, un marché mondialisé
JimenezJeanPouzencMichaëlCe grain nous brosse une rapide présentation de la situation caféière mondiale, surtout au plan agronomique, économique et social. Le but est de montrer quels sont les acteurs et les enjeux de la
-
Les horizons (cosmo)politiques du mouvement de lutte contre le réchauffement climatique
Le sens politique du mouvement qui émerge en septembre 2018 autour des marches pour le climat reste à élucider. Que signifie politiquement un engagement qui invite les gouvernements à écouter les
-
#180 - Thierry Amougou - Economie politique historique du développement réel : Comment penser une é…
La question du développement industriel des pays africains ne s’est jamais posée dans les mêmes termes d’une période à l’autre. Elle se transforme et se renouvelle d’un paradigme interprétatif