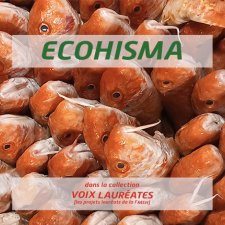Notice
MRSH Caen
Les installations de pêche sur le littoral bas-normand à l'époque de Le Masson du Parc
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été prononcée dans le cadre du séminaire annuel du pôle maritime de la MRSH, dont les thématiques 2010-2011 concernent les ressources marines.
Cyrille Billard est conservateur en chef du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie, au service régional de l'archéologie. C'est dans le cadre de travaux archéologiques qu'il s'est intéressé aux pêcheries de Normandie au début du XVIIIe siècle.
Résumé
A partir du XVIème s., le Roi cherche à se substituer au seigneur par la mise en place du Domaine de la Couronne. Les pêcheries sont l'objet de vives critiques : principalement, pour cause de destruction du frai et de faiblesse des recrutements pour la Marine de l'Etat (les exploitants de pêcheries n'étant pas inscrits maritimes). En mars 1584, une ordonnance du Roi de France Henri III interdit bon nombre de pêcheries sur l'estran : « Les pêcheries et parcs faits et construits depuis 40 ans au bord des grèves de mer, baies et embouchures de rivières, seront démolis et abattus. Les propriétaires seront déchargés des redevances qu'ils nous en pourront devoir ou à quelqu'autre seigneur qui prétendrait avoir droit de fief desdits parcs et pêcheries». Interdiction est faite de pêcher du frai et d'utiliser une maille de filet inférieure à celle autorisée pour la pêche au hareng . Par conséquence, seules pouvaient être maintenues les pêcheries dont l'exploitant pouvait justifier de titres de propriétés antérieures à 1544. Cette donnée explique la conservation d'archives anciennes chez des particuliers encore propriétaires de pêcheries ou d'archives notariales remontant parfois jusqu'au XIVème s..
En 1723, les parcs et pêcheries sont clairement accusés d'être la cause de la disparition de la ressource avant même les visites d'inspection de F. Le Masson du Parc. Celui-ci est chargé d'examiner si « les pêcheries exclusives sont conformes aux articles de 1681 et 1684 relatifs aux parcs de pierre, aux parcs appelés bouchots, aux parcs de bois et filets », et de s'informer si « les seigneurs s'arrogent des droits sur les parcs et pêcheries, sur les pêches faites en mer ou sur les grèves » ; « s'ils s'attribuent quelque étendue de mer pour y pêcher exclusivement ; sur quels titres ils se fondent ».
Il parcourt le littoral de paroisse en paroisse en pénétrant dans les maisons des pêcheurs pour y vérifier les instruments et les filets utilisés, amis également en se déplaçant à basse mer pour observer les techniques de pêche. Si en 1724 il est assez peu précis sur la description des pêcheries exclusives, il s'y attarde beaucoup plus lors de sa deuxième visite en 1730.
A partir des données d'archives de cette époque, notre inventaire a porté sur les installations fixes et semi-fixes observées sur le littoral du Calvados et de la Manche. Par installation fixe, nous entendons des barrages de bois ou de pierre sans usage de filet, à l'exception du dispositif de capture (en particulier bache ou verveux). Ces installations fixes correspondent pour la période qui nous concernent à des pêcheries auxquelles sont attachés presque systématiquement des titres de propriété ainsi que des noms : elles recouvrent le terme de « pêcheries exclusives » en usage à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire appartenant à une personne par « privilège ».
Par installation semi-fixe, nous entendons des installations de filets tendus sur des pieux ou des piquets, et pouvant être démontées entre deux saisons de pêche (guideaux à bas-étaliers, haut-parcs, bas-parcs, macrolières...). Ce type d'installations peut être lié à des droits de pêche, mais en aucun cas à des titres de propriété. Ces droits de pêche mentionnent un secteur géographique, éventuellement un nombre d'installations. Enfin, aucun nom ne leur est attaché.
Il va de soi que la limite entre installations semi-fixes et toutes les autres utilisant des filets est parfois mal définie. Par exemple, certains types d'installations telles que les flues ou folles ou macrolières, principalement destinées à la pêche des poissons plats et des oiseaux marins, sont tantôt posées sur des piquets tantôt « flottées et pierrées » sans l'utilisation de pieux.
La typologie des installations permet de distinguer parmi les pêcheries exclusives : des parcs de pierres en V, des écluses en pierre (en référence aux écluses des côtes charentaises et vendéennes, des parcs de clayonnage ou bouchots, des installations de filets posés qui sont pêcheries exclusives telles que les guideaux à hauts étaliers, les bas-parcs ou venets de Merville, ainsi que les « tentes ou pêcheries » de Montfarville.
Parmi les pêcheries semi-fixes, on distingue : les guideaux à bas étaliers de la Baie du Mont-Saint-Michel, les guideaux volants, les hauts-parcs, étalières, harenguières et muletières, les bas-parcs et les venets, les ravoirs, les demi-folles et macrolières, les nasses fixées.
Sont ensuite examinées la répartition géographique de ces installations, leur statut juridique, le type de ressource exploitée, leur mode d'exploitation.
Les mesures prises immédiatement à la suite de la visite de 1724 ont été énergiques. Pour exemple, l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi concernant les parcs et pêcheries de l'amirauté de Coutances du 21 octobre 1726 (AN-C5-12) exige la démolition de 36 pêcheries et la conservation de seulement 10 d'entre elles.
Concernant les pêcheries en pierres, l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 4 novembre 1726 (AN-C5-12) porte sur les parcs et pêcheries du ressort de l'amirauté de Granville : 17 d'entre eux doivent être détruits, 5 seulement conservés.
Le bilan dressé en 1740 reste cependant modeste et illustre bien une certaine impuissance de cette administration naissante. Pourtant, l'abondance du travail réalisé et la documentation réunie est sans précédent. Elles témoignent du formidable défi qui s'offre à l'administration d'Ancien Régime pour arracher le domaine maritime aux cadres féodaux et pour imposer une gestion moderne de l'espace et des ressources du littoral.
Sur le même thème
-
ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-X…
VermerenHugoProjet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une
-
Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.
Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud
-
Les océans ont une histoire !
HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH
-
Produits de la mer durables : quel rôle de l'information ?
LucasSterennSterenn Lucas, Maître de Conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de l'information, pour les consommateurs, relative aux produits de la mer.
-
Quels enjeux de durabilité en aquaculture ?
SadoulBastienBastien Sadoul, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo des enjeux de durabilité de l'aquaculture.
-
Les espaces marins au-delà des juridictions sont-ils un bien commun ?
QueffelecBettyBetty Queffelec, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la notion de bien commun appliquée à l'océan.
-
La population de l’Iran caspien et la mer
BrombergerChristianAbballeXavierLa mer Caspienne constitue un espace maritime de 360 000 km², mais les populations iraniennes riveraines n’y accordent que très peu d’intérêt. Curieusement, cette indifférence concerne quasiment
-
Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre
FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...
-
Marin sur un thonier à Concarneau
FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du
-
Les Italiens à Bône (XVIIIe-XXe siècles)
VermerenHugoLa côte est du Maghreb est une zone maritime particulièrement riche en ressources diverses. A côté de la pêche de produits alimentaires s’est développée très tôt une pêche spéculative, la pêche du
-
Les communautés de pêcheurs d’éponges dans le Dodécanèse
FagetDaniela pêche constitue une des activités traditionnelles de l'aire méditerranéenne, pêches destinées à l'alimentation et pêches spéculatives destinées à un marché plus vaste. Le thème des pêcheurs d
-
Les « villae maritimae »
CiucciGiuliaLa « villa maritima » est une construction qui se diffuse dans l’Empire romain au premier siècle après Jésus-Christ. C’est une résidence de loisirs mais aussi un site où se pratiquent les affaires,