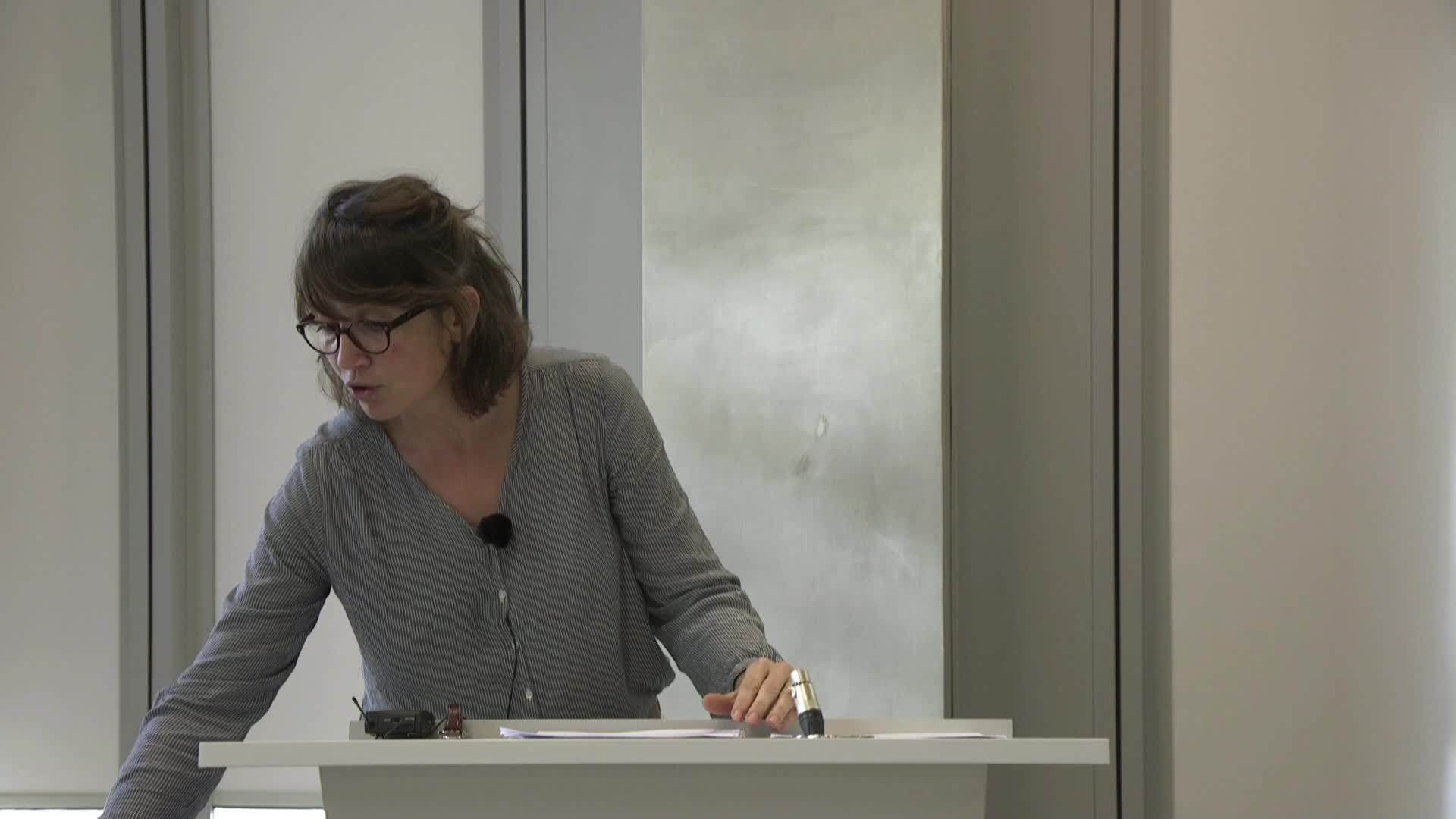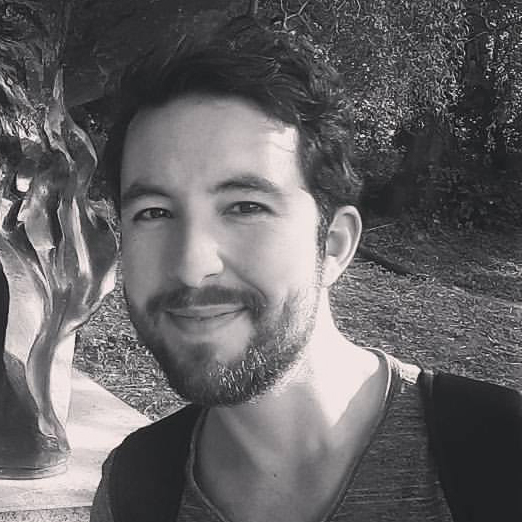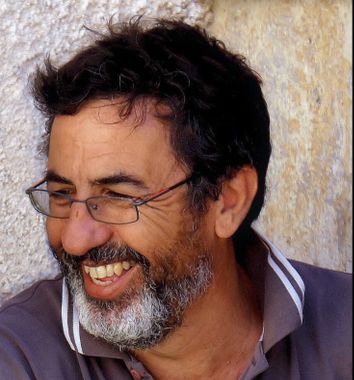Notice
CCIC, Cerisy-la-Salle
Transcrire sans dessiner les sceaux. Quel sens donner à cette démarche? (France de l’Ouest, XIe-XIIIe siècles)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé Apposer sa marque : le sceau et son usage qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 4 au 8 juin 2013, sous la direction de Clément BLANC-RIEHL, Jean-Luc CHASSEL et Christophe MANEUVRIER.
Le sceau, porteur d'une image personnelle, voire intime, rendue publique par la pratique, constitue un objet d'étude à la croisée des sciences humaines et sociales (histoire, histoire de l'art, archéologie, histoire du droit, sociologie, anthropologie). Des travaux récents menés à la fois sur les empreintes de cire et les matrices de sceaux, mais aussi sur les productions diplomatiques, soulèvent de nouvelles questions sur les usages du sceau, spécialement dans l'administration de la preuve, et leur diffusion jusque dans des milieux parfois très modestes. Qui dispose ou peut disposer d'un sceau? Pour quels usages? Où et par qui sont fabriquées les matrices, comment sont-elles conservées ou cancellées ?
L'espace normand et anglo-normand, au sein duquel les pratiques sigillographiques furent aussi originales que diversifiées durant l'époque médiévale, sera privilégié, mais on souhaite ouvrir la réflexion à d'autres espaces, européens et méditerranéens, et à d'autres périodes, notamment à l'Antiquité hellénistique et romaine...
Agrégée d'histoire, maître de conférences à l'Université d'Orléans, Chantal Senséby est l'auteur d'un doctorat consacré à la société et aux formes de peuplement en Touraine méridionale aux XIe et XIIe siècles (1995). Depuis 1997, elle a réorienté ses recherches sur les pratiques documentaires et judiciaires dans les établissements religieux ligériens. Elle a soutenu en 2012 un dossier d'Habilitation à diriger des recherches intitulé: L'écrit documentaire. Production et usage dans le Val de Loire (France de l'Ouest, XIe et XIIe siècles).
Résumé de la communication
A partir de la fin du XIe siècle, l'usage du sceau se répand dans le Val de Loire tout en cohabitant avec d'autres formes de validation des actes. Son emploi s'intensifie au XIIe siècle. En revanche, comme l'a souligné dès 1993 J.-L. Chassel, les cartulaires des XIe-XIIIe siècles proposent peu de dessins de sceau. Assurément, ils ne traduisent pas une indifférence des cartularistes à ce signe de validation. Mais ce parti pris surprend au moment où le sceau, image personnelle du sigillant et donc signe identitaire, fait florès. Selon certaines analyses récentes, les médiévaux, en annonçant la validation par le sceau dans l'eschatocole, rendraient inutile la reproduction du sceau en copie sous forme de dessin. Toutefois, les croix de validation et les devises parfois, elles aussi très fréquemment annoncées, sont transférées du document d'origine vers le recueil de copies. La question mérite par conséquent d'être réexaminée à la lumière de considérations récentes sur le cartulaire et les pancartes de Saint-Aubin d'Angers et d'observations faites sur d'autres cartulaires ligériens.
Thème
Sur le même thème
-
Tuan Ta Pesao : écritures de sable et de ficelle à l'Ile d'Ambrym
VandendriesscheEricCe film se déroule au Nord de l’île d’Ambrym, dans l’archipel de Vanuatu, en Mélanésie...
-
Topics in aspectuo-temporal expression in Anindilyakwa
BednallJamesThis presentation examines temporal and aspectual expression in Anindilyakwa, a language whose inflectional verbal system displays both a complex morphological makeup, and a largely underspecified
-
Co-reference in (linguistic-)pictorial discourse
AltshulerDanielThis talk takes up the question of how one arrives at pragmatic interpretations of pictorial and mixed linguistic-pictorial discourses.
-
Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)
PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)
-
Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de Pierre Chaunu
La première phase de l’œuvre de Pierre Chaunu interroge l’Espagne dans sa dimension globale et mondiale. Sa thèse monumentale, Séville et l’Atlantique (1504-1650), parue de 1955 à 1960, demeure un
-
Le "Charles Quint" de Pierre Chaunu : les risques d’une biographie
L’article de Juan Carlos D’Amico se propose d’étudier les spécificités du regard que Pierre Chaunu porta sur l’empereur Charles Quint souvent identifié comme le maître de l’empire sur lequel le soleil
-
André Pézard traducteur de Dante ou le choix inactuel et délibéré de l’archaïsme
Notre intervention ouvre la série des rencontres sur les traductions de l'IMEC avec un sujet complexe et contrasté. Pour l'italianisme français et pour la traductologie italo-française, le fonds d
-
Littératures autobiographiques de la Seconde Guerre mondiale : les fonds d’archives présents à l’IM…
Les archives d'écrivains, d'éditeurs, de directeurs de revues et feuilles littéraires, déposées à l'IMEC, recèlent quantité de documents : ces journaux intimes, lettres, papiers d'identité, coupures
-
Garibaldi inventé par Garibaldi. Idéologies, croyances, biographies, 1847 à nos jours
La communication vise à montrer que l'inventeur de Garibaldi est en réalité Garibaldi lui-même et que la structure fondamentale du mythe garibaldien réside dans la rencontre entre l'idée de virilité
-
Massimo d’Azeglio homme du Risorgimento. L’écriture plurielle d’un auteur singulier
Il s'agit, dans cette étude, de mettre en évidence l'implication de d'Azeglio dans le Risorgimento, à travers les divers registres d'écriture (épistolaire, autobiographique, pamphlétaire, romanesque)
-
Reflets du Risorgimento dans les premiers romans de Verga
Les premiers romans de Verga, Amore e patria, I carbonari della montagna et Sulle lagune sont écrits entre 1856 et 1863, au moment donc où se fait l'unité politique de l'Italie. Verga en est un témoin
-
Bandes dessinées et guerre d’Algérie. Entre conflits et cicatrisation des mémoires
Il faut attendre le début des années 1980 pour qu’une première bande dessinée prenne pour thème central la guerre d’Algérie (Une éducation algérienne de Guy Vidal et Alain Bignon). A partir de là, le