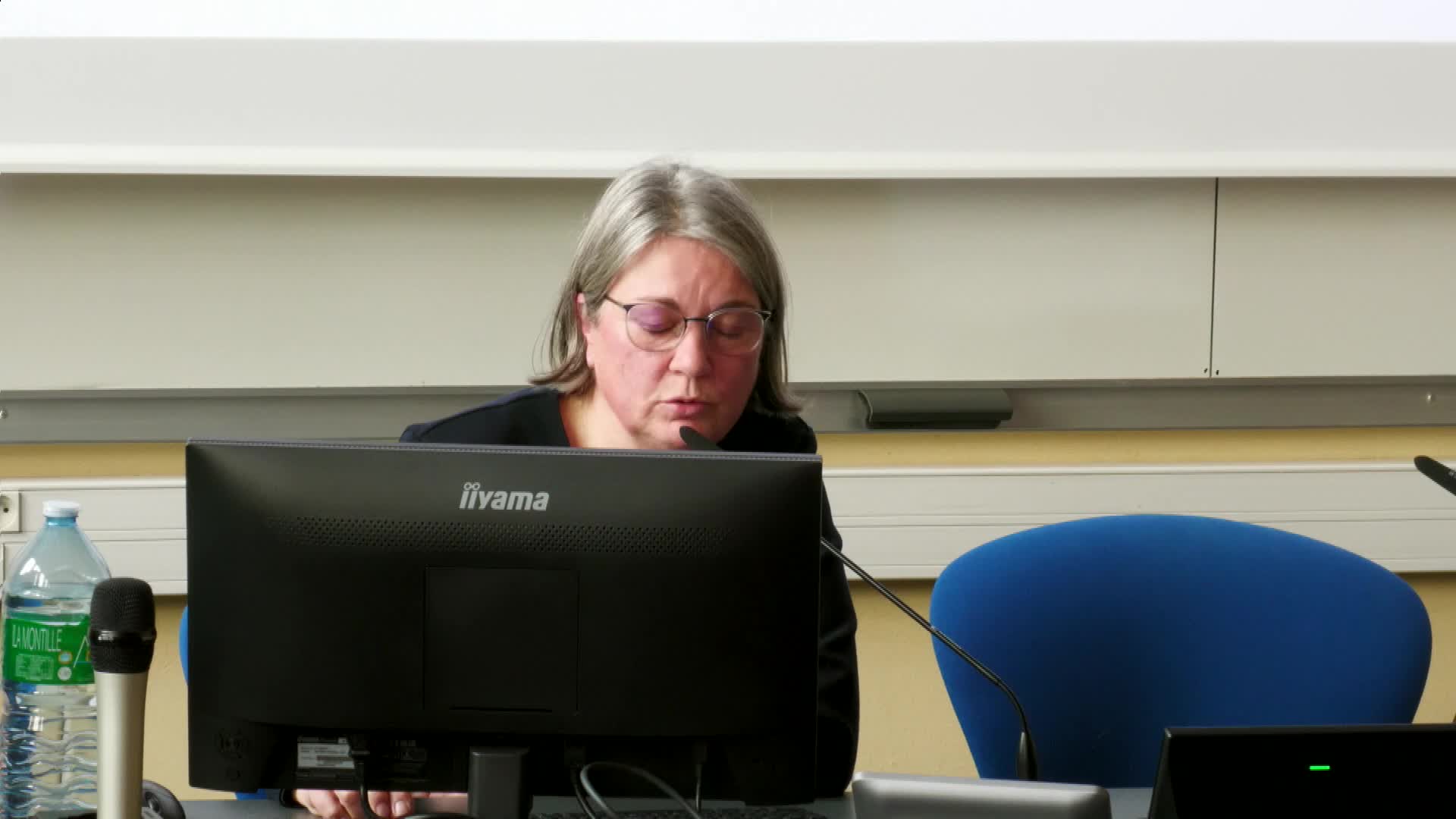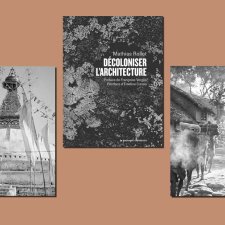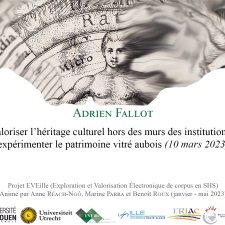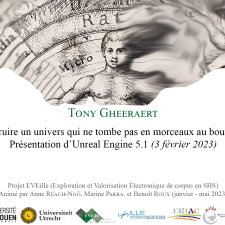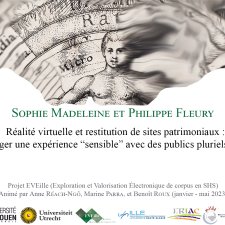Chapitres
Notice
L'opéra de Pékin
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Le grand théâtre national de Chine, c'est le nom officiel de la construction dont j'ai la charge depuis plusieurs années à Pékin. De manière courante, en français et en anglais, on la nomme Opéra de Pékin. La différence est importante. Un opéra n'est jamais tout à fait un théâtre comme un autre. Il est tout éclairé de la lumière fantasmatique qui s'attache à cette recherche d'un art total qu'est l'opéra comme genre théâtral.
Ce bâtiment aux fonctions si strictes et si exigeantes ne se limite jamais à elles. Il est dès sa conception un symbole au sens le plus ancien, parce qu'il réunit - qu'il doit réunir -, en rétablissant une unité qui n'a peut-être été jamais que désirée, les fragments d'un tout à la fois culturel, technique et social, à la fois local et universel. Faire un Opéra est toujours une aventure pleine d'espoir et de difficultés, d'enthousiasmes et de critiques. Elle n'est pas plus sereine que ne l'était la traversée d'un océan inconnu. Elle est toute chargée de mystère, de doutes mais par-dessus tout de l'espérance d'un nouveau monde.
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Le grand théâtre national de Chine
par Paul Andreu
Le grand théâtre national de Chine, cest le nom officiel de la construction dont j'ai la charge depuis plusieurs années à Pékin. De manière courante, en français et en anglais, on la nomme Opéra de Pékin. La différence est importante. Un opéra n'est jamais tout à fait un théâtre comme un autre. Il est tout éclairé de la lumière fantasmatique qui s'attache à cette recherche d'un art total quest lopéra comme genre théâtral. Ce bâtiment aux fonctions si strictes et si exigeantes ne se limite jamais à elles. Il est dès sa conception un symbole au sens le plus ancien, parce qu'il réunit qu'il doit réunir , en rétablissant une unité qui na peut-être été jamais que désirée, les fragments dun tout à la fois culturel, technique et social, à la fois local et universel.
Faire un Opéra est toujours une aventure pleine d'espoir et de difficultés, d'enthousiasmes et de critiques. Elle n'est pas plus sereine que ne l'était la traversée dun océan inconnu. Elle est toute chargée de mystère, de doutes mais par-dessus tout de l'espérance dun nouveau monde.
Que l'on pense à la construction de l'opéra Garnier et à celle de l'opéra de Sydney, pour n'en citer que deux, et on retrouvera les mêmes enjeux urbanistiques, esthétiques, techniques et politiques, enjeux chaque fois inextricablement emmêlés. Aussi, pour vous parler de l'Opéra de Pékin, il est nécessaire que je ne limite pas à une description de ce qui est construit, en commentant par exemple des images et que, pour plus de vérité, je vous dise quelles perspectives les études et le chantier mont ouvertes dans des domaines qui ne sont pas les miens.
Gérard Fontaine le dit dans plusieurs livres quil a consacrés à lopéra, « construire un opéra cest avant tout choisir un site ». Cest ce quont fait, il y a déjà de nombreuses années, les autorités chinoises en choisissant un très vaste terrain, proche de la place Tien An Men et de la Cité interdite, contiguë au Palais du Peuple. Cest dans le centre même de Pékin et ce mot de centre a un sens plus fort en Chine que partout ailleurs. La décision est forte, signifiante. Chou En Lai, en la prenant, faisait le projet de réunir dans un même lieu lhistoire, le pouvoir politique et la culture. Cette décision a été renforcée encore par celle, beaucoup plus récente, de transformer le Musée de lhistoire, symétrique du Palais du Peuple, en un immense musée des arts.
Lespace consacré à lopéra et à son environnement, que jai contribué, il est vrai, à augmenter, est de treize hectares, ce qui, même dans une ville aux dimensions aussi dilatées que celles de Pékin, est une surface extraordinaire. Une grande partie de cette surface est occupée par des jardins qui entourent une pièce deau de 9 hectares doù émerge, au centre, le bâtiment dont la forme est un demi ellipsoïde. Ce bâtiment, « sans porte ni fenêtre », sera accessible au nord et au sud par deux galeries au toit de verre passant sous le bassin. Cest une île, une île comme celles de si nombreuses légendes, quon ne rejoint que par un chemin invisible.
Il y a plusieurs raisons à ce dispositif.
Dune part il ma semblé évident, dès le début du concours, que dans un site comme celui qui nous était donné, il ne pouvait pas y avoir une façade noble et une façade de service. Cest une disposition habituelle dans un environnement urbain dense. Elle se traduit souvent par une différence importante de traitement architectural entre les deux façades. Lexemple de lOpéra Garnier le montre, ce nest pas en soi un inconvénient pour lintégration du bâtiment dans son environnement. Mais le site de Pékin, pris au départ entre lavenue principale de la ville et un nouveau jardin, dégageait largement toutes les façades du futur bâtiment et les accès pour le matériel et les décors sont devenus aujourdhui très grands. Avec la généralisation des co-productions, ce sont des containers entiers qui entrent et qui sortent des opéras. Notre situation se rapprochait davantage de celle de lOpéra de Sydney. Son architecte Bjorn Utzon na sacrifié ni la façade sur la ville ni celle qui fait face à la mer. Il a placé les entrées de service latéralement en les rendant très peu perceptibles. Nous devions cependant éviter de nous enfermer, comme il la fait, dans des espaces trop restreints. Nous devions adopter des dimensions de circulations plus grandes, mieux adaptées aux exigences logistiques modernes dun opéra. Cest ce qui nous a conduit, dès les premiers dessins, à situer les scènes des différentes salles en sous-sol, au niveau moins sept mètres et à desservir ce niveau par de très vastes rampes accessibles aux camions porte container. Des plantations du parc, prévues dès le départ avec la générosité suffisante, éviteront que ces rampes ne prennent un caractère agressif.
Ces considérations fonctionnelles nétaient pas les seules à justifier lintégration du projet dans un système deau et de jardins.
Même si lavenue Chang An crée une coupure importante, nous voulions que le projet soit laboutissement de la région des lacs et des jardins qui bordent la Cité Interdite à louest et renouer ainsi, en dépit de limportance physique de notre construction, avec le caractère historique de la ville. Nous voulions aussi quen opposition avec lensemble de la place Tien An Men, essentiellement ouverte, minérale et monumentale, notre projet ne se dégage que progressivement de son environnement immédiat, quil émerge dabord lentement des arbres, puis sen dégage en sisolant au centre dune grande surface deau. Nous voulions que cette eau et ces arbres soient, autant ou plus que la vue du bâtiment, un motif de promenade et une occasion de repos.
Il nest pas impossible dailleurs quun jour les autorités Chinoises décident de construire dans une autre partie de la ville un centre politique fonctionnellement mieux adapté à leurs besoins et ne donnent partiellement au public lusage dune partie de la région des jardins et des lacs quelles occupent aujourdhui. Cela ferait de lOpéra de Pékin la fin dune grande composition historique.
Mais pourquoi ce que nous appelons « le passage sous leau », non pas un passage à vrai dire mais deux, dinégales longueurs, qui sont, au nord et au sud, deux galeries daccès pour le public dont le toit en verre laisse apercevoir le bâtiment à travers leau souvent agitée du bassin ? Les raisons fonctionnelles ici importent beaucoup moins que les raisons symboliques. Il faut entendre le mot « passage », comme on entend souvent les mots de « chemin » ou de « traversée », dans plusieurs sens qui évoquent à la fois un lieu que lon parcourt et le mouvement du parcours, lintervalle de temps nécessaire et la transformation irréversible quil opère.
Le théâtre et, plus encore que lui, lopéra sont des lieux dans lesquels le monde est rendu plus compréhensible grâce à la fiction et au rêve, parce que la fiction ouvre les yeux et les oreilles et éclaire la pensée, parce que le rêve libère. Mais dans ces lieux, il faut entrer comme si lon pénétrait dans un autre monde. Que les spectateurs puissent à leur guise, dans le temps qui est le leur, faire ce passage du monde réel et quotidien à celui de la fiction, cest ce que doivent permettre les espaces du théâtre qui précèdent la salle et qui y conduisent.
Le passage sous leau et le temps mis à le parcourir seront avant tout je crois le lieu et le temps du passage. Cela pourrait être un tunnel obscur comme celui qui mène Virgile et le Dante du purgatoire au paradis ou comme ce passage dans la montagne que les soldats de lempereur ne peuvent découvrir. Cest ici, quand on est descendu sous le niveau du sol et que lon a perdu de vue le bâtiment énigmatique dans lequel on se rend, le lieu où il réapparaît dans le trouble de cette eau mobile, si souvent associée au rêve, juste avant que lon se retrouve brusquement à lintérieur, sous une voûte dont on navait pas imaginé les dimensions.
Comme beaucoup de grands équipements scéniques modernes, le grand théâtre national de Chine rassemble plusieurs salles de fonction et de taille différentes : quatre au début du concours, ce nombre ayant été réduit à trois à lissue de la première année détudes, pour des raisons déconomie. Le théâtre expérimental modulable de quatre cents places a alors été différé. Lexistence des autres salles, un opéra de 2300 places, un auditorium de 2000 places et un théâtre de 1100 places, particulièrement adapté par sa configuration au genre spécifique de l « opéra de Pékin », na jamais été remise en cause sinon sur des points de détail.
La voûte recouvre trois blocs construits distincts ainsi que toutes les circulations et les espaces publics entre eux et autour deux. Au cSur de chaque bloc se trouve une salle de spectacle. Les espaces publics sont vastes. Ils permettent dajouter à la fonction principale du bâtiment dautres activités qui lui assureront une utilisation continue. Cette organisation de lespace et lextension quelle donne au programme faisaient partie de nos idées de base. Les formes ont changé dans le déroulement du concours mais le principe na jamais été remis en cause. Pourquoi ce développement des espaces publics ? Nombreuses sont les raisons, la première étant lutilité sociale du bâtiment. Un opéra est toujours quon le veuille ou non, un bâtiment élitiste, le nombre de places est limité ce sont souvent des places chères même si lactivité est très subventionnée mais élitiste aussi parce que souvent lopéra repousse un certain nombre de gens qui considèrent quils ne sont pas chez eux dans ce genre de bâtiment. Je crois quun bâtiment comme Beaubourg a beaucoup fait pour que cet aspect un peu hautain des grands bâtiments culturels disparaisse. Beaucoup de ceux qui sont allées à Beaubourg, qui ont monté les grandes rampes de Beaubourg jusquen haut, y sont allés pour voir les toits de Paris, pour voir un bâtiment moderne, pour participer de cette aventure qui était son ouverture ce phénomène a duré et cétait bien -. Et si un certain nombre de gens à cette occasion ont poussé la porte de la bibliothèque, si ils ont trouvé facile dentrer dans le musée, si 1 % dentre eux a pris le virus de fréquenter musées et bibliothèques, cest déjà une réussite considérable et un succès social énorme.
Dans la Chine daujourdhui, il ny a pas de grand bâtiment moderne ouvert. Existent des centres commerciaux, des gares, des aéroports, des endroits où lon a quelque chose à faire, des endroits où lon paie. LOpéra de Pékin devrait être un endroit quon peut venir visiter en donnant trois sous comme on donne trois sous pour entrer dans les parcs mais pas davantage, et où je pense que les Chinois viendront voir le monde, le leur, pas le monde le plus général mais voir larchitecture qui est finalement un grand volume libre donné et peut-être quun certain nombre iront ensuite à lopéra et cela rejoint la deuxième raison.
La deuxième raison est que, partout en Chine et dans tous les pays du monde, lopéra et la musique classique se cherchent de nouveaux spectateurs. Les salles sont pleines, mais peu grâce à de jeunes gens. Tout le monde se pose la question : « quel est le public de demain de la musique ? ». Que faut-il faire pour que les gens viennent ? Non pour les attirer dans une espèce de souci de marketing, non pas quil y ait nécessité à ce quils viennent, mais parce que cest un bonheur qui est à leur portée et dont il faut quils profitent, du moins ceux qui le désirent.
Partir dans la fiction et dans le rêve, ce nest pas partir dans quelque chose qui va vous séparer du monde mais au contraire vous donner une nouvelle manière de le voir, de nouvelles clés pour le comprendre et revoir la ville en étant sur le toit de lOpéra et en voyant dun côté la Cité Interdite et de lautre cette Cité Interdite moderne que lon na pas vue depuis trente ans et qui, dun seul coup, va accepter quon la découvre. Ce mouvement de la ville quon quitte et de la ville quon retrouve, tous ces tours et détours, voilà de quoi cet ouvrage est fait aussi et surtout.
Quant aux salles car cest lobjet absolu , jai beaucoup écouté les personnes qui connaissaient lopéra mieux que moi pour bien essayer de comprendre ce quil sy passait. Une salle dopéra est une salle où lon doit entendre et voir parfaitement. « Entendre et voir parfaitement » appelle un certain nombre de réflexions. Cest une revendication normale mais moderne. Du temps de Garnier, lorsquil ny avait pas de musique enregistrée, lon considérait déjà bien dêtre au poulailler doù, à défaut de voir bien le spectacle, on lentendait magnifiquement. De nos jours, le public veut voir absolument et entendre, et veut parfois même plus, retrouver paradoxalement le son quil connaît tout à fait impossible -. Nous connaissons la voix de La Callas et non celle de La Tebaldi (pour parler de gloires anciennes). Bien sûr, un enregistrement est une chose hors du temps, hors de lespace, et le spectacle est tout au contraire dans le temps et dans lespace. Cette pression de lenregistrement et de sa perfection est une pression qui touche à labsurde et qui, parfois, fait juger lacoustique des salles de manière un peu perverse. À ce jour, les acousticiens ont fait des progrès considérables, ils savent calculer, ils savent quel sera leffet des dispositions de détails, ils le savent en termes scientifiques, mais quest-ce que ces valeurs de pression de lair donneront comme sentiment aux gens ? Cela échappe bien sûr encore assez largement à leur appréciation et un acousticien est toujours et il le revendique quelquun qui fait des choix esthétiques. Si lambition est une salle dans laquelle sera donnée la primauté à la précision du son, à son côté analytique, cette salle sera traitée dune certaine manière, si au contraire lambition est de donner de lampleur au son, la salle sera conçue différemment il y a toujours un choix -.
Par ailleurs, je tenais pour lOpéra à ce que les formes soient courbes parce que certainement cela me plaît et parce que je pense que cela correspond à la musique. Mais, naturellement, cela va complètement à linverse de ce que voudraient les acousticiens. De notre conflit, est née une solution relativement originale : ce que lon voit dans cette salle est donné par une maille métallique (dont on a vérifié quelle était transparente au son). Derrière cette maille métallique interviennent les grands pans de réflexion et un éclairage double : un éclairage devant la maille qui en fait ressortir le côté un tout petit peu doré qui peut la refroidir ou la réchauffer, et dans lintervalle, entre des murs qui sont peints en rouge et la maille, une lumière très faible qui est mise à la disposition du metteur en scène pour, pendant ou avant le spectacle, donner une teinte plus ou moins chaude, plus ou moins rouge à la salle.
Le Théâtre, lui, est plus petit mais il a un peu les mêmes dispositions que lOpéra. Il offre 1100 places. Les conditions acoustiques sont moins extrêmes. Cest un théâtre dans lequel on doit jouer ce quon appelle lOpéra de Pékin qui se joue sur un proscenium, cest pour cette raison que nous avons décidé de la taille du théâtre, de son proscenium, de la forme de son parterre et décidé aussi de tout son revêtement puisque ses teintes de rouge et brun sont des teintes qui doivent mettre en valeur les costumes de lOpéra de Pékin, les bleus vifs et les rouges intenses.
Enfin, lAuditorium, ce que lon appelle, en termes de métier « une boîte à chaussures » acoustiquement, est ce qui dérive des grandes salles de musique allemandes qui étaient de grandes salles rectangulaires. Cest une salle plutôt blanche avec un orgue extrêmement développé, un orgue vraiment moderne qui se développe sur une très grande longueur et qui commence à envelopper les auditeurs. Nous avons essayé de transformer dans cette salle les problèmes acoustiques en quelque chose desthétique.
La construction de lOpéra de Pékin est avant tout une grande construction métallique, une voûte sans point dappui intermédiaire. Il faut résister à Pékin aux tremblements de terre, au vent, à la neige. Cest une structure que je pense être chinoise, une structure que nous avons dessinée en réfléchissant aux conditions économiques de la Chine, une structure quon ne pourrait pas faire chez nous. Rester fidèle à léconomie comme nous lavons toujours fait, toute notre architecture classique est faite dun rapport de beaucoup de travail et dun matériau pauvre. Une autre manière de rester fidèle à ce que lon peut construire en Chine est aussi demployer des matériaux qui sont disponibles. LOpéra de Pékin est un ouvrage sans dogme, ni « high-tech », ni « low-tech », ni moderne, ni post-moderne.
Liens
La Web TV de l'enseignement superieur
Université René Descartes Paris-5Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences
CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur
UTLS sur Lemonde.frLe monde
La conférence du 19/10/2004 en MP3partenaire des UTLS
La conférence du 19/10/2004 en audio Ogg Vorbisdiffuse en audio les conférences en partenariat avec le CERIMES
La conférence du 19/10/2004 en vidéo RealLe texte de la conférence du 19/10/2004 en PDF
Dans la même collection
-
Hibernia : une plate-forme pétrolière
VacheMichelAu début des années 1980, MOBIL a découvert un gisement pétrolifère gigantesque dans 80 m d'eau sur les Grand Banks, sur la côte est du Canada, à 350 km au large de l'île de Terre-Neuve. La difficulté
-
L'aéroport d'Osaka
OkabeNoriakiDans les années 70, le développement du trafic aérien au Japon génère de nouveaux besoins en matière d’infrastructures. Pays de petite surface et très montagneux, le Japon offre peu de place pour la
-
Le tunnel Lyon-Turin
CartierGérardLes échanges de marchandises à travers les Alpes connaissent depuis de nombreuses années une croissance rapide qui a été essentiellement captée par la route. Les nuisances qui en résultent, les
-
Sculpture, pyramides, terminaux : la complexité à petite échelle
VaudevilleBernardArchitecte pour le cabinet d'ingénierie RFR, Bernard Vaudeville illustre, à travers la présentation de 5 projets, la complexité de la construction de petites structures : complexité de forme, d
-
Comment construire sur des sols mous sans fondations ?
CognonJean-MarieQuand il s'agit de construire un ouvrage en Bretagne sur du granit, l'ingénieur n'a pas de problème pour réaliser les fondations. Par contre, s'il veut construire sur du sol mou (de la vase jusqu'à la
-
La conception des barrages
TardieuBernardLes barrages participent au développement de plusieurs façons. Dans les territoires où la ressource hydrique est irrégulière, ils permettent de régulariser les débits d'eau pour les besoins de l
-
Buildings et bâtiments de grande hauteur : un défi pour les structures
BischPhilippeLa conception de bâtiments exige la participation d'un grand nombre d’acteurs : architectes, ingénieurs, électriciens, techniciens acoustiques…Pour chacun, l’objectif est de construire un édifice
-
Pourquoi le World Trade Center est-il tombé ?
RookeGeoffLes évènements du 11 Septembre ont bien sûr, fait l'objet de toute une série d'études par des professionnels Américains de différentes formations du secteur du bâtiment afin de tirer un maximum de
-
Construction et rénovation du Grand Palais
PerrotAlain-CharlesEdifié pour l’Exposition Universelle de 1900, le Grand-Palais de Paris naît de la synthèse des propositions architecturales de Henri Deglane, Albert Louvet, Albert-Félix-Théophile Thomas et Charles
-
Le pont de Rion-Antirion en Grèce : le défi sismique
PeckerAlainInfrastructure reliant le Péloponnèse à la Grèce, le pont de Rion-Antirion est un projet de grande envergure. Sa conception et son dimensionnement ont été guidés par la sollicitation sismique auquel
-
Le viaduc de Millau
VirlogeuxMichelLa construction d'un grand pont est une expérience extrêmement diverse avec ses aspects d'architecture, ses aspects scientifiques et techniques, la petite histoire du projet. Le viaduc du Millau
Sur le même thème
-
Conférence de Paola Viganò [ Laboratoire de la Transition. Le jardin biopolitique ]
ViganòPaola[ Laboratoire de la Transition. Le jardin biopolitique ]
-
EVOLUTION DES PRATIQUES ET ACTIVITÉS AVEC L'AVANCÉE EN ÂGE
SÉANCE FLASH 1 : VIEILLISSEMENT, ÉVOLUTION DES CONTEXTES ET DES PRATIQUES
-
CHeaR - Croiser les Histoires des écoles d’architecture en Région (2024-2026)
LavenuMathildeMathilde Lavenu, membre de l'UMR Ressources, présente le projet CHeaR.
-
Le Bauhaus, 1919-1933 à aujourd’hui
MenginChristineChristine Mengin décrit l'histoire du mouvement architectural allemand du Bauhaus, de Weimar 1919 à Dessau 1933.
-
Table ronde 2 "La dimension hybride et transversale des démarches démocratiques en architecture et …
MacaireÉliseLongeotLéaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d
-
Décoloniser l'architecture : du biorégionalisme aux plurivers
RollotMathiasConférence de théorie critique architecturale, donnée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Décoloniser l’architecture le jour même.
-
« Les heureuses surprises de l’architecture palladienne » André Chastel, action publique et scient…
PotelJeanCinquième séance des Rencontres du Centre André-Chastel (2023-2024) présenté par Jean Potel (doctorant au Centre).
-
-
« "Comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de deux jours ?" Présentation…
GheeraertTony« Comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de deux jours ? » interrogeait en 1978 Philip K. Dick, pour s’effrayer déjà de la prolifération de mondes virtuels. Sans entrer
-
« Réalité virtuelle et restitution de sites patrimoniaux : comment partager une expérience "sensibl…
FleuryPhilippeMadeleineSophieUne équipe de recherche de l’université de Caen Normandie (ERLISUR 4254) travaille depuis plus de 25 ans sur la restitution virtuelle interactive de la Rome antique avec le soutien du Centre
-
Les « villae maritimae »
CiucciGiuliaLa « villa maritima » est une construction qui se diffuse dans l’Empire romain au premier siècle après Jésus-Christ. C’est une résidence de loisirs mais aussi un site où se pratiquent les affaires,
-
Table ronde 1 : Immersions et mises en situations
AtiéMichèleAyoubiRimaKanellopoulouDimitraRavelNadineSutterYannickTourreVincentCette table ronde propose d’explorer les différents types d’immersions qui favorisent la rencontre d’un public et d’un milieu sensible.




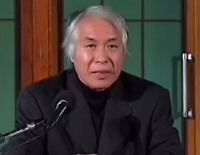






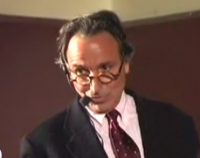


![Conférence de Paola Viganò [ Laboratoire de la Transition. Le jardin biopolitique ]](https://vod.canal-u.tv/videos/2026/01/109998/conf-paola_vigano-diff.jpg)