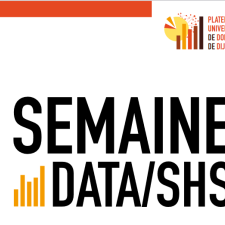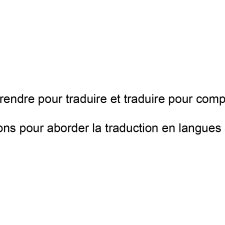Notice
Pourquoi défendre les humanités ? - Agnes Joste
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?"
Pourquoi défendre les humanités ?
Par Agnès Joste
Lettres classiques, Lycée Claude Monet, Le Havre
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Texte de la 681e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 14 octobre 2008
Agnès Joste : « De l’orteil à l’article ou pourquoi défendre les humanités ? »
Lorsqu’Yves Michaud m’a demandé d’assurer une conférence, en tant que professeur du secondaire, sur les raisons de défendre à l’école l’enseignement des « humanités », c’est à dire, au sens ordinaire du terme, l’étude du latin et du grec, j’ai été inquiète, car le titre impliquait une position défensive, comme si cet enseignement n’allait pas de soi. Lorsque j’ai reçu le cadrage et l’orientation du cycle de conférences, j’ai su qu’Yves Michaud ne voulait pas « faire entendre un cortège de pleureurs et pleureuses ». Ce ne sera effectivement pas le cas ici.
En effet, les vertus formatrices intrinsèques du latin et du grec font de ces deux disciplines, par nature, un outil tonique qui se défend par lui-même, et dont on exposera ici les effets positifs.
L’étude des langues anciennes joue dans l’éducation un rôle capital. Le latin et le grec font, en quelque sorte, changer de monde l’élève que nous instruisons : si l’on utilise une image issue de l’histoire du latin et de celle du français, il passe « de l’orteil à l’article », expression qui aurait pu être un sous-titre de cette conférence. « Orteil » et « article » sont en effet des doublets, deux mots français issus d’un même mot latin articulum, « petite articulation », le premier « orteil » est bien sûr familier et populaire, d’ailleurs mâtiné de gaulois et désignant une partie du corps, le second savant, introduit à la Renaissance pour enrichir le français des termes abstraits qui lui manquaient. L’apprentissage des langues anciennes permet à l’élève d’effectuer un parcours intellectuel - qui pourrait d’ailleurs être le modèle de l’ensiegnement des autres disciplines - le menant de « l’orteil », un élément proche, corporel, de son environnement concret le plus trivial et le plus immédiat, sans prise de conscience particulière mais au contraire comme élément d’une fusion avec soi, à « l’article », mot-miroir du premier, mais tout différent : c’est entre autres un élément grammatical d’analyse et de réflexion sur le langage, permettant de désigner, de ranger dans une catégorie - « article défini » ou « article indéfini » -, de distinguer un substantif d’un adjectif, c'est-à-dire de mener une opération abstraite d’appréhension du monde et de recul critique par la conscience des ressources du langage et de la pensée.
L’image anatomique et linguistique se double d’une image culturelle. Cet arrachement provisoire à soi par l’étude des langues anciennes, ces langues étranges, conduit à une pensée autonome avisée, émancipée des représentations immédiates, mais fait aussi accéder à la dimension historique et humaine que véhiculent les mots, le langage, les textes de l’Antiquité. L’élève, à son tour, entre dans le creuset de la longue lignée qui a débattu de l’expérience de l’humain, et cherché à la mettre en forme.
On s’attachera donc ici à montrer concrètement les bienfaits que retire un élève des langues anciennes, bien loin des représentations négatives qui leur habituellement sont attachées.
Mais cela n’empêche pas la lucidité : si l’on parle de défendre les humanités, c’est qu’elles sont attaquées. Il ne s’agit pas d’un vice consubstantiel. C’est l’institution elle-même, pourtant leur garant, qui s’en charge : on verra, dans la dernière partie de cet exposé, la responsabilité capitale de l’école dans le maintien ou la suppression de cet apprentissage fondateur.
I. Présence des langues anciennes.
Pour contredire cet abandon infondé, nous verrons tout d’abord à quel point les LA constituent le « présent » des élèves, contrairement à un préjugé répandu.
Une ancienneté de façade
Les langues anciennes seraient « anciennes »… et à ce titre, selon une opinion répandue, devraient être éliminées du cursus actualisé d’élèves « modernes ». En poussant ce raisonnement à l’extrême, il faudrait supprimer toutes les disciplines et les connaissances qui se sont développées dans le monde gréco-romain. Supprimer l’alphabet, mot trop marqué de ses origines grecques alpha et bêta, et bien sûr revenir à l’idéographie. Supprimer le théorème de Thalès, la géométrie d’Euclide, les tables de Pythagore, retirer au droit ses racines romaines… Le parallèle absurde ne tient pas : la science actuelle s’appuie sur les sciences antiques comme les langues actuelles, le français plus particulièrement, contiennent les langues et les racines antiques ; et la conscience linguistique est fille d’une étude bien comprise du latin et du grec. Amputer les connaissances de leur composante « ancienne » est d’une part impossible, d’autre part destructeur. Autant dire qu’il faudrait également supprimer l’enseignement de l’histoire… (Cette remarque, écrite pendant la préparation de cette conférence comme une boutade, vient malheureusement de se voir envisagée, parmi les hypothèses du projet Darcos de réforme des lycées – l’histoire devenant facultative en Première et Terminale, soit deux années sur les trois que compte le lycée…)
La condamnation des langues anciennes dans le cursus scolaire relève donc de la malveillance et des préjugés, parfois de l’ignorance. Elle pratique également la contradiction, en refusant dans l’école le passé qui fascine le grand public : ainsi, la récente découverte d’un buste de César en Arles a fait en mai dernier la manchette des journaux et la une du Monde ; une sculpture vaudrait-elle plus que les chapitres de La Guerre des Gaules que l’on fait étudieren classe ?
Modernité et ancienneté ont évidemment partie liée : les progrès de l’analyse historique et anthropologique permettent de mieux interroger et comprendre les traces et les textes de nos origines. L’ignorer signerait le refus de la modernité bien comprise : celle qui est capable, par ses progrès, d’une relecture toujours plus avertie de son passé. Les langues dites « anciennes », comme tous les autres champs de la connaissance humaine qui sont soumis à la recherche et toujours objets de recherche, ne sont pas une survivance datée. Assimiler leur âge à une obsolescence est une erreur grossière : ce n’est pas à leur ancienneté qu’il faut les juger, mais à leur vitalité et leur efficacité dans les processus langagiers (elles redonnent à l’élève la conscience et l’usage de la langue maternelle), intellectuels (elles mettent l’élève en possession de méthodes et forment son esprit), et culturels les plus essentiels (elles donnent aux élèves les connaissances nécessaires à l’exercice de leur humanité). C’est dans cette optique qu’il faut concevoir leur enseignement scolaire .
On examinera ici, tout d’abord, la réappropriation dont les langues anciennes donnent l’occasion : celle des lettres, des mots, du lexique et de la syntaxe de la langue maternelle.
Réactualiser les bases de l’écriture
Les premiers cours de latin et de grec étonnent les élèves. Le premier alphabet latin n’a ni y, ni z, le second ne comportera jamais j ni v. L’ordre des lettres grecques n’est pas le même qu’en français ou en latin. L’alphabet grec étonne et plaît par son étrangeté, mais il faut réapprendre à écrire, « faire des lignes » comme au cours préparatoire, voire réapprendre à lire : la lecture des mots grecs ne peut être globale ni semi-globale quand on plonge dans un inconnu presque total… Le principe alphabétique y reprend donc tout son sens. Il n’est pas rare de voir, au lycée, des débutants en grec reprendre toutes leurs bases de lecture en français, et s’auto-rééduquer à la lecture alphabétique, en s’apercevant que leur pratique de la lecture du français n’est pas opératoire… L’étrangeté radicale de l’alphabet grec suscite ainsi un recul salutaire. On dit que les langues anciennes sont étranges : oui, c’est leur vertu. Le rôle capital de l’incompréhension, de l’altérité presque complète - les lettres grecques sont inconnues des élèves, en dehors du delta majuscule, du p (pi), de l’a (alpha) parfois - dans la prise de conscience et la réappropriation d’éléments familiers apparaît ici en pleine lumière, et on les reverra à l’œuvre dans le lexique et la traduction : le code nouveau réactive et interroge la connaissance du code familier, et renouvelle le connu en le mettant en question.
Ainsi, combien de collégiens et de lycéens découvrent avec stupéfaction que le « i grec » est grec ! Que le pi de la géométrie ne relève pas d’un choix aléatoire : c’est l’initiale de periphereia, « circonférence »… Ils prennent ainsi brutalement conscience de la matérialité des mots. Il ne s’agit pas ici de naïvetés, mais d’assimilation différée de données brutes de l’école primaire, opératoires mais restées chez les élèves à l’état de mécanique, de lettre morte très exactement, et non de processus. L’enseignement des langues anciennes vivifie ce savoir ancien resté figé.
Le rapport à l’orthographe d’usage en est modifié : là où l’élève ne voyait que signes arbitraires, les mots se mettent enfin à exister dans leur matérialité, et, si son orthographe a une origine et une histoire, cahotante mais qui est une histoire, la langue française cesse d’être ce tissu d’embûches qu’on présente trop souvent. Dans hydrophile par exemple, la distribution de h, de y et de i, qui dérive de l’alphabet grec, ne semble plus capricieuse. L’explication du présent par le passé prend ici tout son sens, et la langue ancienne est un puissant moteur d’acquisition et de compréhension du français, en même temps qu’un moyen d’appréhender l’histoire des autres langues européennes.
Construire et revisiter le lexique : une exploration fructueuse
L’argument étymologique est parfois contesté aux professeurs de langues anciennes, au profit de la simple consultation de dictionnaires historiques de la langue. Mais la réfutation ne résiste pas à l’expérience pédagogique : sans enseignement ni imprégnation préalables, le recours au glossaire ne se fera pas, ou restera lettre morte ou purement pédante. L’école doit donc se charger de l’étymologie, et de façon précoce. L’élève d’aujourd’hui, faute de lectures nombreuses, faute d’un horaire suffisant d’étude du français depuis les classes primaires, jusqu’au collège où l’horaire a fondu, se trouve profondément démuni de lexique dans sa langue maternelle, en quantité et surtout en qualité d’appropriation et de précision. Aussi est-il bien souvent satisfait de combler ses lacunes par les langues anciennes, qui en sus lui procurent non un savoir livresque et compilateur, mais la compréhension raisonnée des racines, des familles et de la formation des mots, ainsi qu’une autonomie personnelle lorsqu’il devient capable de comprendre par l’étymologie, sans dictionnaire, un mot français a priori inconnu.
Le premier contact avec ces langues est souvent heureux, par le biais tout d’abord de la reconnaissance de la présence en français de latin et de grec toujours vivants : du lavabo au prospectus pour le collégien, du consensus au quidam pour le lycéen, de la bouteille thermos au larynx, mots courants ou terminologie scientifique du français actuel sont souvent de simples translittérations de latin et de grec. Cette permanence des langues anciennes dans un français qu’ils connaissent et ignorent largement à la fois, légitime à elle seule, pour nombre d’élèves, l’étude des langues anciennes, et le moment d’étymologie est vite un rituel obligé, et réclamé, du cours. Les élèves dont le français n’est pas la langue maternelle, et que le système éducatif tient pour quantité négligeable, y trouvent un précieux soutien. Leurs camarades francophones y redécouvrent leur langue.
Les uns et les autres, surtout, y nouent une vraie relation avec elle, celle qui manque bien souvent ; l’étymologie leur assure que le mot n’est pas une forme vide, produit arbitraire d’une histoire absente, mais une nécessité historique et réfléchie : la Renaissance par exemple a fait des racines anciennes le réservoir toujours productif de l’appellation de réalités nouvelles, et proprement « anonymes » ou « innommables » sans le latin et le grec. Ce geste a continué après elle : les langues vivantes puisent dans le réservoir lexical des langues dites « mortes », mais qui ne le sont pas, pour combiner des racines anciennes qui désignent par leur association inédite les découvertes ou inventions modernes, l’électricité, le téléphone, le magnétoscope, la télévision, la vidéo… Toute la médecine (émergée elle aussi d’une langue qui l’a permise) parle grec, y compris pour ses techniques les plus récentes : l’endoscopie ou l’échographie émanent de racines grecques combinées qui ne sont qu’une transcription d’un alphabet à un autre. La récente EPO, érythropoïétine, « fabricante de rouge », a été baptisée aux racines grecques, et son sens est immédiat pour qui les pratique. Le clone, « rejeton, jeune branche » en grec, n’échappe pas à la règle.
Cet enrichissement de la langue transcende les frontières ; le vocabulaire des sciences, commun à toutes les langues européennes, est un puissant facteur de communication et d’échanges disciplinaires : le sens de ces termes fait l’objet d’un consensus et ne demande pas de traduction. La terminologie naturaliste de Linné, du XVIIIème siècle, en latin, a été conservée intacte pour son universalité et sa simplicité : elle a été adoptée par les Asiatiques. Et dans les jardins botaniques, le latin explique...
Etymologie et conscience de la langue
Ainsi, le travail étymologique lié aux langues anciennes revêt ainsi plusieurs fonctions, essentielles, et surtout absentes des autres disciplines de la scolarité.
A l’heure où le langage vacille, l’étymologie légitime et explique la notion même de mot, à la fois expression contemporaine et dépositaire par sa racine ou sa composition d’une histoire passée qu’il contient encore puisqu’elle le modèle. La découverte des doublets est à cet égard exemplaire, puisqu’ils combinent formes datées – formes anciennes, formes de la Renaissance -, geste volontariste de création langagière, et histoire des mentalités : c’est ainsi qu’hôpital et hôtel ont la même racine, ou bien mobile et meuble – de quoi expliquer sans contresens le Code noir où les esclaves sont proclamés « biens meubles » -, ou encore captif et chétif. Ce contenu sémantique pourrait certes s’enseigner « à froid », mais sans la connaissance du latin et du grec, il reste purement livresque, dépourvu de signification et de poids, et de l’épaisseur « humaine » nécessaire à l’acquisition d’un savoir littéraire.
Cette familiarité avec la langue a un effet paradoxal, car elle crée dans le même temps une distance salutaire avec le langage courant, et en fait un objet d’étude, en contraignant l’élève à le considérer sous un autre jour, moins immédiat mais plus expressif.
L’étymologie a aussi une fonction unifiante, qui donne des repères aux élèves. Le latin et le grec ont en effet des origines indo-européennes communes que la linguistique comparée a établies, et que l’on peut sommairement expliquer en classe. Les autres langues européennes dérivent de ces mêmes racines, et les élèves les apprennent plus facilement, sensibles à leur fonds commun. La racine stê/sta du grec, « se tenir debout », se retrouve dans le latin stare, le français stable, l’allemand stehen, l’anglais stand, l’espagnol estar…
La notion capitale de langue apparaît ainsi : elle est à la fois un présent de la communication ou de l’expression, et un passé qui la modèle et l’enrichit. Les faux-amis le montrent : une convention anglaise est certes un accord, comme en français, mais aussi une réunion, comme en latin. La découverte de cette dimension diachronique ouvre à la langue et aux œuvres littéraires.
II. Traduire : une expérience de l’histoire
L’étude du lexique des langues anciennes est ainsi une expérience de l’histoire, une leçon vivante d’histoire : la traduction exacte du mot ancien n’existe pas d’emblée. Les termes grecs et latins sont d’abord les reflets de la mentalité des peuples qui ont conçu et parlé ces langues, et à ce titre leur traduction est l’occasion d’un travail de compréhension, de comparaison et d’appréciation, également d’hésitations, qui font de l’apprentissage des langues anciennes une leçon irremplaçable d’histoire in vivo : les termes anciens sont à eux seuls des témoignages de première main, comme ceux que les spécialistes manipulent dans les dépôts d’archives ou les fouilles archéologiques. L’élève devient, en classe, archéologue actif de son propre passé linguistique, et du passé de l’humanité.
De plus, le latin et le grec ont l’avantage scientifique, pour l’étude historique, de ne plus être parlés, ce qui fige leur lexique dans un état définitif qui permet l’analyse sémantique : nul Latin, nul Grec ancien n’est présent pour corriger le mot, le charger de sens modernes qui occulteraient la saisie du passé. La clôture des corpus est irremplaçable, elle permet d’appréhender la structure et l’évolution de mentalités qui ne sont plus les nôtres : au-delà de la leçon d’histoire, la leçon de relativité, et l’interrogation sur notre propre présent, apparaissent.
Aristote ainsi définit l’homme comme un zôon politikon, expression qu’on traduit souvent, avec des connotations tout à fait modernes mais complètement fautives, par « animal politique », alors qu’il s’agit rigoureusement d’un « être vivant organisé en polis » - en « cité » -, ce qui approfondit singulièrement l’expression : il s’agit d’un « être vivant qui cherche comment vivre avec ses semblables ». Autre exemple : la domesticité esclave est en latin un mot neutre (ne-uter, « ni l’un ni l’autre »), genre réservé en général à l’inanimé : mancipium. Ce genre, appliqué à un être humain forcément sexué à qui on retire son identité, choque tout d’abord les élèves. Mais le problème est beaucoup plus complexe : le terme n’a jamais voulu dire « esclave », ni « domesticité esclave » : il signifie étymologiquement « chose prise en mains », ce qui indique, dans la société romaine, une propriété complète de l’esclave par le maître. Comment traduire ce mot ? Comment rendre compte de cette mentalité qui n’est plus la nôtre, à l’heure des « droits de l’homme » dont le mépris fait bondir les élèves ?
Aux prises avec ce sens qu’ils peinent à traduire, ils comprennent ainsi que la traduction est toujours une approximation mensongère. C’est un changement de monde, beaucoup trop profond pour qu’on puisse le traduire si facilement. Ainsi, Varron énumère trois outils agricoles : après l’instrumentum mutum, « l’outil muet » c’est-à-dire la charrue, et l’instrumentum semivocale, « l’outil semi-parlant » c'est-à-dire le bœuf, l’esclave sera désigné par instrumentum vocale, « l’outil parlant » : autre scandale pour de jeunes esprits…Va-t-on traduire par « esclave » ? La traduction littérale s’impose, mais se coulera-t-elle dans le contexte d’une phrase française ?
Dans L’Economique de Xénophon, le riche propriétaire terrien Ischomaque est censé expliquer à Socrate comment il a choisi son épouse. Il nomme le couple qu’il forme avec elle to zeugos ; mais ce mot issu du lexique agricole signifie « joug, attelage - reliant deux bœufs pour les travaux des champs » - curieuse idée du couple, racine que l’on trouve aussi dans le latin, à l’origine de l’adjectif français conjugal. Le mariage est donc présenté comme une union d’ordre économique, sur le même plan que les durs travaux ruraux. Nulle sensibilité ni affectivité n’y entrent a priori, ce que les élèves découvrent avec stupéfaction. Le mariage obligatoire du citoyen antique, pour assurer la survie politique et économique de la cité, et la reproduction de l’espèce, heurte de plein fouet des élèves qui abordent pour la première fois, avec les langues anciennes, la notion de mentalité. Alors qu’ils sont persuadés que notre mentalité a toujours eu cours, ils apprennent par les langues anciennes qu’un cheminement s’est opéré. A un autre endroit du texte grec, ils découvrent avec la même surprise que ce couple réuni « sous le joug » aura des enfants pour des raisons intéressées : leur progéniture doit être leur « bâton de vieillesse », gêroboskos. Il n’est pas mentionné, bien sûr, que cet « attelage » aura de l’affection pour ses « bâtons ». Si ce second terme imagé peut être conservé dans une traduction, le terme « couple » que l’on trouve dans la plupart des traductions pour « attelage » trahit bien évidemment la conception grecque antique.
Autant de problèmes intellectuels et linguistiques que seules posent les langues anciennes : les langues vivantes sont trop ancrées dans le présent, et de toute façon, on n’y pratique plus la traduction. La distance chronologique avec le latin et le grec est, au contraire, intellectuellement opératoire : elle donne épaisseur au passé, et même crée, par le contact direct et actif avec des états anciens de l’humanité, le sens du passé. Les langues dites « mortes » sont ainsi un ferment vivant de questionnement incessant. Elles redonnent tout son sens à l’histoire, dont l’origine grecque histôria signifie précisément « enquête ».
Le recours aux textes traduits, expédient bien souvent proposé comme alternative à l’enseignement des langues anciennes, constitue donc un contresens : il supprime le bienfait le plus évident de cet enseignement, l’exercice de confrontation avec la langue. Le texte traduit interdit le contact avec le matériau scientifique ancien authentique, et supprime également le geste primitif essentiel de la traduction individuelle, geste irremplaçable, dans la formation intellectuelle et linguistique de l’élève, d’expérimentation du hiatus fondamental entre les conceptions anciennes et nouvelles. Les exercices de traduction, confrontations avec l’étrange, mettent en demeure l’élève d’appréhender l’ancien, et de questionner la langue, le savoir et les mentalités contemporains. Le « pédagogisme » à la mode, idéologie avide d’activité personnelle de l’élève comme seul mode d’acquisition du savoir, ferait bien de remiser sa condamnation des langues anciennes : nulle discipline ne demande plus d’activité, d’investissement, et de décentrement personnels que les versions latine et grecque, passages exigeants et rigoureux d’une représentation du monde à une autre, d’une conception de l’homme à une autre idée de l’humain. De même, les jugements rapides et souvent comptables qui feraient volontiers, dans l’étude des langues anciennes, l’économie de la langue, se trompent-ils lourdement : le bébé et l’eau du bain ne font qu’un. On ne peut non plus ignorer que la révolution intellectuelle (et l’élève fait sa propre révolution intellectuelle) de la Renaissance s’est faite, contre tous les dogmes, par l’exigence de retour aux textes authentiques en langue originale et à l’enseignement de la langue grecque, un moment interdit par la Sorbonne.
L’étude des langues anciennes semble donc indispensable, non parce que, comme on le disait naguère, les œuvres antiques fourniraient des modèles moraux éternels auxquels se conformer, mais parce qu’elles constituent un modèle intellectuel : une interrogation scientifique et exigeante des conceptions et des moeurs du passé, qui se mue naturellement, par la force des choses, en évaluation de la modernité des nôtres. Il s’agit alors d’une école active d’anti-conformisme : les langues anciennes font, le temps de leur étude, voler en éclats nos usages actuels, en nous forçant à les reconsidérer à la lumière d’autres conduites ou d’autres formes d’expression sélectionnées par le passé pour leur vigueur ou leur profondeur. La Prusse ne s’y était pas trompée, qui estimait au XIXème siècle que l’enseignement du latin formait des garçons désobéissants . Nous pouvons, à notre époque, faire de ce reproche une vertu : la connaissance de l’étrangeté de l’Antiquité construit en effet ce qui nous intéresse au plus haut point : le jugement critique de nos élèves, et elle les conduit à une pensée autonome, capable d’éviter les anachronismes, d’apprécier une mentalité et de choisir ses valeurs.
III. Les pouvoirs de la grammaire
L’étude des langues anciennes a aussi d’autres vertus : je vais évoquer ici les pouvoirs de la grammaire. La place de la grammaire dans l’enseignement a fait récemment débat. On verra que, loin des idées reçues qui la considèrent comme trop austère, la grammaire est au contraire la discipline qui va aider les élèves à classer et hiérarchiser la pensée à laquelle ils accèdent.
L’immense avantage des langues anciennes sur les langues vivantes est qu’elles ne sont plus parlées. Leur apprentissage ne vise ni l’échange, ni la communication, mais un autre but : penser la langue comme un système, comme un objet grammatical fini susceptible d’étude.
Les grammaires latine et grecque n’ont ni l’austérité ni la complexité qu’on leur prête, mais éclairent au contraire le fonctionnement des grammaires française et étrangère. Comme l’alphabet et le lexique, la grammaire des langues anciennes va désorienter les élèves, mais pour les mettre, surtout les plus démunis, en état de réappropriation du système de leur langue et de ses possibilités d’expression. La métamorphose de leur regard, devenu grammatical, crée une conscience linguistique favorable à l’apprentissage de toutes les langues, et développe logique et impartialité.
L’apprentissage de la grammaire ancienne est souvent présentée comme difficile, il n’en est rien. Le système bien expliqué montre au contraire une grande clarté. Ainsi, le verbe irrégulier est un mirage : le verbe grec par exemple comporte au présent des éléments (préfixes, affixes ou suffixes) qui marquent l’actualité ; ces éléments bien entendu disparaissent au passé, qui est morphologiquement un résultat logique, et prévisible.
Pouvoir linguistique
Les langues anciennes ont pour mérite de dire, très précisément, ce que les mots font dans la phrase. Elles se caractérisent par le système de la déclinaison : outre les marques de genre et de nombre, chaque mot porte concrètement sur lui, dans les quelques lettres de sa terminaison, l’indication de sa fonction grammaticale. Les variations de terminaisons selon les fonctions (ou cas) suivent des modèles, qu’il faut mémoriser. Mais une fois appris, ce système de particularisation offre une sécurité : le mot est reconnu pour ce qu’il est, quelle que soit sa place dans l’énoncé ; alors que la langue française n’indique les fonctions que par la place du mot dans la phrase, et que nul terme, sauf quelques pronoms, n’indique par sa forme quel rôle il joue. Une simple lecture des mots latins ou grecs, au contraire, indique visiblement les fonctions grammaticales, et l’élève, en s’exerçant par la traduction à les transposer, observe des règles communes à la langue française : le détour par la langue ancienne est un outil de compréhension, surtout pour ceux qui ont des difficultés en français. De même, les élèves germanistes comprennent mieux les déclinaisons de l’allemand, car le système est transposable à toute langue à flexion. Présenter la déclinaison comme une difficulté des langues anciennes, et un obstacle à leur étude, est ainsi une erreur, puisqu’elle est un éclaircissement. D’ailleurs, là où le latin et le grec ont cinq et six cas, le finnois par exemple, dans un pays dont la réussite scolaire est montée en épingle, a quatorze cas . On n’a jamais dit que les petits Finlandais avaient du mal à apprendre leur langue.
L’ordre des mots latins ou grecs est également une école de l’expression et de la pensée : il détermine avant de nommer – comme le cas possessif anglais, ancien génitif complément du nom, qui en est l’héritage -, incluant d’abord dans la phrase toutes les circonstances et les compléments, créant un contexte, avant d’énoncer le propos, qui en est d’emblée éclairé, nuancé et mis en perspective, orienté en quelque sorte dans le choix de l’acception la plus appropriée. L’attente du verbe, souvent final, crée en revanche un espace d’interprétation, une ouverture des possibles que le français ne connaît pas.
Pouvoir scientifique
Mais le système linguistique est en même temps système intellectuel. Toute réflexion grammaticale est en effet un effort d’abstraction. L’étude de la subordination, l’analyse de la construction des phrases le confirment : la grammaire est un exercice de la raison, et modèle un type de pensée clair, structuré et hiérarchisé ; les subordonnées consécutive, finale ou concessive en donnent de bons exemples. Et beaucoup de mathématiciens expriment une dette à l’égard du latin et du grec. Ils reconnaissent dans l’analyse logique d’une phrase latine le modèle de « l’analyse descendante » de l’informatique, enseignée seulement dans le supérieur, ou soulignent, comme le biologiste François Gros, « la jonction touchante entre les banques de données et la taxinomie végétale latine ».
Les langues anciennes développent toutes les qualités de la démarche scientifique. Elles contraignent par leur nature même, leurs différences, leurs déclinaisons, à une attention permanente ; elles sont une école de concentration et de réflexes critiques. Une phrase mal construite, un subjonctif négligé altèrent le sens. Le latiniste et l’helléniste doivent aussi, comme le scientifique, poser en permanence des hypothèses, puis choisir pour des raisons objectives et motivées qui s’apparentent à la démonstration mathématique et donnent une solide armature intellectuelle, par le premier apprentissage de la pensée formelle. Les langues anciennes forment donc une passerelle irremplaçable entre sciences et lettres, car, sur des supports différents, elles dispensent le même esprit.
Un regard impartial
Par ailleurs, cet effort de rationalité arrache l’élève à son « moi ». La concision du latin, qui contraint par exemple à choisir si le sens de l’ablatif absolu, sorte de proposition participiale, est temporel, causal, ou concessif, est un effort de mise à distance essentiel, un apprentissage de l’objectivité : nulle opinion ou impression ne peut en effet être d’aucun secours. Seules comptent les règles grammaticales à appliquer, et la logique interne du texte à traduire, fondée sur des références culturelles qui ne sont pas ou plus les nôtres ; ce n’est donc pas l’élève qui dispose du sens, mais il le construit sur des bases rigoureuses, comme le scientifique dont la méthode est proche. Et si, comme dans tous les programmes actuels, toute discipline doit rendre l’élève « citoyen » donc respectueux de l’autre, le latin et le grec le font constamment, non par moralisation, mais par la mise en pratique de l’effacement personnel devant une pensée étrangère, énigme qu’il faut comprendre et restituer sans y insérer le moindre affect.
En ce sens, traduire est un acte intellectuel exemplaire, car il oblige à quitter le « registre » de l’émotion immédiate, source majeure d’anachronismes et de contresens, pour accéder à la compréhension rigoureuse
Cette rigueur n’est pas une stérilisation : au contraire, l’espace d’étrangeté introduit par le respect de l’altérité de la pensée ancienne ouvre sur l’imaginaire et amplifie la liberté intellectuelle.
IV. Langues anciennes et culture.
Les textes et œuvres : une lecture humaniste
Le même esprit préside à l’étude des textes et des œuvres. Comprendre leur sens sans y plaquer les représentations contemporaines implique un effort de contextualisation historique et littéraire qui leur donne toute leur valeur. Le professeur doit ici guider les interprétations, les élèves étant tentés de croire que les conceptions antiques ne sont qu’une variation des nôtres. Aucun élève ne peut saisir par lui-même que le texte de la Guerre des Gaules n’est pas exactement un « journal de guerre », mais qu’il est sous-tendu par le contexte politique de Rome et tend à la propagande. De même, l’affrontement entre Hector et Andromaque avant le départ d’Hector pour le combat dans L’Iliade n’est pas le fac-similé d’une vraie conversation, mais la mise en scène de la souffrance égale de deux époux et de l’opposition entre la sensibilité qu’exprime Andromaque et le désir de gloire que défend Hector. De même, La Germanie de Tacite n’est pas un reportage, mais un ouvrage d’actualité où se lit la représentation qu’avaient les Romains des « barbares », et en miroir celle de leur propre décadence.
Le contact direct des élèves avec le texte ancien leur permet de repérer les sens, les procédés, et les ouvre à l’interprétation littéraire et historique. Cela n’empêche pas leur implication : tous sont sensibles aux plaintes d’Andromaque, orpheline de toute sa famille, pour qui Hector est l’addition de son père, de sa mère, de ses frères disparus… Tous prennent plaisir au premier degré à connaître les mœurs supposées des Gaulois ou des Germains, hautes en couleur… Mais il faut dire ici ce qu’ignorent beaucoup de détracteurs des langues anciennes : les œuvres antiques ne sont plus depuis bien longtemps lues comme des évidences, ni comme des modèles intangibles d’humanité et de conduite. Au contraire leur étude, renouvelée par les recherches historiques, philosophiques, comparatistes, de Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet et bien d’autres, montre le caractère étrange, interrogateur de notre temps et de notre condition, de bien des usages antiques transmis par les textes.
Ainsi, ni dans la méthode, ni dans les supports, on ne lit plus L’Iliade comme il y a cinquante ans, ni L’Enéide. Les élèves y gagnent en réflexion, en méthode historique, en approfondissement des grands problèmes de l’humanité dont traitent les textes anciens, nous sommes ici au centre du thème de ce cycle de conférences. Pourquoi Achille choisit-il la mort jeune, en pleine gloire, au lieu d’une vie longue ? Pourquoi décide-t-il de s’acharner sur le corps d’Hector après l’avoir tué ? Que nous disent ces textes de la vie et de la mort ? Pourquoi faut-il les comparer ? Autant d’occasions de réflexion sur des visions de l’humain transmises par les langues anciennes et les textes de leur littérature. Ces « mémoires de l’humanité », comme le dit Marc Fumaroli, sont pour les élèves l’occasion d’interroger leur propre condition, et de pratiquer, pour la première fois, les véritables méthodes de la recherche.
L’interdisciplinarité et la culture
Ainsi, le cours de grec ou de latin excède constamment ses contours.
Le contenu des textes anciens, le commentaire de l’étymologie et de la grammaire ouvrent à toutes les disciplines et toutes les réflexions. Sciences de la vie, physique, mathématiques sont constamment sujet des cours de latin et de grec, selon une interdisciplinarité véritable. Les arts, le droit, les lettres, l’histoire sont abordés et interrogés.
La mythologie conduit, entre autres, au « complexe d’Œdipe » et à la psychologie sinon la psychanalyse, L’Iliade au « talon d’Achille » mais aussi à une conception de l’honneur, l’idée de démocratie ou la tyrannie aux conceptions politiques de notre temps…L’histoire antique offre des réflexions en abyme : par exemple, David représentant l'Enlèvement des Sabines permettait à ses contemporains de se pencher sur la situation révolutionnaire, l'Antiquité offrant par mise à distance une réflexion sur l'actualité politique de la fin du XVIIIème siècle. Picasso dans Guernica fait un hommage à Poussin représentant le même épisode, et montre la permanence de la leçon sur la guerre civile dans les réécritures artistiques.
Les programmes des autres matières, contraignants, empêchent souvent les élèves d’obtenir un éclairage du temps présent, alors qu’ils sont avides d’information, de réflexion, de savoir. Le latin et le grec, au contraire, permettent de traiter ou d’expliquer l’actualité ; et surtout de répondre à bien des curiosités d’adolescents. Ce lieu d’échanges, ce cours général, manquerait cruellement s’il venait à disparaître : il est celui où les élèves, par la traduction et l’ouverture à l’histoire, par la conscience éprouvée de la notion de mentalité, par l’interrogation sur les mythes, se forment à la réflexion et se cultivent, en une sorte de propédeutique à la philosophie, et demandent qu’une réponse intellectuelle et culturelle soit apportée à leurs questions. Or trop souvent, l’école ne leur répond pas. Pourtant, seule l’école – scholê en grec, le « temps libre » pour réfléchir - peut offrir ce lieu : elle seule en réunit les moyens d’information et de méthode de pensée, à l’abri des diversions et des influences : « Pour former l'humanité il faut se soustraire un moment à la société. »
La lecture de la littérature
La présence de la langue, des thèmes, des réécritures de l’Antiquité dans la littérature, française en particulier, est une évidence, mais qui doit être réenseignée à chaque génération. Comment bien comprendre nos écrivains, sans avoir accès au matériau dans lequel ils ont sans cesse puisé ?
De La Fontaine relisant La Matrone d’Ephèse de Pétrone, à Racine ressuscitant à sa manière Néron, Agrippine et Britannicus, ou Zola dans Germinal appelant le puits de mine Le Voreux, réincarnation moderne du Minotaure, toutes les œuvres littéraires s’appuient, pour s’en enrichir ou les relire à la lumière de leur propre actualité, sur les thèmes, les motifs et les langues qui les ont précédées et formées. Jusqu’à notre époque : ainsi, Giraudoux reprend-il l’histoire d’Electre en 1938, et Sartre cinq ans plus tard sous l’Occupation… Les œuvres de Pascal Quignard ou Henri Bauchau, par exemple, appuient leur signification la plus moderne sur des œuvres ou des figures antiques. Aucun de ces auteurs ne cherche à restituer l’Antiquité, mais ils l’utilisent comme un bien commun en constante reformulation, même si leurs livres ne sont pas directement consacrés à telle ou telle oeuvre de l'Antiquité. Ainsi, l’Allemand Bernard Schlink, dans son dernier livre, Le Retour, interprète L’Odyssée et le personnage d’Ulysse comme figures de son intrigue. Ainsi, le récent film de Christophe Honoré, La Princesse de Clèves, donne à la Princesse le prénom de Junie, réctualisant ainsi l’histoire romaine, et le destin du personnage de Racine, que le cinéaste lit à son tour comme un modèle de celui de la retraite finale du personnage.
De même, la tragédie, genre grec, vit de la perpétuelle relecture de ses fondements. Racine choisit, comme Aristote l’avait prescrit, des conflits en philiais (« entre proches ») parce que l’essence du tragique s’y révèle dans toute sa dureté. Shakespeare reprend le chœur antique sous forme d’un personnage. Hofmannsthal adapte dans Elektra la pièce antique de Sophocle. Cocteau voit dans Œdipe-Roi sa propre existence : c’est La Machine Infernale… Et ainsi de suite : la littérature antique éclaire les écarts ou les transformations que les écrivains opèrent sur elle, et révèle ainsi le sens qu’ils lui donnent.
La langue littéraire elle-même se comprend mieux avec les langues anciennes. Pour ne suivre qu’un seul adjectif, ater, atra, qui signifie « noir », Le Misanthrope s’éclaire de s’appeler en sous-titre L’Atrabilaire amoureux, « l’Angoisse atroce » de Baudelaire dans Spleen de « plante(r) son drapeau noir ». De même, « le soleil noir de la mélancolie », l’oxymore bien connu des Chimères de Nerval, double son sens lorsqu’on connaît l’étymologie de « la mélancolie », « la bile noire » des Anciens, selon la théorie des humeurs d’Hippocrate. Mais « la bile noire » était censée siéger dans la rate, spleen en anglais… la boucle est bouclée.
Lors de la dernière session du baccalauréat - juin 2008, un extrait de Proust comparait un vieil homme, en lutte contre la décrépitude, à un récif assiégé par les vagues. Or une note de bas de page donnait aux candidats, pour le verbe utilisé « circonvenir », le sens figuré moderne de « persuader par la ruse », et non le seul sens convenant au contexte, « assiéger, encercler », sens propre indiqué par le latin circumvenire… Une occasion manquée de lecture exacte des grands écrivains. Sans latin, le contresens.
V. Un avenir à construire.
Une nécessité civique
La richesse du latin et du grec réside donc dans un arrière-plan permanent de références et de va-et-vient. Ils sont tout aussi capitaux pour la formation d’un esprit nuancé, logique et libre, assez ouvert et cultivé pour concevoir et exprimer les nouvelles formes de l’avenir.
Mais il faut s’interroger sur l’avenir des langues anciennes.
Leur transmission s’impose plus que jamais, pour ne pas démunir les élèves des armes qu’ont reçues leurs aînés. Moins enseigner, dans un pays qui se dit « moderne », est une régression, j’aurais envie de dire une récession.
De nouvelles raisons donnent à cet enseignement un caractère d’urgence, en particulier l’utilisation grandissante d’un français sans racines, qui déréalise le monde et occulte sa complexité, alors que le latin et le grec font exactement le contraire.
Coupée de toute étymologie, une novlangue technocratique ampoulée, spongieuse et incompréhensible se développe. Toute la langue médiatique et administrative en est atteinte et perd le sens, comme en témoignent les euphémismes hypocrites, l’inversion du sens et de la logique des « plans sociaux » - qui ont tout du « plan », mais rien du « social », ou des collèges « ambition-réussite »… comme par hasard implantés dans les zones défavorisées, et qui ne comportent ni « ambition », ni « réussite ».
L’incapacité de saisir une pensée élaborée se répand. Jean-François Kahn fait part de son désarroi : « Nous allons devoir changer notre mode d'écriture. Il y a un type de phrase qui est mort, …c'est-à-dire une phrase construite, longue, avec des incidentes. Il faut des phrases plus courtes. (…) Je reçois des lettres de lecteurs qui me disent qu'ils ne comprennent pas tout ce que j'écris.»
L’effondrement de la compréhension n’est ainsi plus une affaire de professeurs, car elle attente à l’information des citoyens et au débat démocratique, et beaucoup s’en émeuvent : des physiciens par exemple craignent que le public ne puisse plus saisir des enjeux de société à contenu scientifique, qu’il n’y ait plus de langue pour les exposer, comme la question des OGM, ou que la primauté de la passion sur une réflexion étroitement dépendante d’une langue complexe conduise à des décisions nocives ; un physicien disait qu’il existait malheureusement des « décideurs incultes ».
La responsabilité politique
La question est donc politique : seul l’Etat peut fixer, dans les principes républicains et contre les obscurantismes, les savoirs et les capacités du citoyen, et protéger ces savoirs contre les pressions utilitaristes, idéologiques et économiques qui voudraient bien changer les programmes.
Heinz Wismann et Pierre Judet de la Combe ont éclairé la question : une langue « de culture », c'est-à-dire chargée du poids humain du passé, de l’expérience séculaire de la réflexion, et riche de moyens d’expression élaborés, est la seule à même de définir et régler des questions humaines, et de permettre une pensée complexe et nuancée, capable de gérer la nouveauté et la difficulté de l’avenir. Ils les opposent aux langues de communication immédiate et instantanée, dites « de service », dont l’efficacité est liée à un contenu utilitaire ne donnant lieu à aucune équivoque, comme l’anglais globish de 1500 mots ne réglant que le concret. Pauvres, dépourvues de toute distance, elles ne peuvent, dans leur éternel présent, transmettre le passé, ni penser l’avenir ni exprimer les opérations de l’intelligence ou les nuances de la sensibilité. Pour penser la modernité, préserver les échanges entre peuples et les capacités de traduction littéraire, juridique , diplomatique ou scientifique, bannir les « langues de bois » intraduisibles, il faut donc l’outil souple d’une langue maternelle de culture forgée par le passé, dont l’apprentissage du latin et du grec fournissent le modèle, la conscience, l’exercice, et l’habitude de l’énigme à résoudre, figure de l’avenir.
Or la responsabilité de l’école dans l’absence de « langue de culture » est lourde ; les horaires de français ont fondu, des pédagogies irresponsables ont retiré à l’enseignement de la grammaire sa rigueur et sa régularité en obligeant au collège, à n’étudier la grammaire qu’épisodiquement, à l’occasion du hasard des phénomènes de langue dans les textes, des idéologues ont accusé la langue d’être « fasciste » et l’ont discréditée, le formalisme desséchant des réformes de l’enseignement du français a privé les élèves du contenu des œuvres. Ils ne peuvent plus se pencher sur la narration et le symbole, il faut d’abord qu’ils classent les œuvres étudiées dans les « genres » et les « registres »
La situation des langues anciennes, quant à elle, est profondément dégradée.
Ainsi une idéologie tenace continue de confondre sans réfléchir nouveauté et qualité. Ainsi règne partout la doxa de la supériorité des langues vivantes sur les anciennes, ce qui est une erreur historique et pédagogique, car les langues vivantes européennes dérivent des langues anciennes, qui facilitent grandement leur apprentissage.
Elle se conjugue avec les reproches obsolètes mais vivaces de collusion entre langues anciennes et bourgeoisie, du temps révolu où cette classe sociale liait études et latin. Un autre préjugé voudrait ne faire étudier que des matières supposées « utiles » à une vie professionnelle réussie ; or utilité et formation intellectuelle ne s’opposent pas, mais coïncident. Seule une véritable formation de l’esprit, alliée à la culture, permet de faire face aux adaptations ou aux changements professionnels.
Le discrédit généralisé du savoir achève le tableau.
Ces idées reçues forment la couverture idéologique d’un modèle économique visant à restreindre des services publics jugés trop coûteux, et à diminuer les enseignements. Les assemblées accusent le système scolaire d’« accapare(r) une part croissante de la richesse nationale », comme si l’instruction était un détournement d’argent public. En particulier, députés, sénateurs et ministres s’attaquent depuis plusieurs années aux matières optionnelles, ce que sont les langues anciennes. En 2003 déjà, Xavier Darcos maintenant ministre disait : « Les options qui consistent par exemple en l'étude d'une langue rare, doivent être rationalisées car elles concernent peu d'élèves, mais représentent un coût de recrutement très élevé. ». Contre-vérité patente pour les langues anciennes dont les professeurs ne coûtent pas cher : ils enseignent aussi le français. Mais le latin et le grec, optionnels, tombent sous le couperet, qui sera pire encore lorsque la réforme du lycée prévue par le ministre pour 2009, fondée sur le rapport pédagogiste Meirieu de 1998 et sur des conceptions strictement comptables , réduira les horaires et les options.
Cette volonté ancienne de suppression n’a pas engagé un combat frontal, mais une stratégie silencieuse des ministères successifs, d’autant plus difficile à combattre : effacement des règles, mesures dissuasives, disparités locales, pourrissement de situations fragiles.
Ainsi, des textes officiels fixent l’étude des langues anciennes, mais leur rédaction est floue ; des formules admirables le définissent : « l’enseignement du latin a vocation à être suivi », « il est destiné à être suivi » ; passifs impersonnels : « suivi », oui, mais par qui ? Ainsi, les textes officiels ne disent pas clairement si l’élève qui a choisi le latin doit le continuer jusqu’à la fin du collège : c’est pourquoi des établissements et leurs conseils d’administration autorisent leurs élèves à abandonner le latin en fin de 5ème ou de 4ème, ou le grec après quelques mois de 3ème.
En 2005, une nouvelle option de 3ème créée par le ministère Fillon, la « découverte professionnelle », une simple diffusion d’informations sans contenu intellectuel, est venue concurrencer l’option grec. La même année, les établissements ont été habilités, dans le cadre de « l’autonomie », à inscrire dans leur offre des « dispositifs expérimentaux », notamment de langues vivantes - classes « bi-langues » ou européennes – incompatibles avec les langues anciennes, et ont autorisé localement leurs élèves à abandonner le latin commencé en 5ème, ou leur ont interdit de choisir le grec.
Enfin l’obsession des économies réduit la dotation horaire des établissements, met en concurrence le latin et le grec avec d’autres options, supprime des postes de professeurs, et foule aux pieds les règlements : les horaires officiels ne sont pas respectés, des niveaux différents sont regroupés dans la même classe (4ème et 3ème, Première et Terminale) à des heures dissuasives, des rectorats instaurent des quotas en dépit des inscriptions et restreignent artificiellement les effectifs, des sections de latin et de grec sont fermées dans nombre de collèges et lycées : en invoquant des raisons disparates, les rectorats contraignent les établissements publics à assurer seulement les enseignements obligatoires aux dépens ces matières optionnelles ou les langues que M. Darcos appelle « rares » – ce qui a en partie causé l’effondrement de la filière littéraire, fondée sur des options. Ensuite le ministère justifie les fermetures, en prétextant la faiblesse d’effectifs qu’il a tout fait pour raréfier.
Ce faisant il nuit à l’égalité des chances et à l’équité républicaine : l’étude des langues anciennes aide les élèves en difficulté , mais dans les zones dites « prioritaires », les expérimentations de « latin-grec thérapeutique » ont été supprimées, ainsi que nombre de sections. Ce malthusianisme d’Etat crée un nouvel élitisme de caste, bien plus efficace et insidieux que les réflexes bourgeois. Les projets de « pôles », réservant l’étude du latin et du grec à certains établissements de grandes villes – voire à l’enseignement privé dans certaines académies -, vont créer des déserts intellectuels inégalitaires, anti-démocratiques. Pour désarmer les oppositions, le cabinet de Luc Ferry appelait ce projet, en novlangue, « une politique volontariste d’implantation » . Pour brouiller le débat en inversant le sens des mots, M. de Gaudemar a accusé de « dérive élitiste » les professeurs qui réclamaient la réouverture des sections fermées... Or l’élitisme est justement le refus d’enseigner à tous.
La demande sociale est pourtant là : 20% des élèves de 5ème réclament d’apprendre le latin, qui est la seconde langue enseignée en France . Mais la pression libérale et idéologique est la plus forte : beaucoup de ces débutants de 5ème seront, en réalité, empêchés d’entreprendre ou de poursuivre l’étude du latin et du grec.
La pression européenne
L’enseignement des langues anciennes est à un autre carrefour : ce n’est plus l’Etat en effet qui fixe les structures d’enseignement, mais les instances européennes. Or, le contenu du « socle commun des connaissances et des compétences » qu’elles ont fixé exclut le latin et le grec, ainsi que l’idéal intellectuel qui préside à leur place précoce dans un cursus scolaire. Pourtant le latin a longtemps été pour l’Europe, jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la langue des échanges dans le domaine de la pensée et des sciences, que les langues vernaculaires de l’époque étaient trop pauvres pour assurer. Il ne s’agit pas ici de vouloir ressusciter un monde disparu, mais d’en conserver l’idéal intellectuel, celui d’une langue complexe, riche et élaborée, « de culture », liée aux exigences de la pensée.
Au contraire, les instances européennes ont prévu non pas d’assurer la formation d’esprits cultivés donc autonomes, « auteurs de leur pensée », mais de satisfaire les demandes économiques de l’OCDE, visant à faire des individus des outils humains du commerce international. Car, selon la Table ronde des industriels européens, " l’éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique ". Dans ce but, la liaison entre les connaissances doit être rompue, au profit de « compétences » juxtaposées, censées répondre aux besoins codifiés de « l’employabilité ».
Samuel Joshua le dit très bien : " Il est clair que le succès de ce mouvement mettrait gravement en cause la nécessité de l'école. L'idée peut en effet dans ces conditions s'installer que l'école " fera toujours trop de culture ", que les savoirs liés à des œuvres humaines considérées comme importantes dans le passé sont de moins en moins utiles. Ceci agit comme une des remises en cause les plus brutales que l’on puisse imaginer de la présence même à l’école de savoirs formels socialement reconnus . »
Le bénéfice intellectuel irremplaçable des langues anciennes devrait au contraire conduire à en faire, au collège, un complément obligatoire de l’enseignement du français, et au lycée d’une part un élément obligatoire du cursus littéraire, d’autre part une matière optionnelle ouverte à toutes les autres séries, le tout constamment placé sous l’autorité de l’Etat seul à même de définir et garantir un savoir désintéressé.
Sans sursaut à l’échelon national, sans renégociation à l’échelon européen, l’émancipation des esprits, inscrite dans les principes républicains, sera révolue, l’idée même d’école aura changé de sens, et la culture de contenu. Or si l’éducation doit assurer « un service rendu », ce n’est pas à l’économie, mais à l’humanité en chacun de nos élèves.
Agnès JOSTE
Dans la même collection
-
Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? - Jean-Hugues Barthélemy
BarthélémyJean-HuguesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Quel nouvel humanisme aujourd'hui ? par Jean-Hugues Barthélemy, Recherches contemporaines de la philosophie, Paris 8
-
Un humanisme est-il encore possible ? - Rémi Brague
BragueRémiUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Un humanisme est-il encore possible ? par Rémi Brague, Philosophies grecques, médiévales et orientales, Sorbonne
-
Les humanités réactionnaires - Thierry Ménissier
MénissierThierryUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité" Les humanités réactionnaires par Thierry Ménissier
-
Les humanités aujourd'hui - Marc Fumaroli
FumaroliMarcUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Les humanités aujourd'hui par Marc Fumaroli
-
Humanités pour le post-humain - Yves Michaud
MichaudYvesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Humanités pour le post-humain par Yves Michaud
-
La moraline et les moralistes - Jean-Charles Darmon
DarmonJean-CharlesUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" La moraline et les moralistes par Jean-Charles Darmon La tentation a souvent été grande de légitimer l’enseignement de
-
Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d'une expérience personnelle - Ginette Vagenheim
VagenheimGinetteUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Du Rwanda à Homère et Virgile, récit d’une expérience personnelle ou comment l’Europe plongea ses racines en Afrique.
-
Actualités de Cicéron - Clara Auvray-Assayas
Auvray-AssayasClaraUne conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?" Actualité de Cicéron ? Par Clara Auvray-AssayasLangues et littératures anciennes, Université de Rouen, IUF
Sur le même thème
-
La continuation des fastes d’Ovide par les Dijonnais Claude-Barthelemy Morisot : l’analyse stylomét…
La présentation commencera par une brève contextualisation de la recherche: Claude-Barthélemy Morisot (auteur Dijonnais du XVIe siècle) a complété l’œuvre de fastes d’ovide, en écrivant les 6 livres
-
Entretien avec Sarah Orsini
OrsiniSarahMarlhouxRomaneEntretien avec Sarah Orsini par Romane Marlhoux pour le projet EVEille.
-
« Traduire, pour quoi faire ? » Ateliers de traduction et pédagogie de projet : une œuvre ouverte
DesseinDominiquePrésentation d’ateliers de traduction avec fabrication de podcasts en classe de Terminale spécialité Littératures, Langues et Cultures de l’Antiquité.
-
Faire traduire au collège : gageüre ou perte de temps ?
Ramos-FilaireVincentProposition d’un cahier des charges pour la mise en place d’ateliers de traduction collaboratifs permettant un apprentissage efficace de la traduction en collège.
-
Comprendre pour traduire et traduire pour comprendre - Propositions pour aborder la traduction en l…
DuartePedroActivités de traduction remettant en cause la notion de « traduction de référence » pour lui substituer celle de « traductions possibles », adaptées le cas échéant au destinataire visé.
-
MELPOMEN, la Méthode d’Élucidation du Latin par Permutation de l’Ordre des Mots selon l’Énonciation…
JeanjeanBenoîtPrésentation de la méthode mise au point par l’auteur pour faciliter la traduction du latin, via lecture de texte dont l’ordre des mots a été remanié pour paraître plus naturel aux francophones.
-
Traductions et manipulations textuelles - Expérimentations pratiques entre grec et français
DelattreCharlesProposition d’un dispositif de lecture de textes authentiques faisant appel aux méthodes actives pour une meilleure compréhension, puis réflexion sur l’art de traduire ces textes.
-
Ne pas traduire… pour mieux traduire ?
Clément-TarantinoSéverineLecaudéPeggyNe pas traduire… pour mieux traduire ?
-
Lire ou traduire, faut-il choisir ? Quelques réflexions sur l’exercice de la version
HammouMalikaAperçu de l’utilisation de textes « forgés », des premiers pas en grec ancien à une maîtrise fluide de la langue, pour une meilleure compréhension des textes authentiques.
-
Évaluer des latinistes débutants en traduction : comment faire de l’évaluation un levier d’apprenti…
CallizotIsabelleProposition de mise en place de divers outils d’auto-évaluation et d’évaluation formative pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme en traduction.
-
Cinq étapes-clés dans la mise en place de réflexes de traduction
LoaëcDavidProposition d’un protocole d’accompagnement pour permettre aux élèves de développer des réflexes de traducteur face à un texte latin.
-
"Attentif comme un arc" : la traduction des expressions imagées à l'épreuve du sens
PlatonMariePrésentation d’activités de traduction d’expressions imagées latines et grecques par des étudiants grands débutants en latin et en grec ancien en Classes préparatoires aux Grandes Écoles.