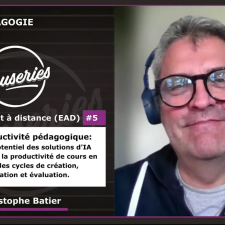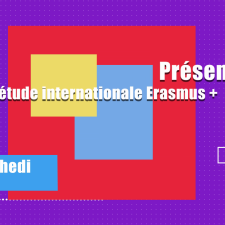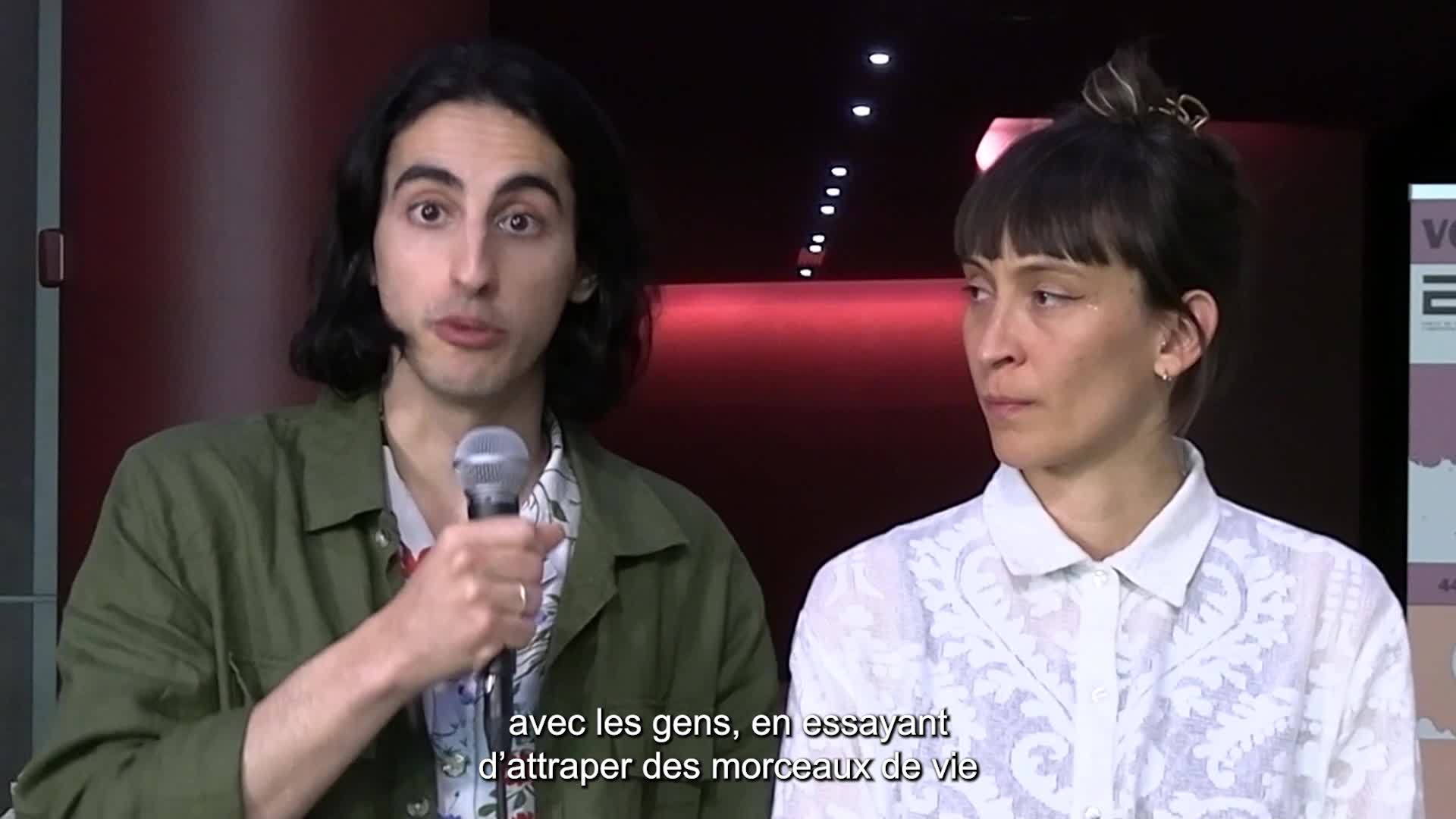Chapitres
- La perception du numérique en pédagogie universitaire aujourd'hui, entre transformations et permanences : résultats d'une enquête à l'Université de Strasbourg19'25"
- Ingénieur pédagogique et numérique en première ligne de la formation à distance dans les organismes de formation privés21'19"
- Enseigner et apprendre en comodalité : une étude de cas au secondaire19'50"
Notice
Transformation des modes d’organisation du travail des enseignants, étudiants et personnels de soutien - 03 - Francophone
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Une conférence proposée et organisée par le Cned, DMS et The Open University.
Président de session : Laurent PETIT
La perception du numérique en pédagogie universitaire aujourd'hui, entre transformations et permanences : résultats d'une enquête à l'Université de Strasbourg
Intervenante : Sophie KENNEL
Co-auteurs : Stéphane GUILLON, Stéphanie MAILLES VIARD METZ
Ingénieur pédagogique et numérique en première ligne de la formation à distance dans les organismes de formation privés
Intervenante : Yuchen CHEN
Co-autrice : Céline HOARAU
Enseigner et apprendre en comodalité : une étude de cas au secondaire
Intervenantes : Prisca FENOGLIO, Lucile CADET
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
La perception du numérique en pédagogie universitaire aujourd'hui, entre transformations et permanences : résultats d'une enquête à l'Université de Strasbourg
A partir d’une étude menée auprès des enseignants et enseignants-chercheurs de l’Université de Strasbourg en France, nous analysons le ressenti des 418 répondants à une enquête portant sur leur expérience d’enseignement durant les deux périodes d’enseignement en ligne contraint de 2020 et 2021. Nos résultats montrent, sans surprise, un ressenti négatif de la part des personnes interrogées. 79 % des répondants considèrent que l’expérience d’enseignement vécue depuis mars 2020 a été difficile ou très difficile (79 %) et 51% ne sont pas satisfaits de leur bilan. La comparaison des réponses entre les personnes ayant exprimé ce ressenti négatif et celles s’estimant plutôt satisfaites de l’expérience pointe des écarts importants sur les sujets suivants : la difficulté à maîtriser les outils et à résoudre les problèmes techniques pour enseigner et produire des ressources pédagogiques, la qualité de la relation pédagogique à l’étudiant et la capacité à adapter ses pratiques pédagogiques à la distance, notamment liée au manque de temps. Nous constatons cependant que ce n’est pas tant la compétence ou la pratique numérique qui marque les écarts, que la perception de la relation à l’étudiant ainsi que des pratiques et compétences pédagogiques.
Ingénieur pédagogique et numérique en première ligne de la formation à distance dans les organismes de formation privés
Cette étude s’intéresse au métier d’ingénieur pédagogique et numérique dans les organismes de formation privés aux prises avec le défi du développement de la formation à distance à l’heure actuelle. Il s’agit d’analyser leurs pratiques professionnelles quotidiennes dans une perspective de compréhension de la professionnalisation du métier. Le cadre d’analyse se construit autour d’une part des enjeux et des impacts de la digitalisation de la formation professionnelle, et de l’autre, des éclairages apportés par les travaux issus de la pédagogie universitaire. La démarche méthodologique est qualitative et compréhensive. Les données sont constituées de onze entretiens semi-directifs et font l’objet d’une analyse thématique des contenus au regard des questions de départ. Les résultats permettent d’abord de cerner le contour du métier ainsi que la place qu’il occupe dans l’organisation des activités de formation, ensuite, d’identifier leurs actions en matière de mise en œuvre de formation digitale à distance, et enfin, d’observer les tendances d’évolution sur le plan des activités et des compétences nouvelles.
Enseigner et apprendre en comodalité : une étude de cas au secondaire
Cette étude a pour point de départ la préoccupation, par une enseignante de français d’une classe de 4e du secondaire en comodalité, de mieux inclure une élève à distance lors des échanges collaboratifs entre élèves. Qu’observe-t-on du point de vue des ajustements faits par l’enseignante et de leurs effets sur les interactions ? Nous examinons cette question en interrogeant l’orchestration des ressources multimodales d’inclusion. Notre corpus est constitué d’extraits illustratifs de vidéos de trois groupes auxquels participe l’élève à distance, ainsi que d’entretiens conduits auprès de l’enseignante (semi-directif et d’auto-confrontation) et de l’élève à distance (directif). De multiples ressources au sein d’espaces démultipliés sont mobilisées par l’enseignante. Au fil des ajustements qu’elle effectue, l’engagement des élèves permet de faire l’hypothèse d’interactions plus inclusives de l’élève à distance – perçues à la fois par l’enseignante et par l’élève. La démarche exploratoire et réflexive de l’enseignante semble favorable au fonctionnement inclusif de la comodalité, qui est toutefois couteuse pour les interactants. Ces résultats interrogent les compétences nouvelles à mettre en œuvre dans une situation inédite dont les modalités pédagogiques collaboratives s’appuient sur des compétences « anciennes ».
Dans la même collection
-
Transformation in teaching and learning - 02 - English
GiacosaAntonellaLuporiniAntonellaZhaiYumingNamYunjungWolfendenFredaExploring the Design and Application of an Intelligent French Dictation Platform. / Legacy and Lessons from the Emergency Online Teaching and Assessment in Language Courses. / Ragazzi, can you hear me
-
Transformation in teaching and learning - 01 - English
SticklerUrsulaPapadopoulouMelpomeniJohnsonJane HelenCovid crisis management in higher education in France: the case of distance learning. / From the classroom to a MOOC. University teachers' experiences compared.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La formation à distance comme lieu privilégié pour l'apprentissage autorégulé
ChenYuchenCette étude s'intéresse à la place de l'autorégulation et à l'émergence de cette compétence du point de vue des apprenants engagés dans une formation à distance. Le concept de l'apprentissage
Sur le même thème
-
Causeries Pédagogie - Enseignement à distance #5 - IA et productivité pédagogique
PorlierChristopheBatierChristopheCauseries Pédagogie - Enseignement à distance #5 - IA et productivité pédagogique
-
Présentation du dossier journée Erasmus
Présentation du dossier en vidéo
-
- Le numérique au quotidien : pratiques et enjeux dans une classe soutenue par une ULIS-collège
AssudeTeresaFeuilladieuSylvianeBussezAlexandraMartinPerrineLe numérique au quotidien : pratiques et enjeux dans une classe soutenue par une ULIS-collège
-
Zsófia Paczolay et Dorian Rivière parlent de leur film "Je suis là"
PaczolayZsófiaRivièreDorianInterview de Zsófia Paczolay et Dorian Rivière pour leur film "Estou Aqui"/"Je suis là", en compétition à la 44ème édition du Festival International Jean Rouch en 2025.
-
Matthew Wolkow parle de son film "Eastern Anthems"
WolkowMatthewInterview de Matthew Wolkow pour son film co-réalisé avec Jean-Jacques Martinod "Eastern Anthems" en compétition à la 44ème édition du Festival International Jean Rouch en 2025.
-
Évaluer des usages du numérique à l'école primaire : un regard didactique sur des pratiques ordinai…
DupréFrédéricÉvaluer des usages du numérique à l'école primaire : un regard didactique sur des pratiques ordinaires
-
Usage du numérique dans une dynamique inclusive : impact d'une pratique coopérative sur l'accès aux…
Louge DupratMagalieUsage du numérique dans une dynamique inclusive : impact d'une pratique coopérative sur l'accès aux savoir.
-
Enjeux, principes et outils de l'observation in situ des usages pédagogiques inclusifs du numérique
BenoitHervéEnjeux, principes et outils de l'observation in situ des usages pédagogiques inclusifs du numérique
-
Le projet GTnum à l'échelle d'un territoire académique : témoignage de Julien Roche
RocheJulienLe projet GTnum à l'échelle d'un territoire académique : témoignage de Julien Roche
-
Un questionnaire académique pour donner à voir les pratiques numériques inclusives
DupréFrédéricBenoitHervéUn questionnaire académique pour donner à voir les pratiques numériques inclusives
-
Évaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation (GTnum) : état de l'art
Petry-GenayIsabelleBenoitHervéÉvaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation (GTnum) : état de l'art. Hervé Benoit et Isabelle Petry Genay, INSEI.
-
Ouverture de la journée GTnum#EvalNumInclus 2025
BenoitHervé"Évaluer l'inclusivité d'un dispositif numérique dans l'éducation"