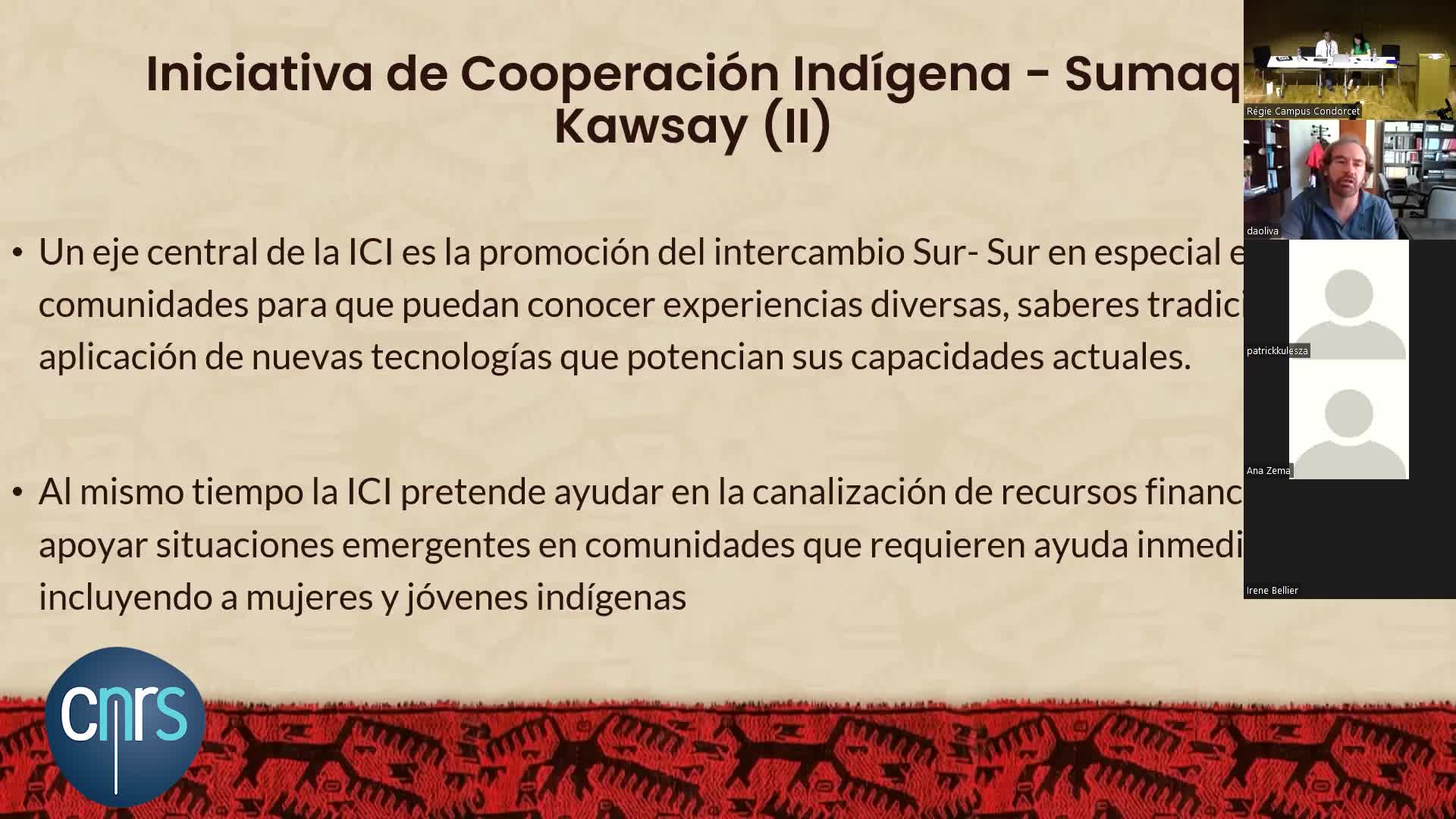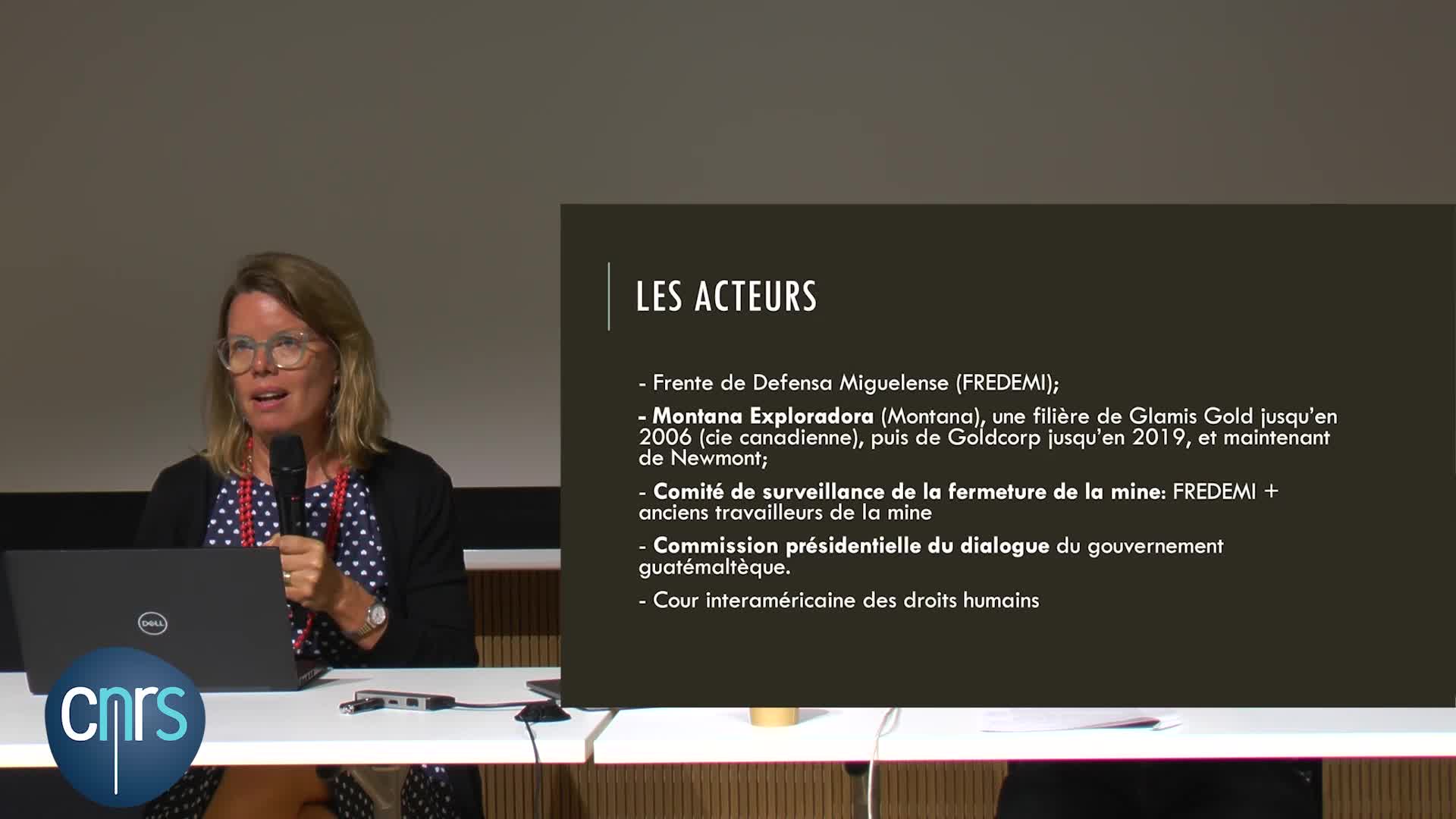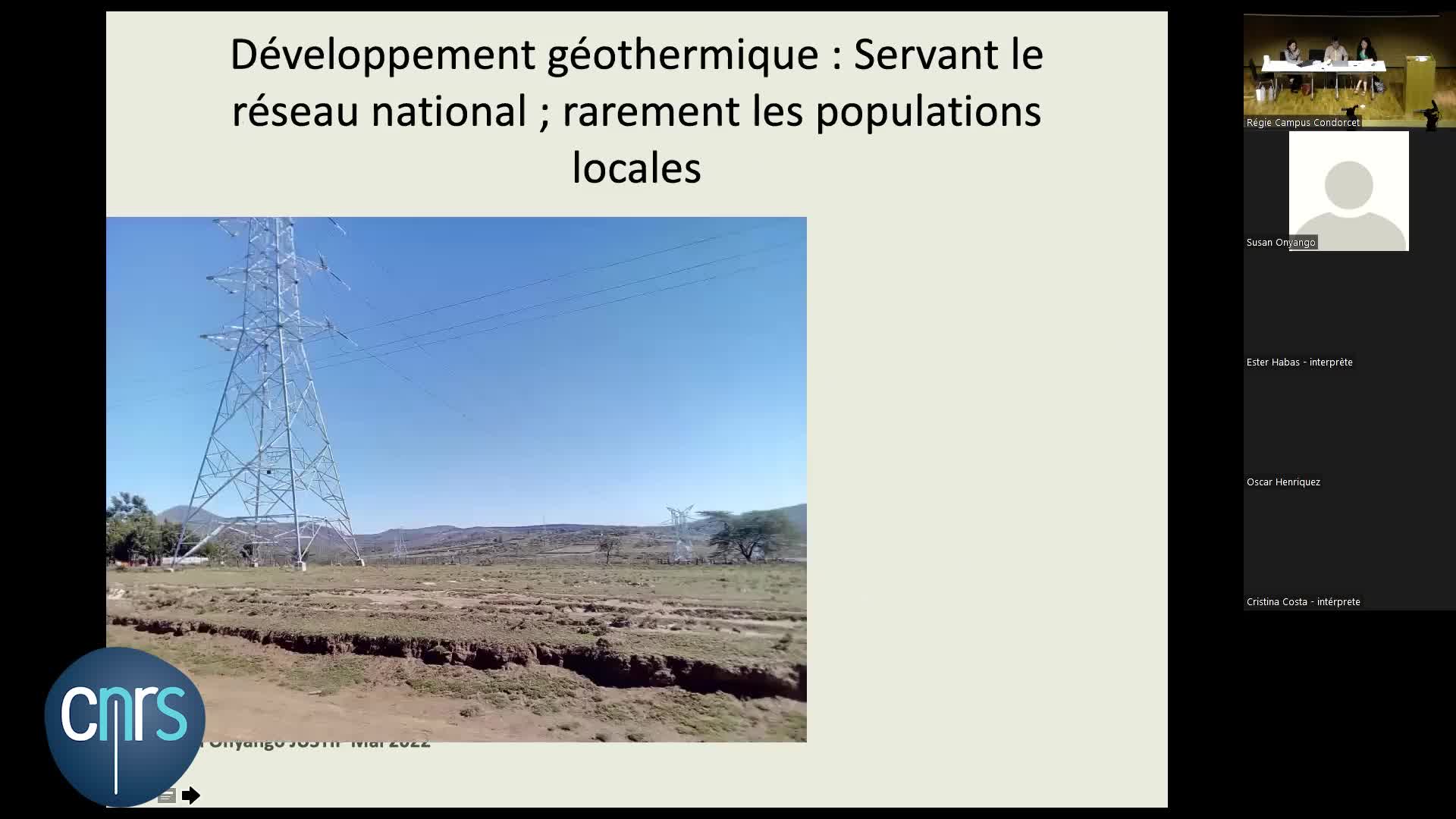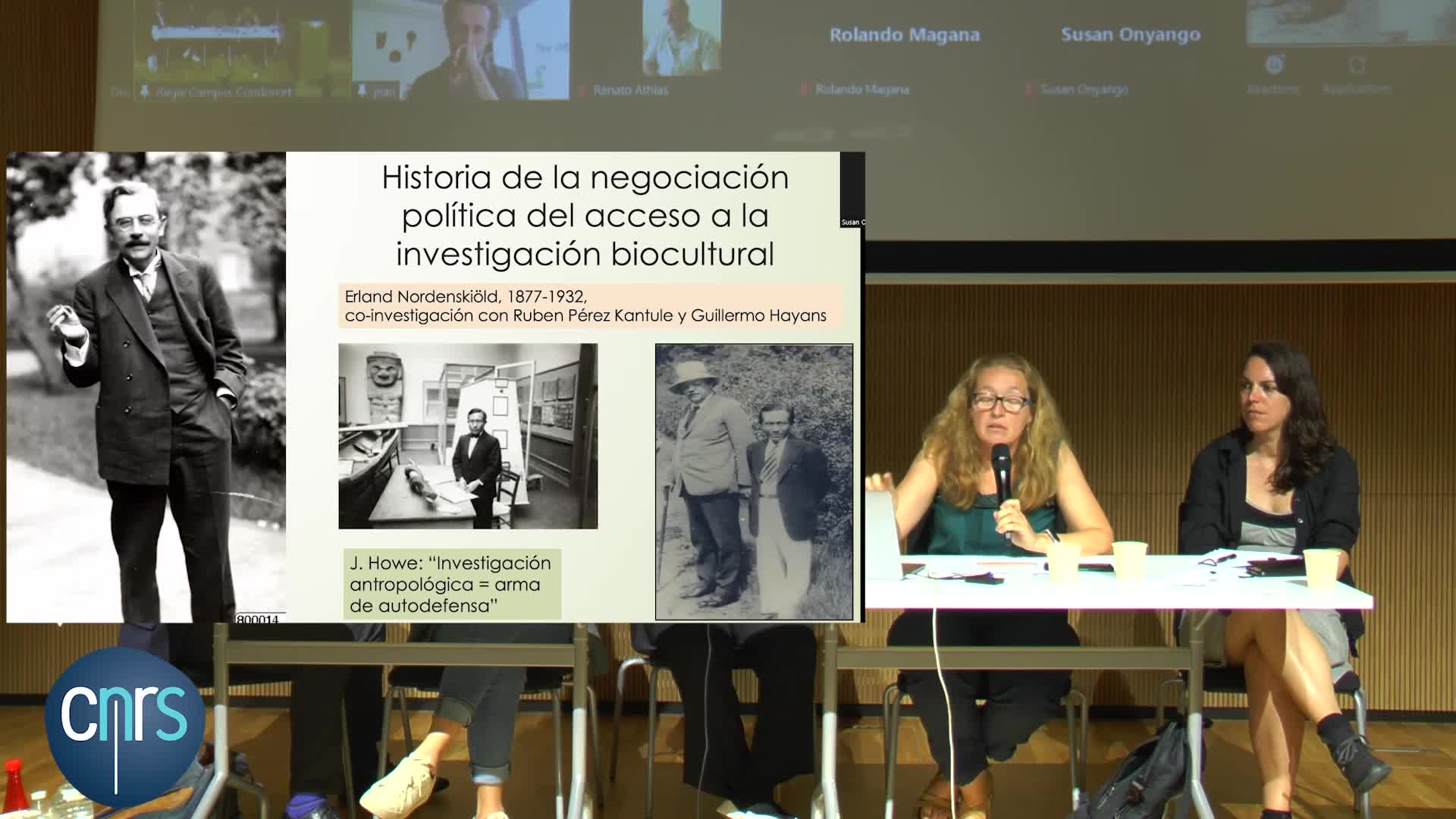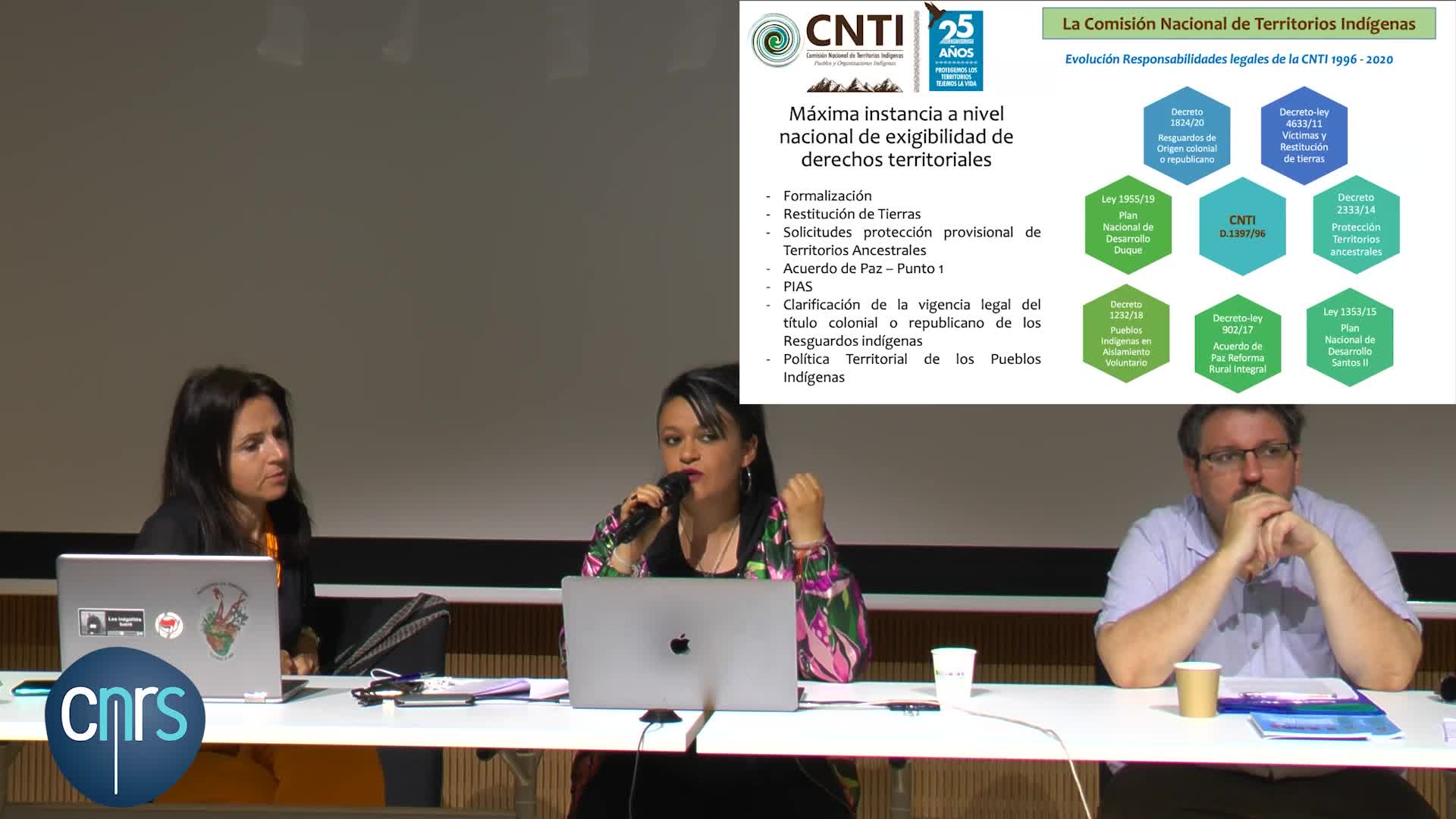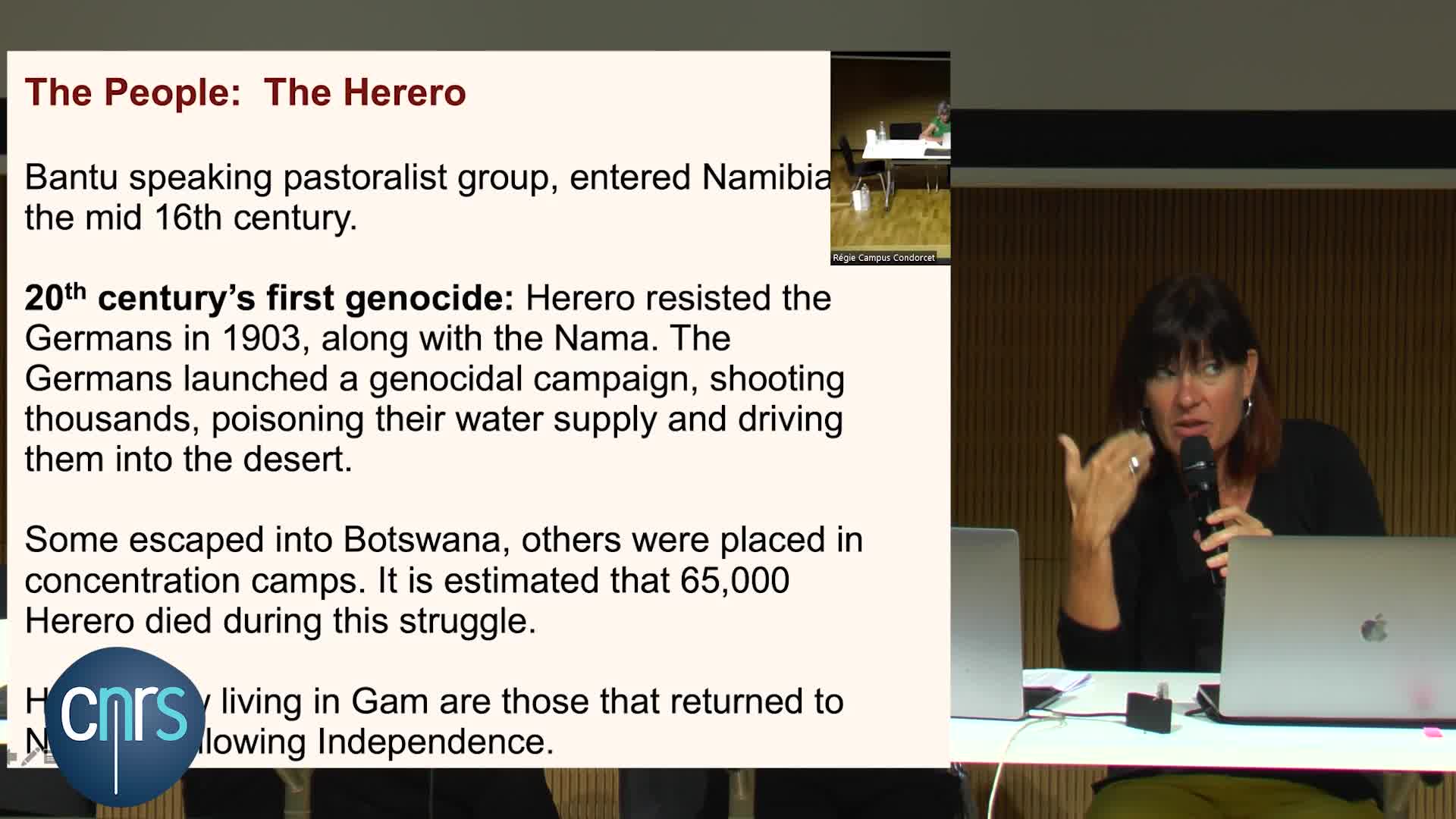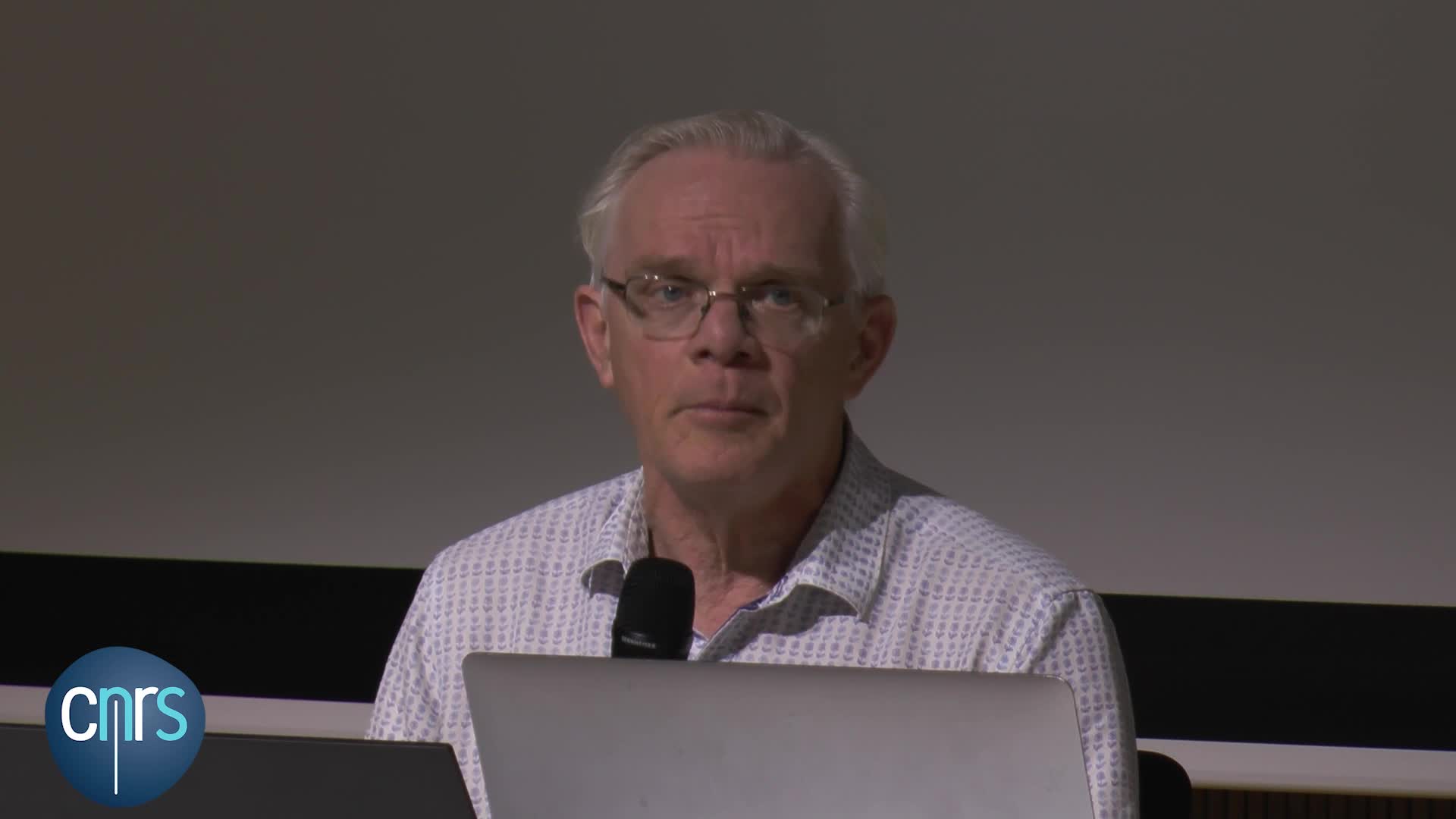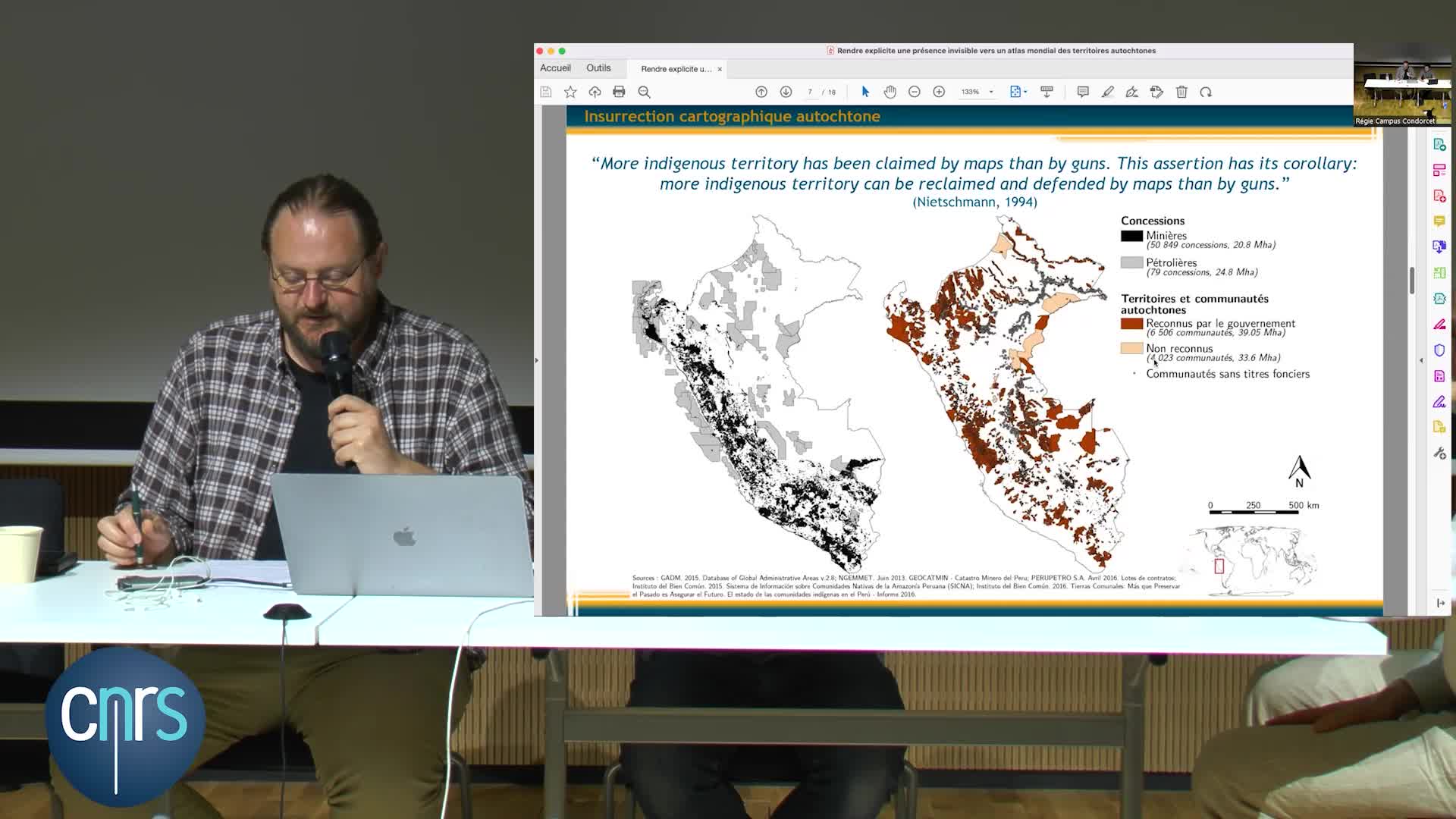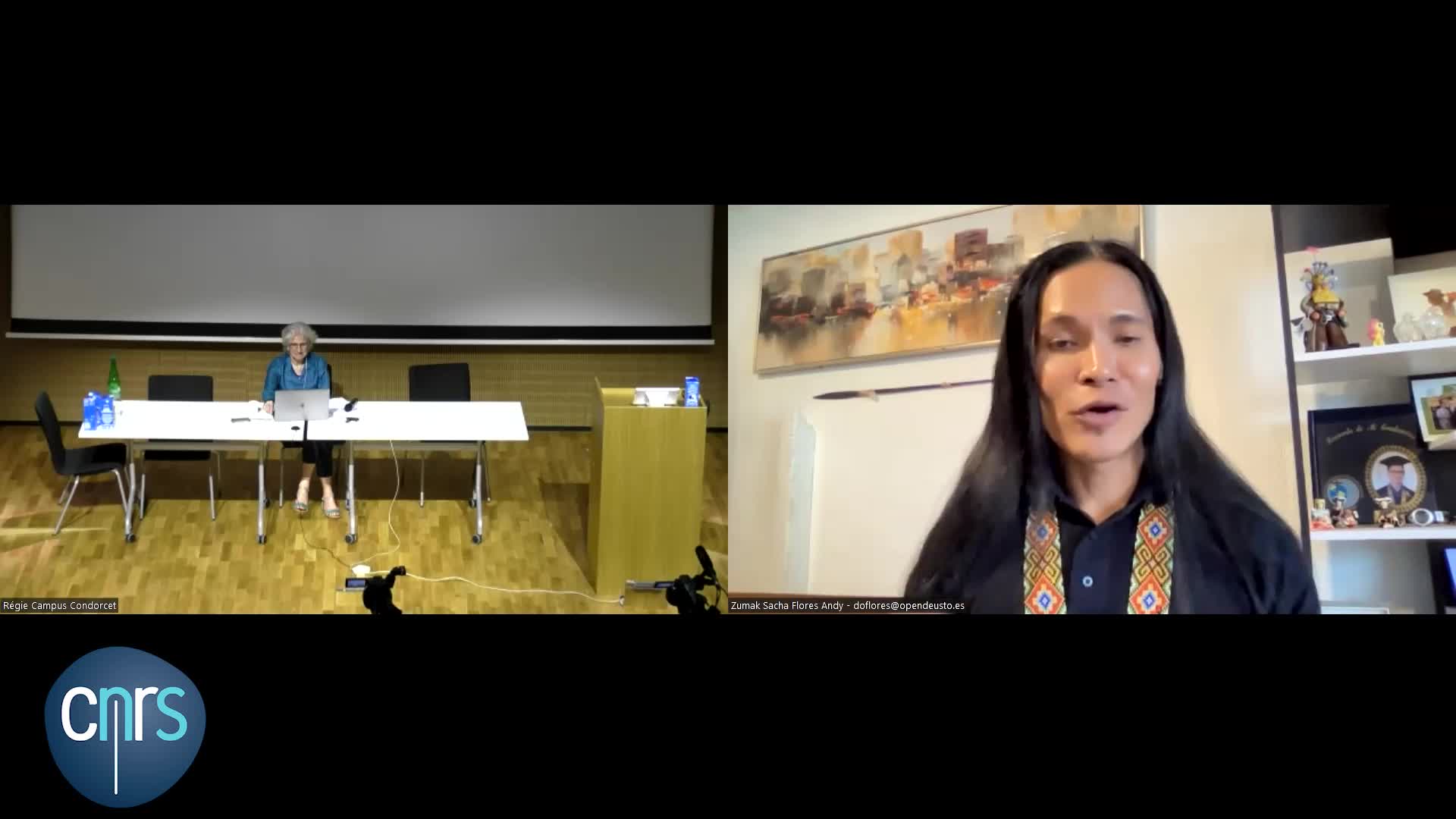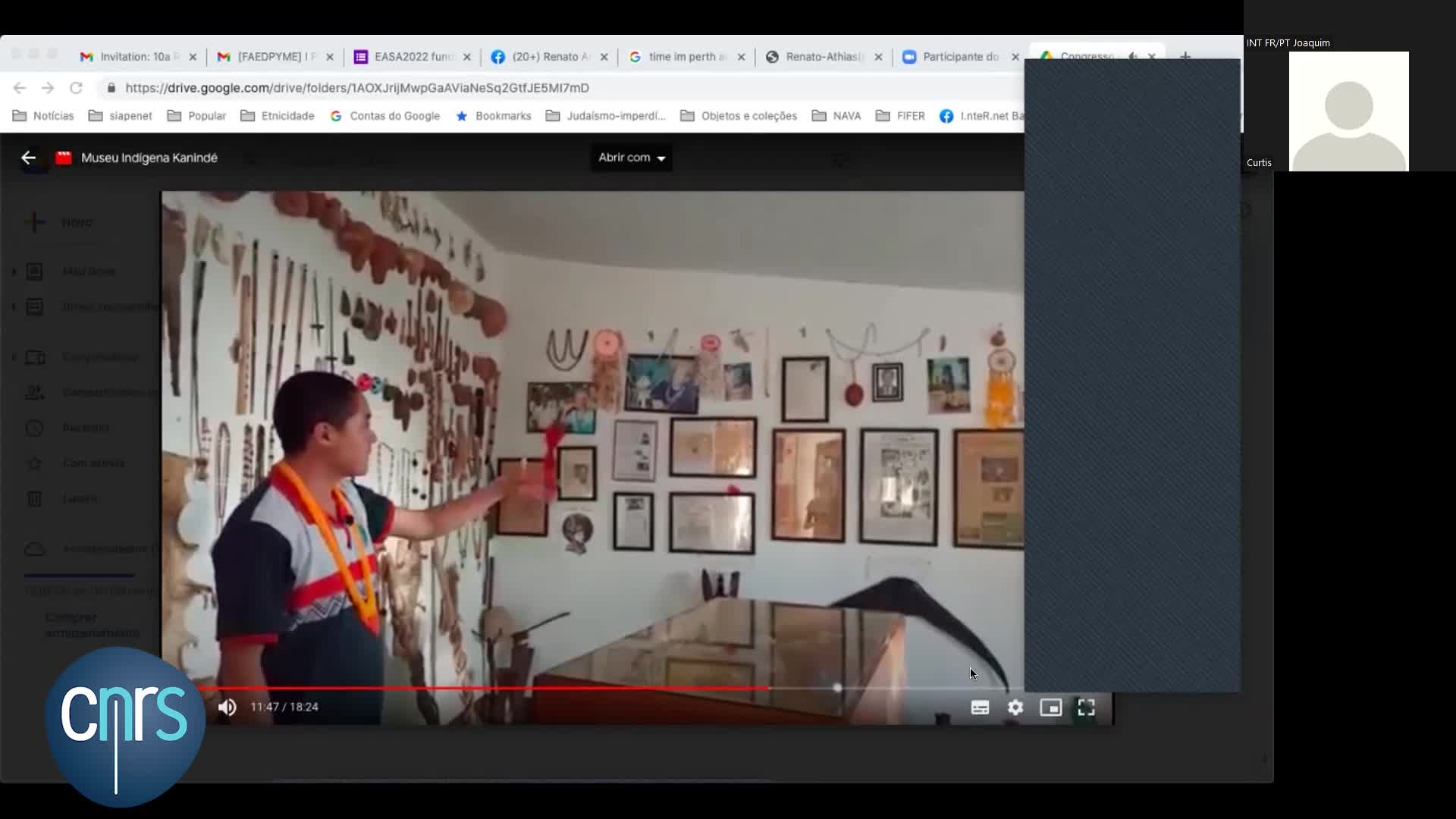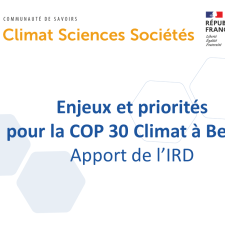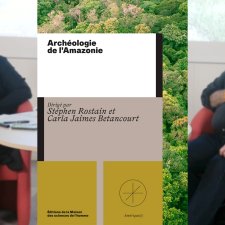Notice
Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Modération : Jennifer Hays
Sara Teteilbaum : Croisements entre CPLE et la norme de certification Forest Stewardship
Council : Une enquête de terrain
La présentation portera sur les interprétations du consentement préalable, libre et éclairé (CPLE)
dans le contexte des normes de certification proposées par le Forest Stewardship Council (FSC). Le
système FSC est l'un des premiers du secteur forestier à exiger des entreprises qu'elles mettent en
oeuvre le CPLE par le biais de pratiques de gestion forestière. La présentation examinera comment
ces normes forestières ont été développées dans trois pays différents (Canada, Russie, Suède) et les
interprétations du CPLE qui en découlent. La présentation présentera également des données
préliminaires concernant la mise en oeuvre du CPLE dans les processus de certification forestière au
Canada.
Camille Chabot-Martin et Martin Papillon : La participation des peuples autochtones à
l’évaluation d’impact au Canada : au-delà du consentement, une conception de l’autorité
décisionnelle
Si elle est aujourd’hui incontournable, la participation des peuples autochtones aux processus
d’évaluation des impacts concernant les projets extractifs sur leurs terres ancestrales continue à faire
débat au Canada comme ailleurs. Les principaux acteurs de ces processus (en particulier les décideurs
publics, les promoteurs des projets et les groupes autochtones) ne semblent pas s’entendre sur la
signification et la portée des normes en matière de participation autochtone, en particulier en ce qui
concerne la notion de consentement préalable, libre et éclairé (CPLE). À partir d’une analyse de
contenu des mémoires et des déclarations de ces intervenants dans le cadre des travaux
parlementaires menant à l’adoption de la nouvelle loi canadienne sur l’évaluation d’impact (2019),
cette recherche révèle trois conceptions principales de la place des autochtones dans les processus de
prise de décision de l’évaluation d’impact : procédurale, partenariale et fondée sur l’autodétermination. Notre
analyse permet de souligner d’importantes différences entre ces trois conceptions en ce qui concerne
les attentes face au modèle de participation et plus spécifiquement sur l’interprétation du CPLE. Ces
différences reposent en grande partie sur la façon dont ceux-ci conçoivent l’autorité décisionnelle en
matière de gouvernance territoriale au Canada.
Viviana Lopez Toro : Enjeux politiques du droit à la consultation et au consentement : usage
stratégique des mobilisations sociales dans la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSMColombie)
L'importance du droit à la consultation préalable (CP) est au coeur des répertoires de défense culturelle
et territoriale des peuples autochtones. Mais le droit au consentement préalable, libre et éclairé
(CPLE) rencontre des limites. Si les États doivent rechercher le consentement des peuples
autochtones, en pratique, il s'agit au mieux d'une consultation rehaussée et, dans le cas colombien,
fortement institutionnalisée. La question demeure de savoir si la CP est efficace lorsqu'il s'agit de
défendre les droits des peuples ou si elle n'est qu'une étape supplémentaire dans la bureaucratie
étatique. Considérer la consultation comme seul objet de cette question peut faire perdre de vue les
dynamiques qui sous-tendent les enjeux politiques des acteurs. Deux exemples de stratégies mise en
place à la SNSM, par les peuples Arhuacos, Kankuamos, Koguis et Wiwas montreront les
intersections entre lesdits droits et diverses mobilisations politiques.
Dans la même collection
-
Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
-
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
-
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
-
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
-
Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux
Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux
-
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
-
-
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
-
-
Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone
Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone
-
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
-
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections
Sur le même thème
-
Enjeux et priorités pour la COP 30 Climat à Belem : apport de l'IRD - Cosavez-vous ? Climat Science…
La COSAV Climat Sciences Société organise ce séminaire pour explorer les enjeux cruciaux de la prochaine COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, ainsi que les contributions des recherches
-
Soirée de présentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie"
RostainStéphenLachowskyCarolinePrésentation de l'ouvrage "Archéologie de l'Amazonie", avec Stéphen Rostain et présenté par Caroline Lachowsky
-
Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
-
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
-
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
-
-
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
-
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
-
-
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
-
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
-
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections