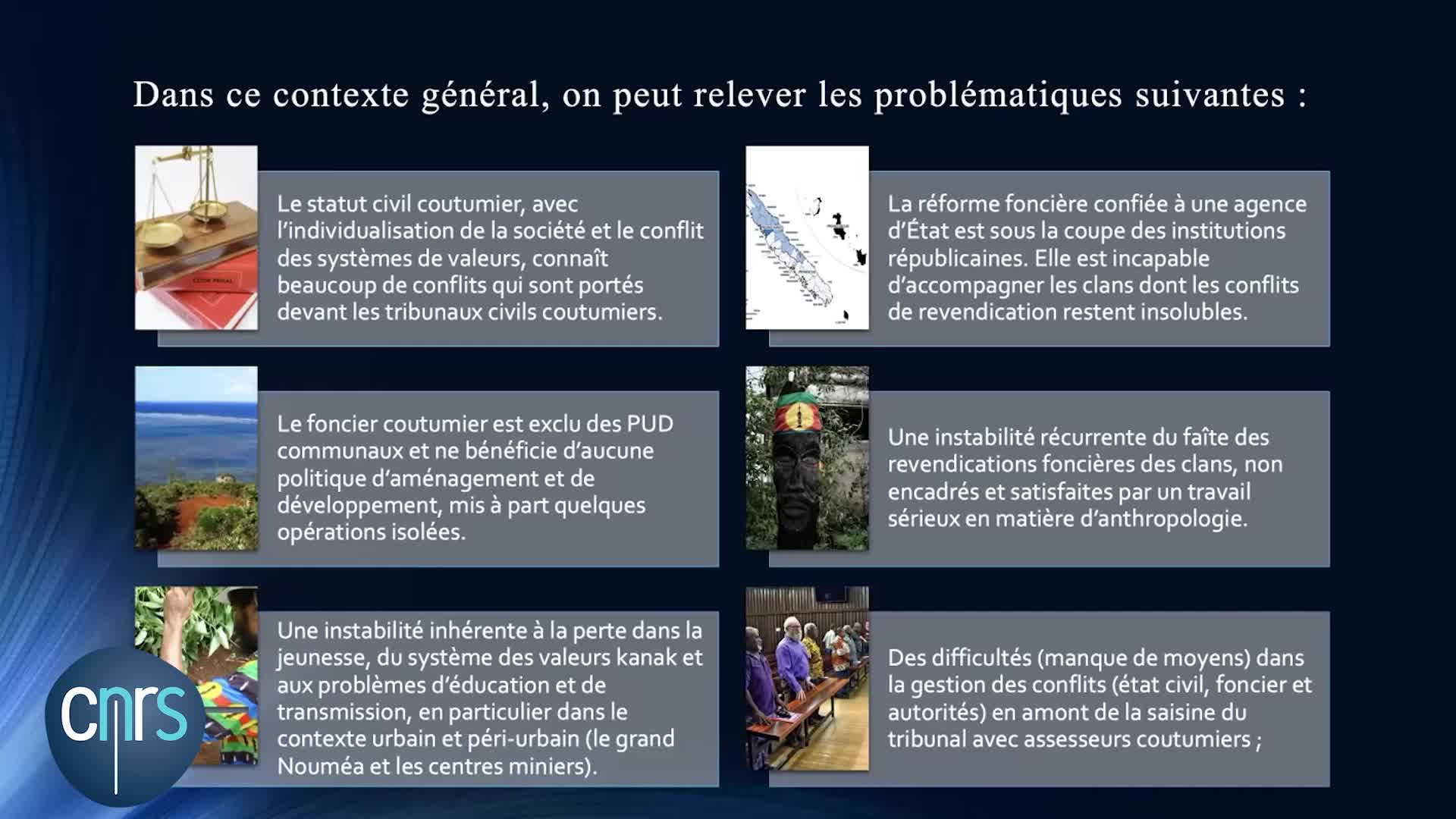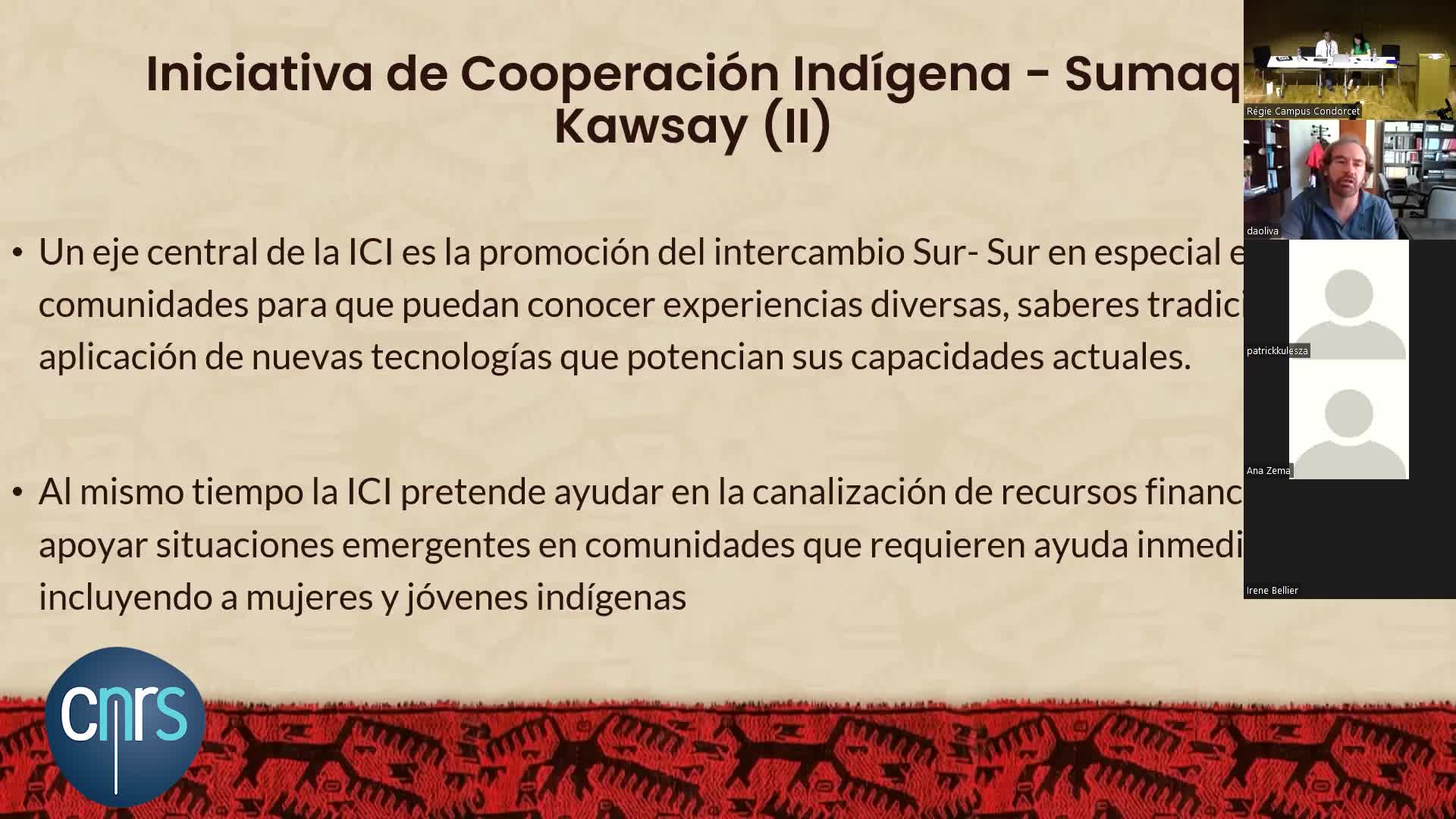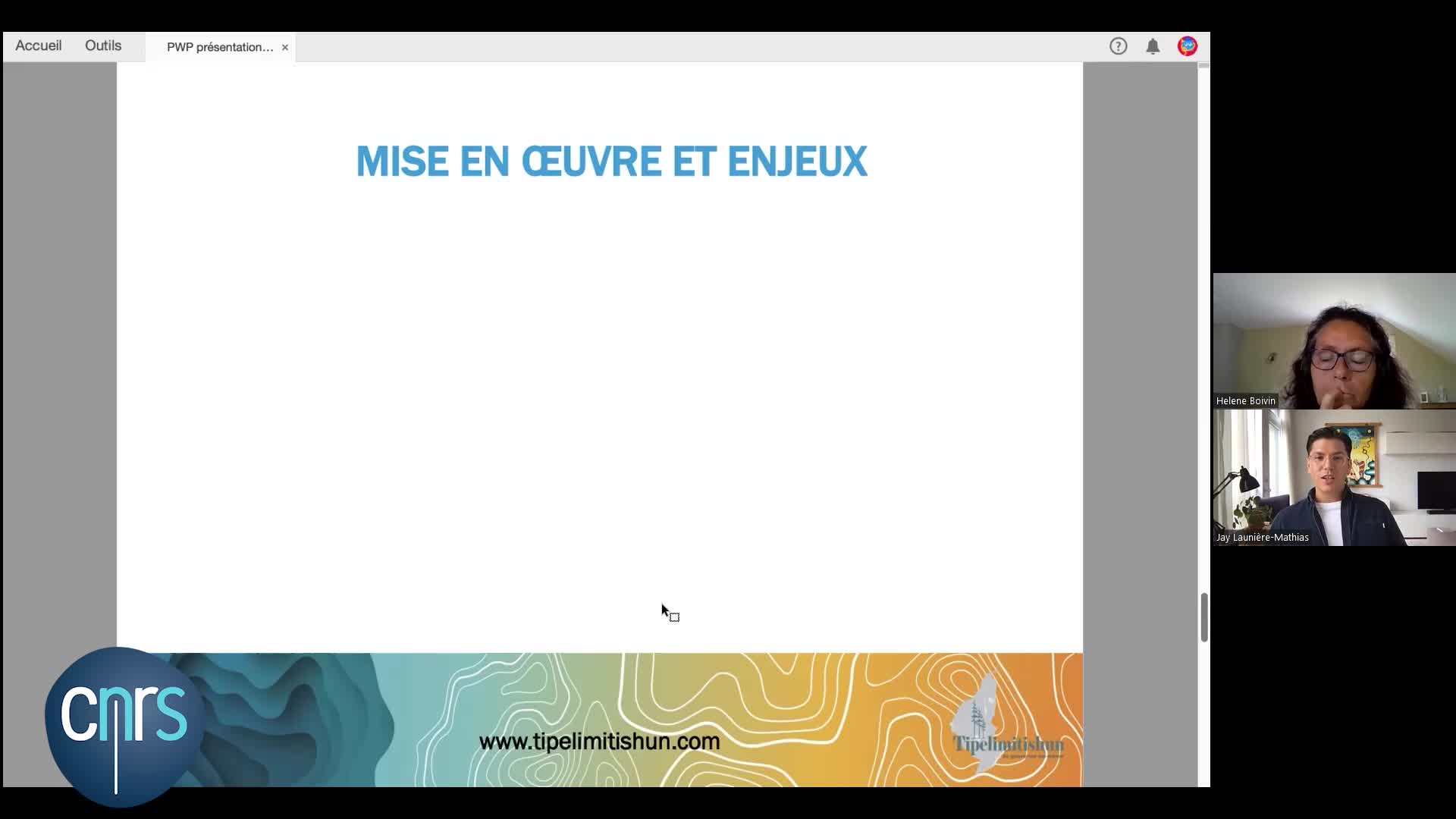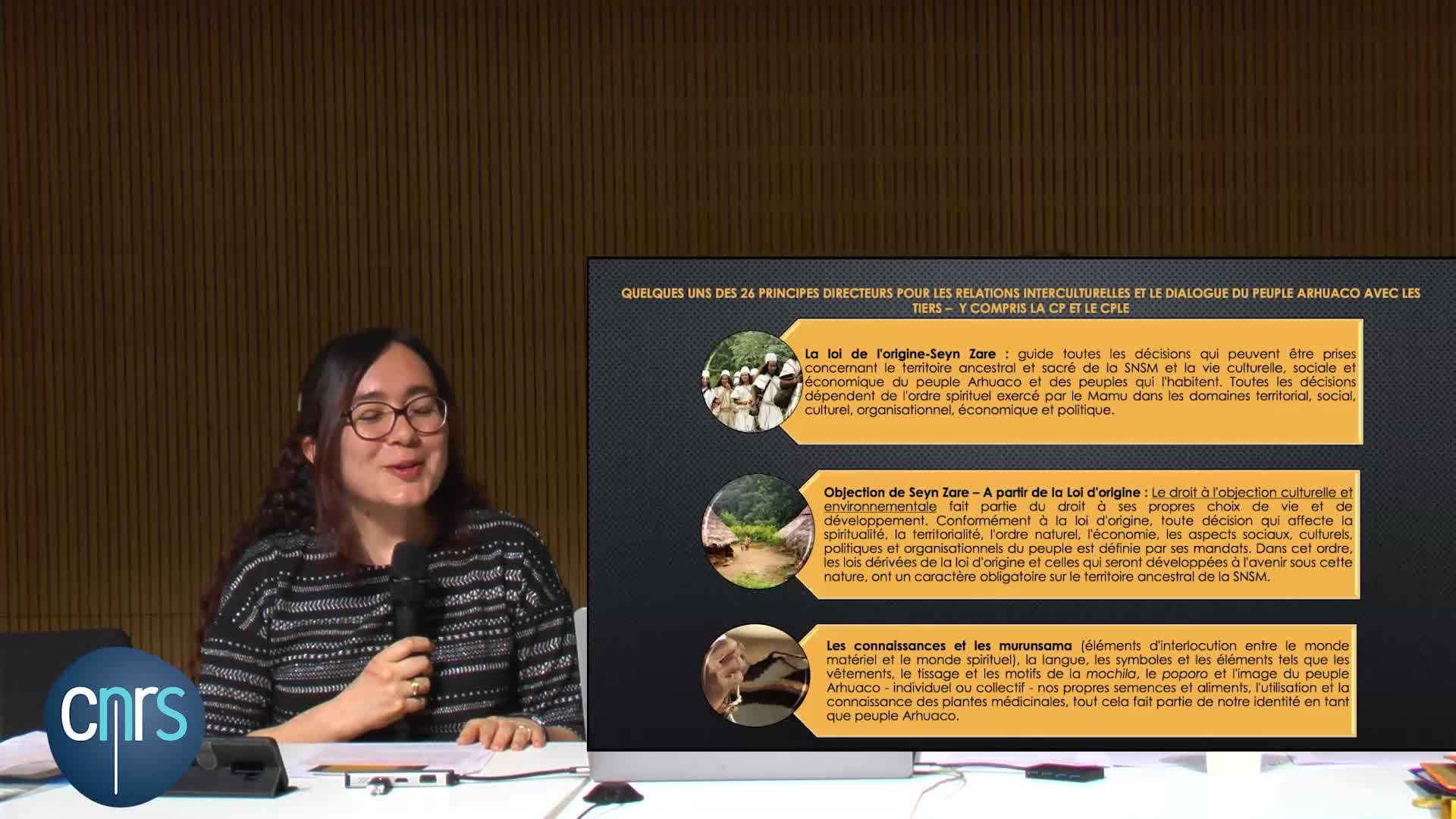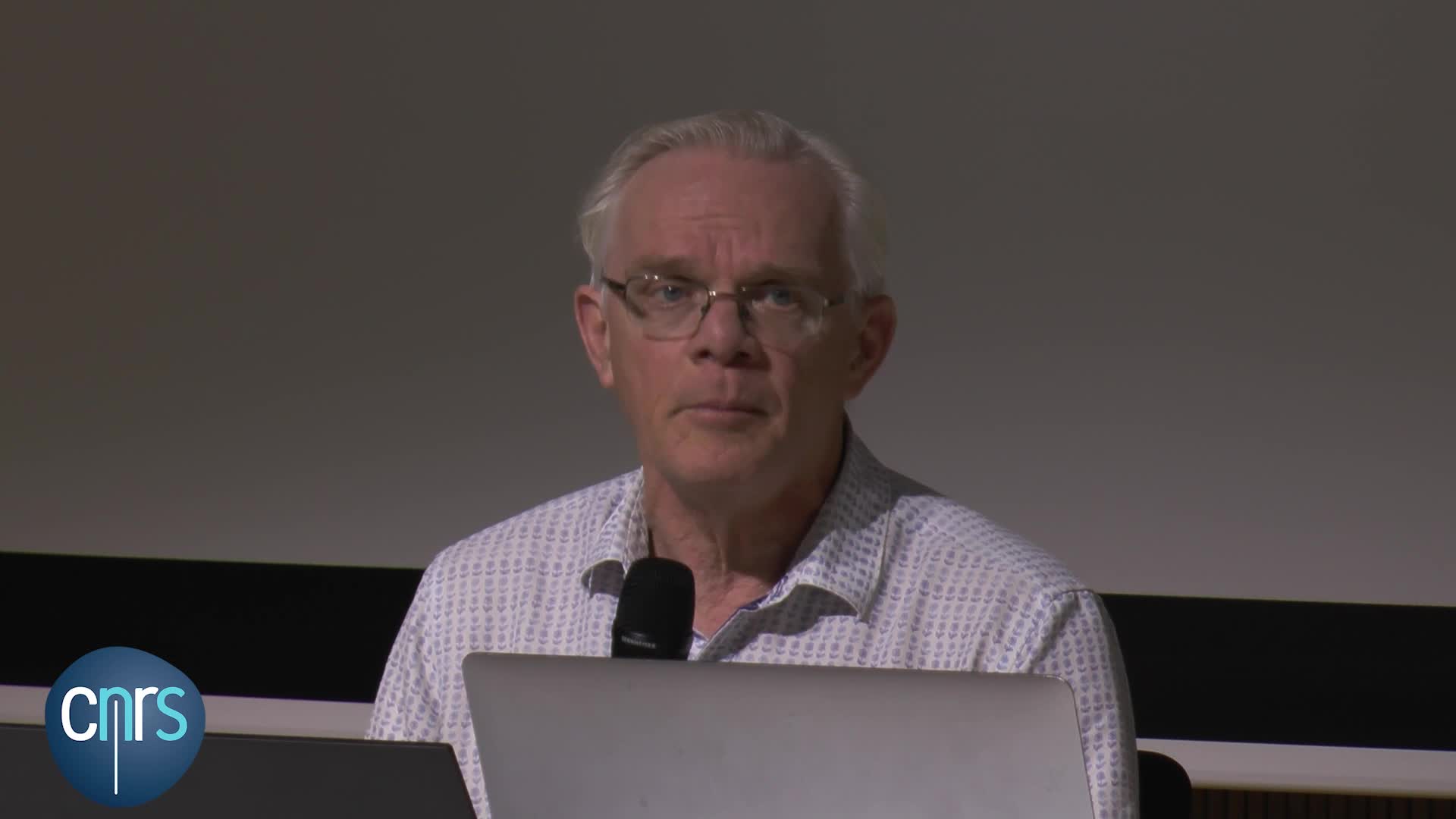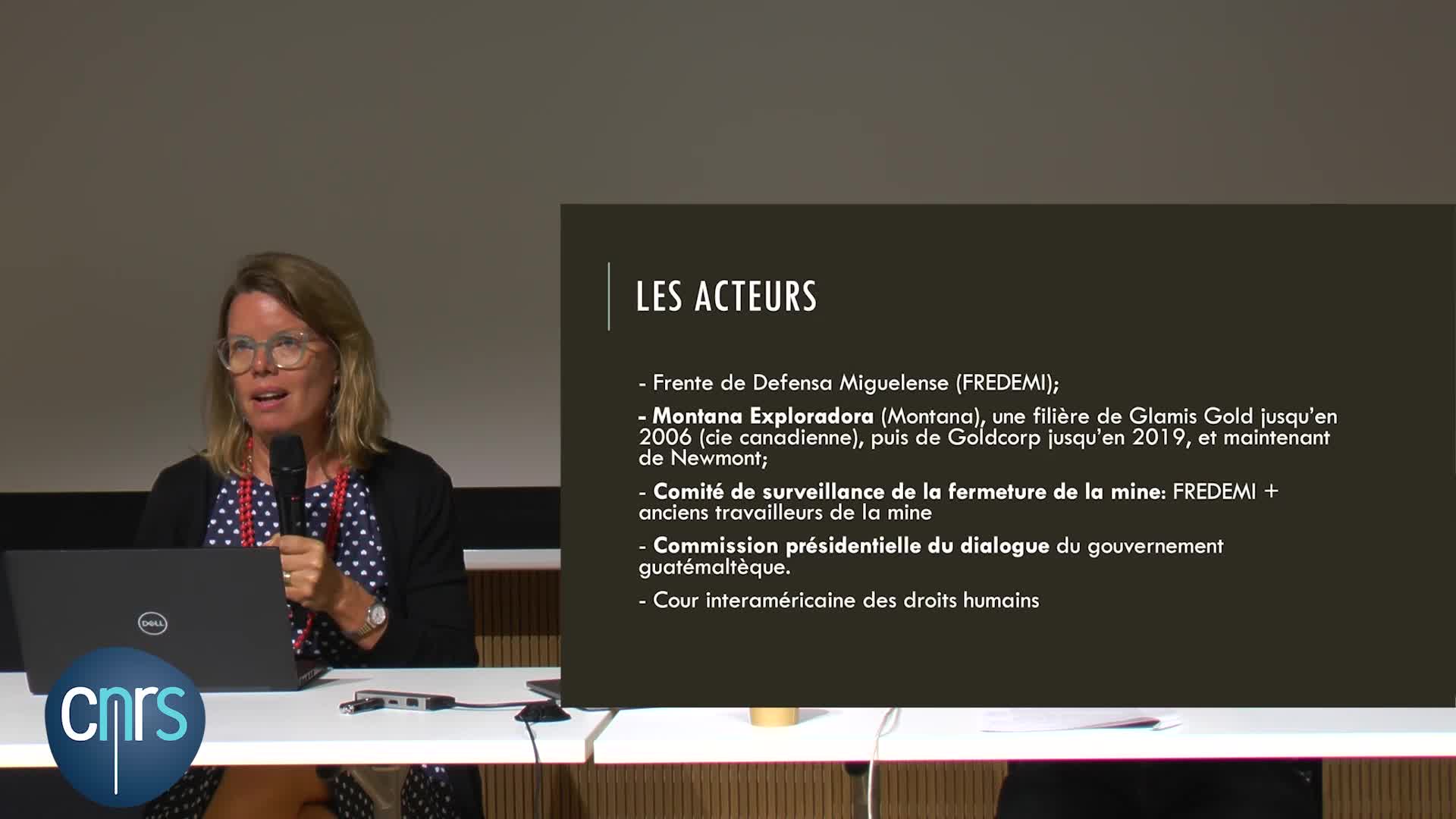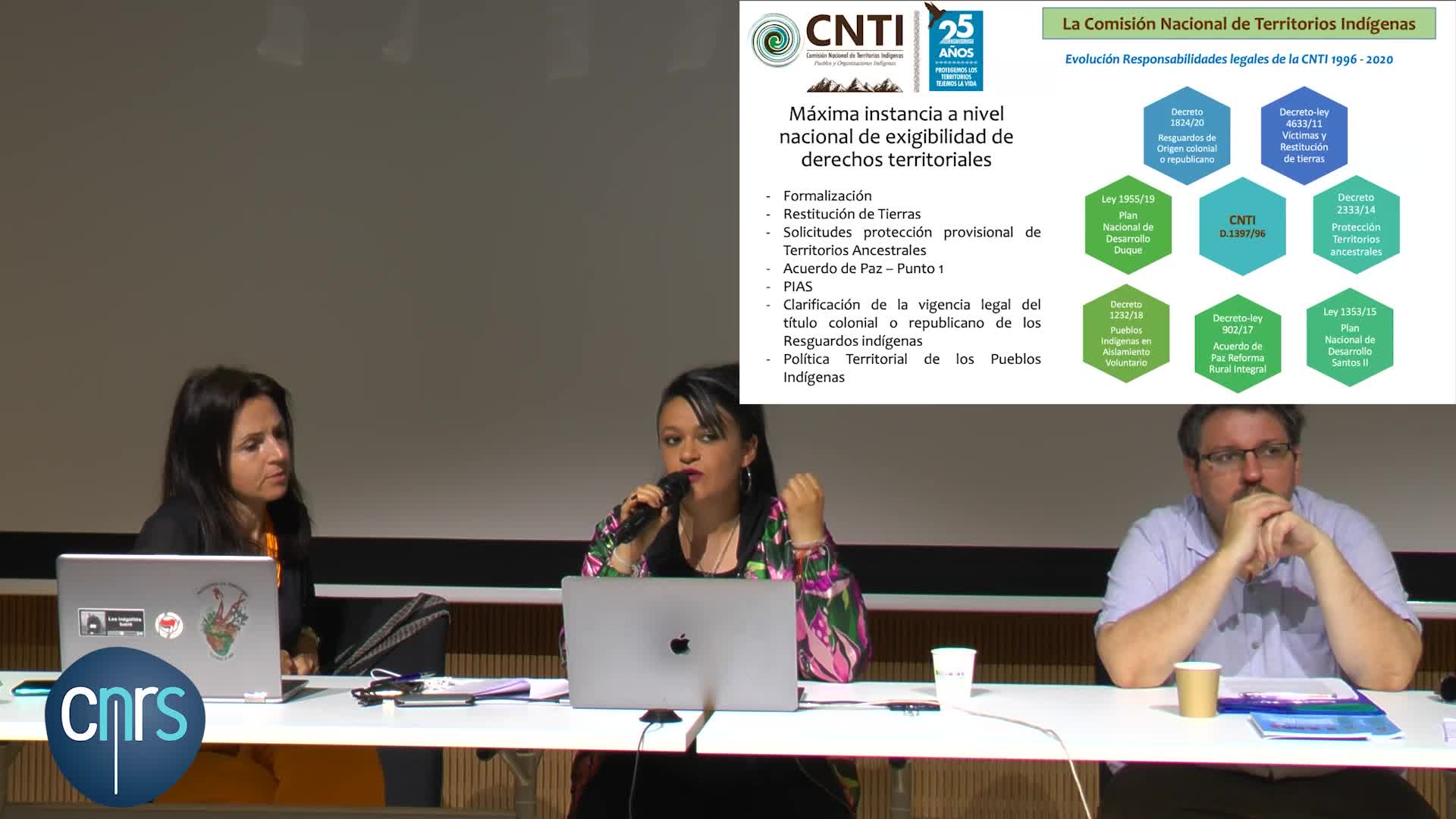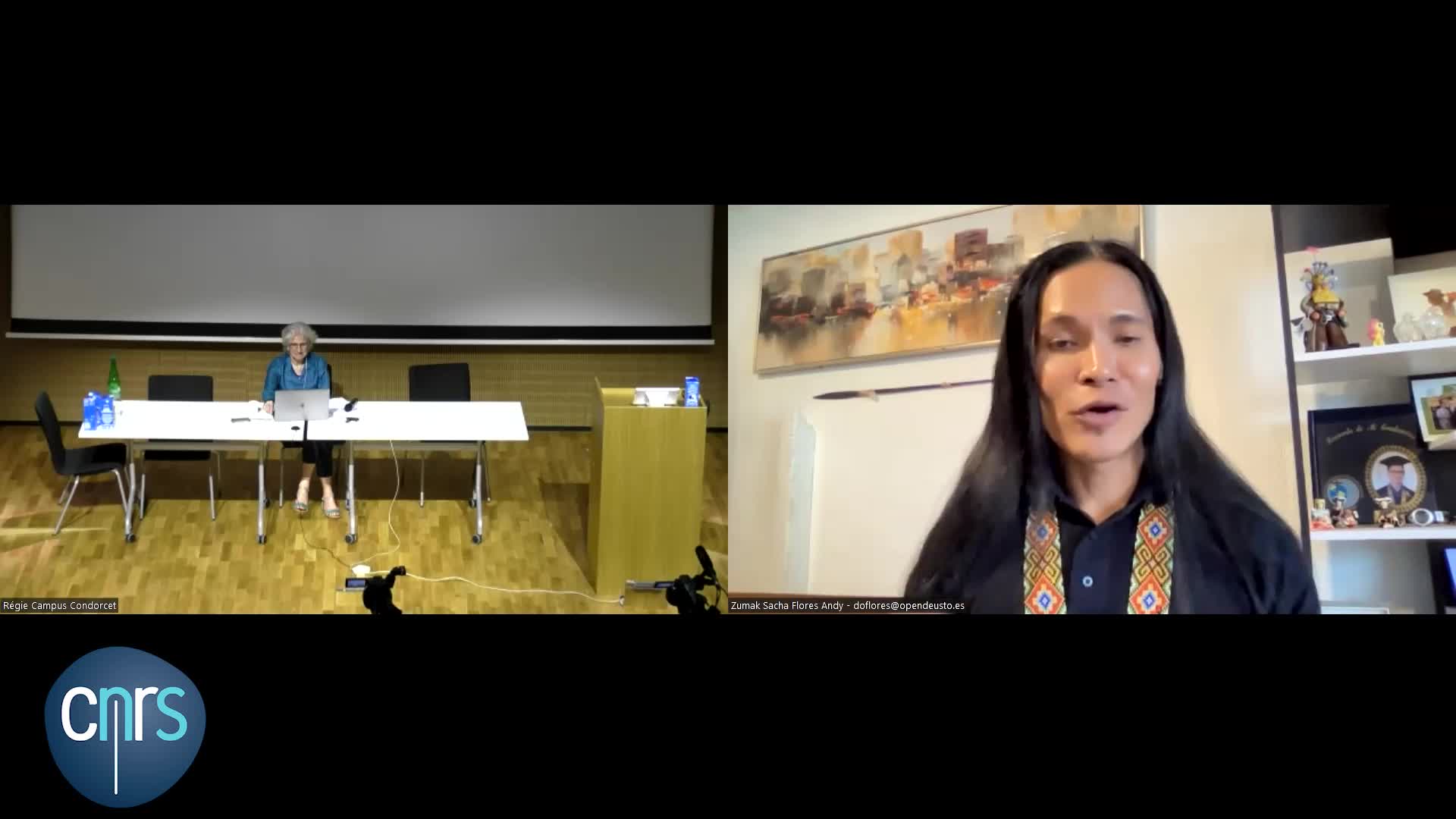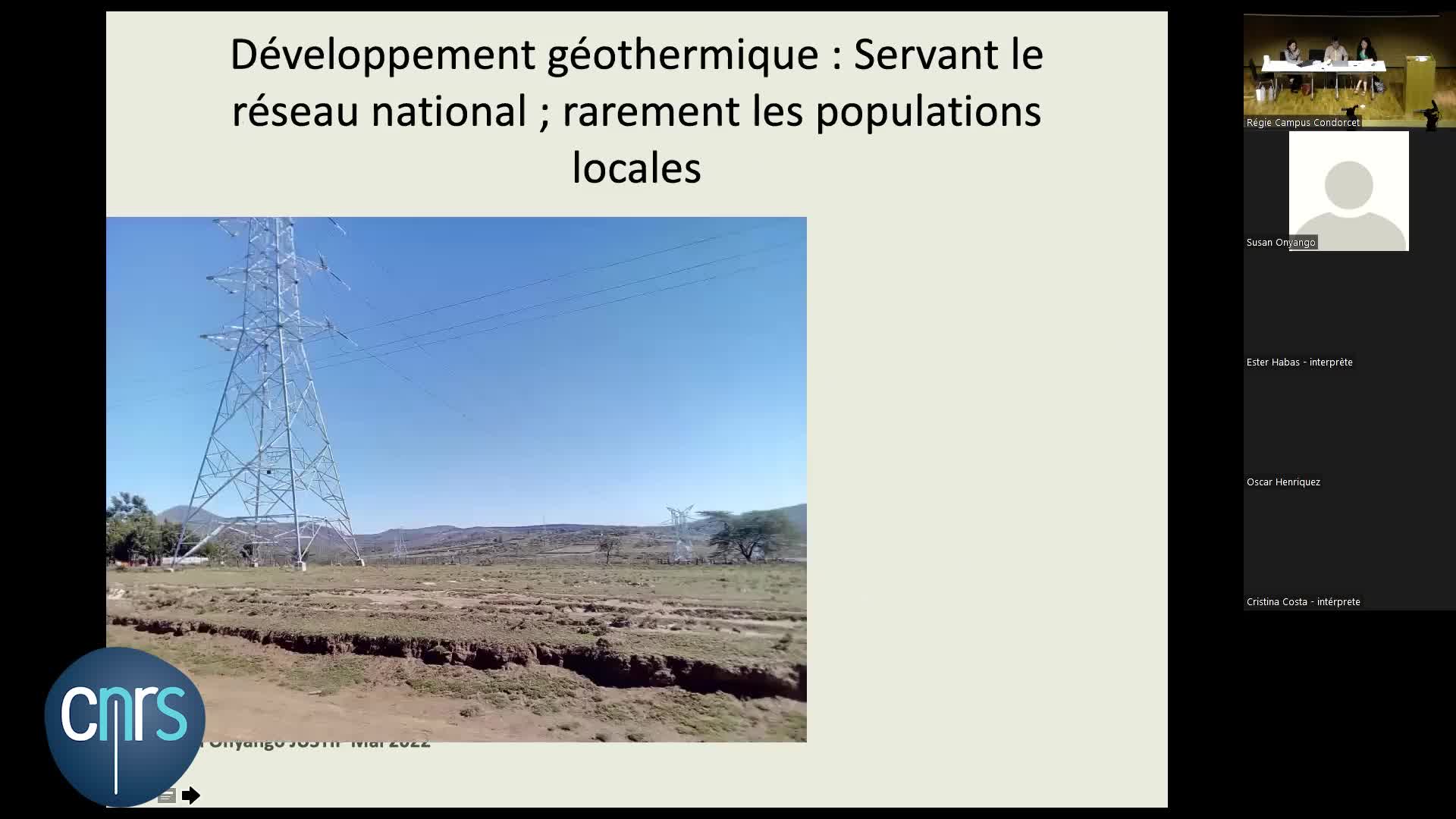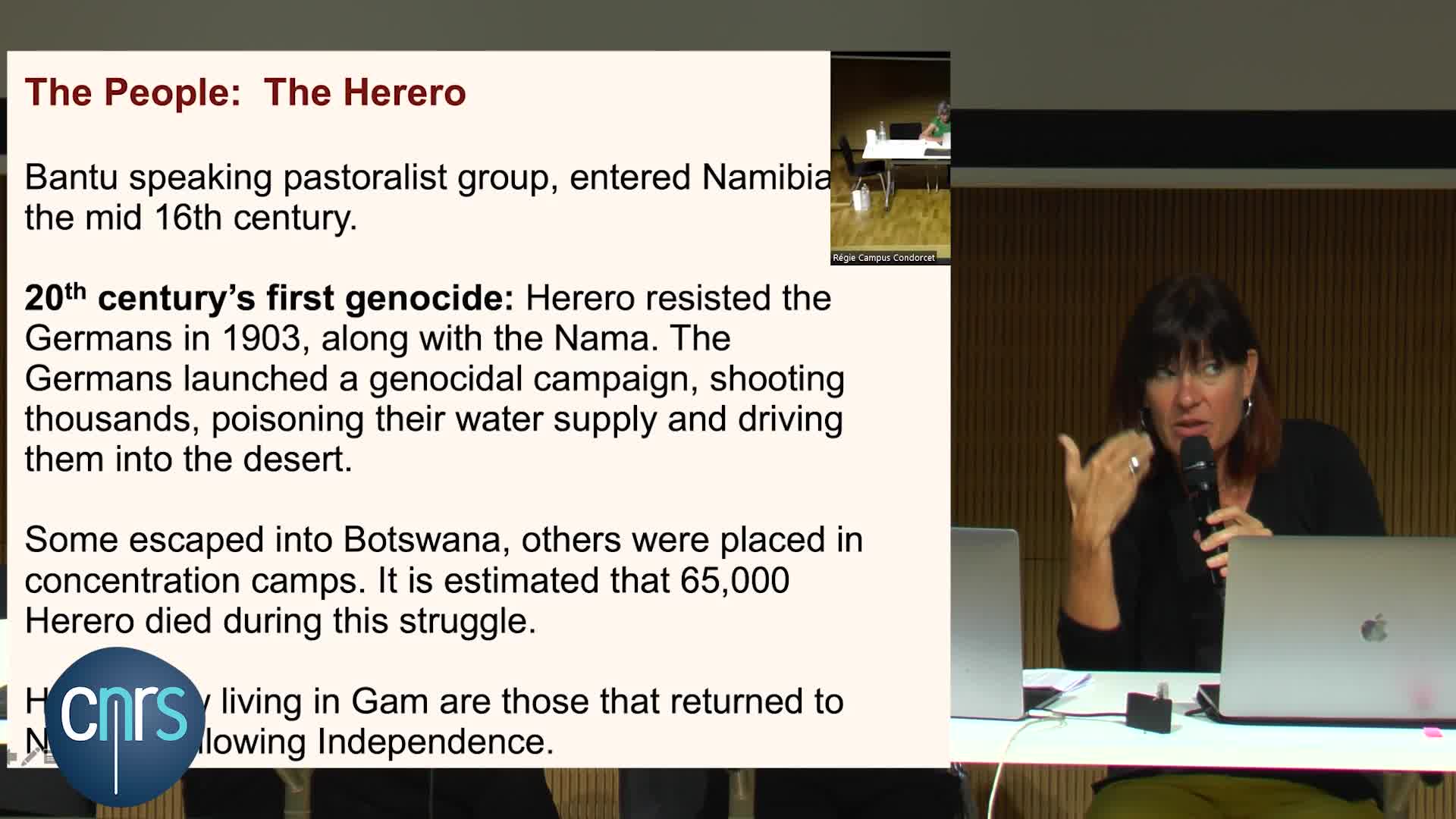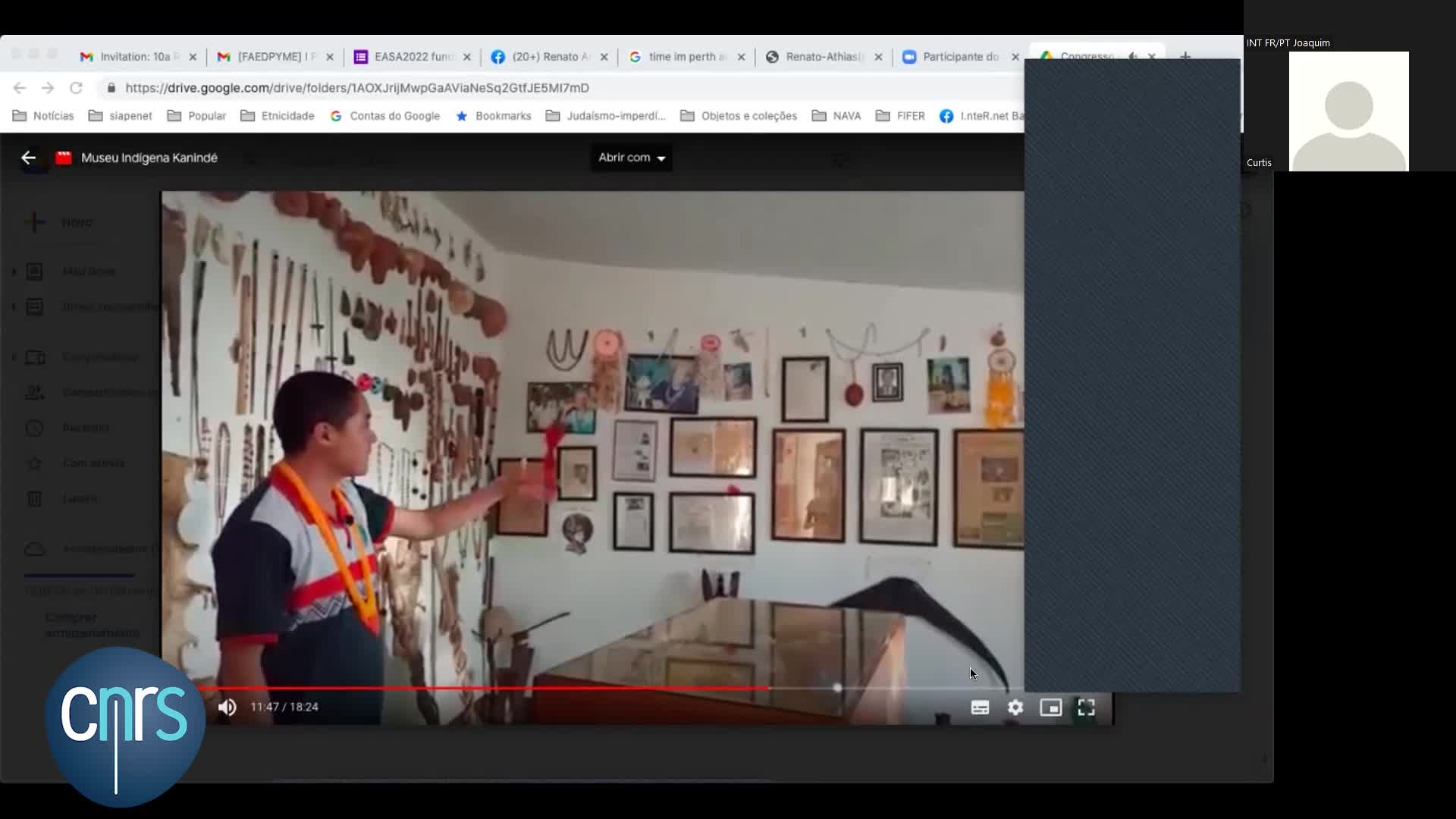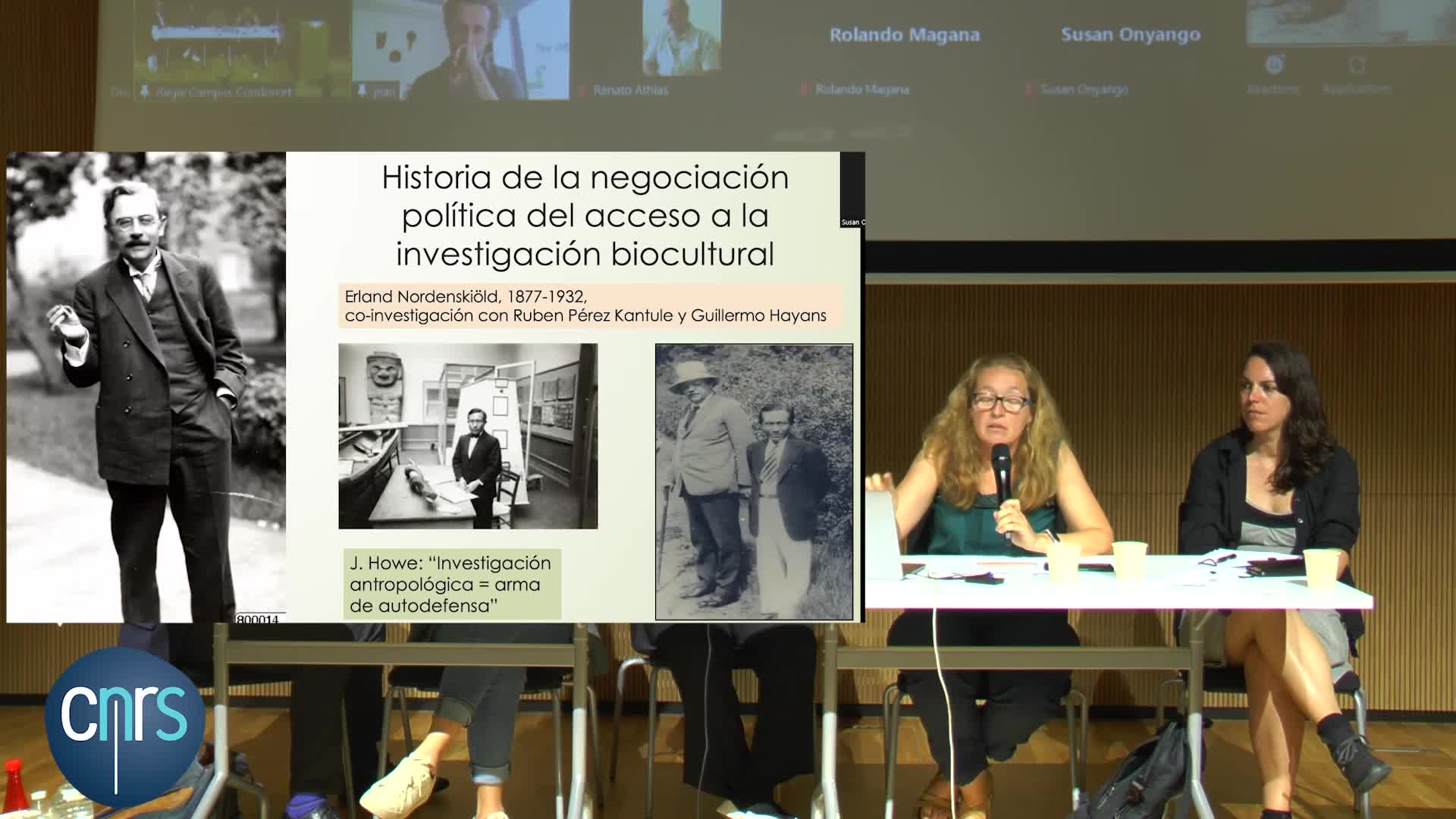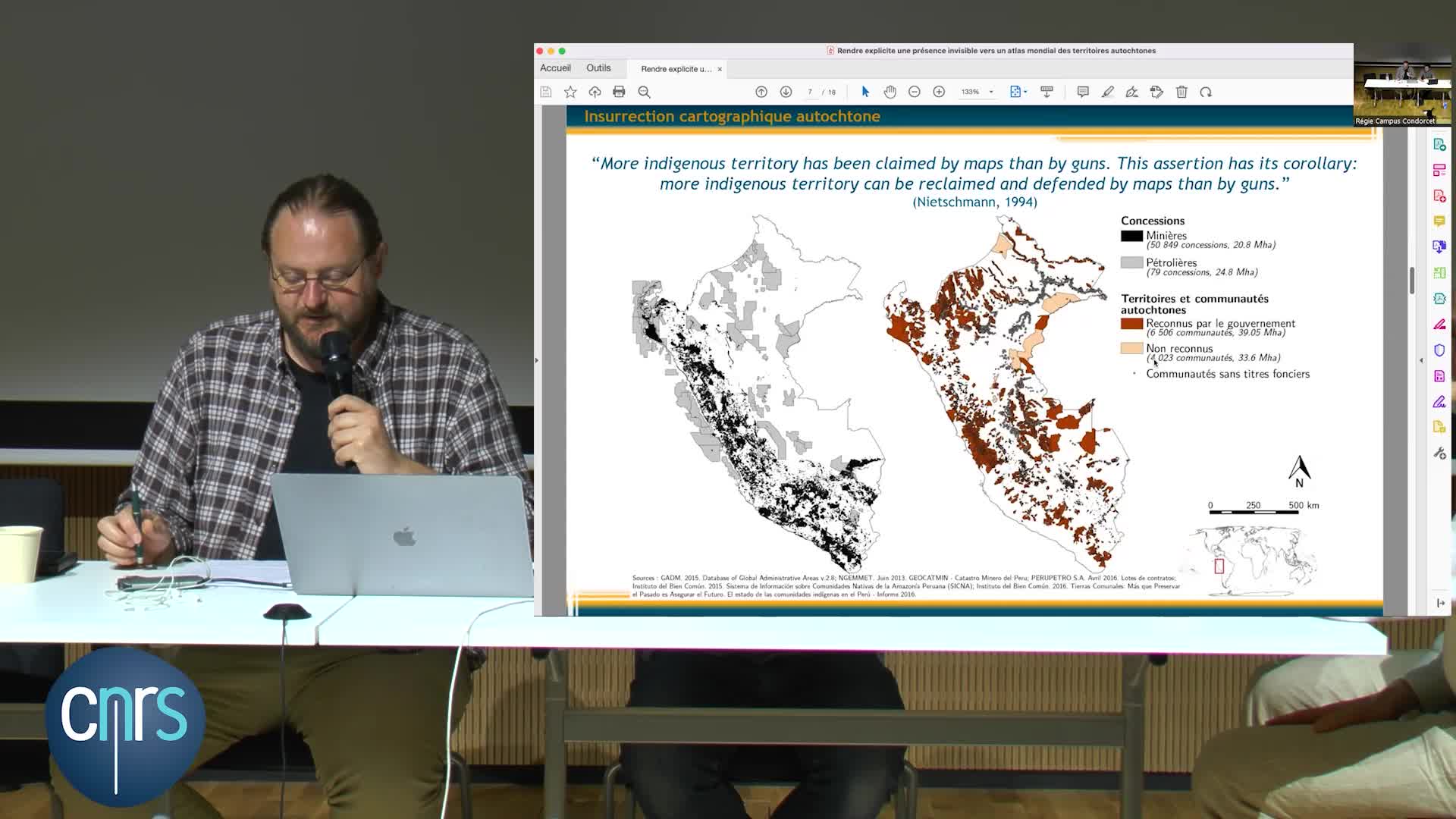JUSTIP- Justice et Droits des Peuples Autochtones
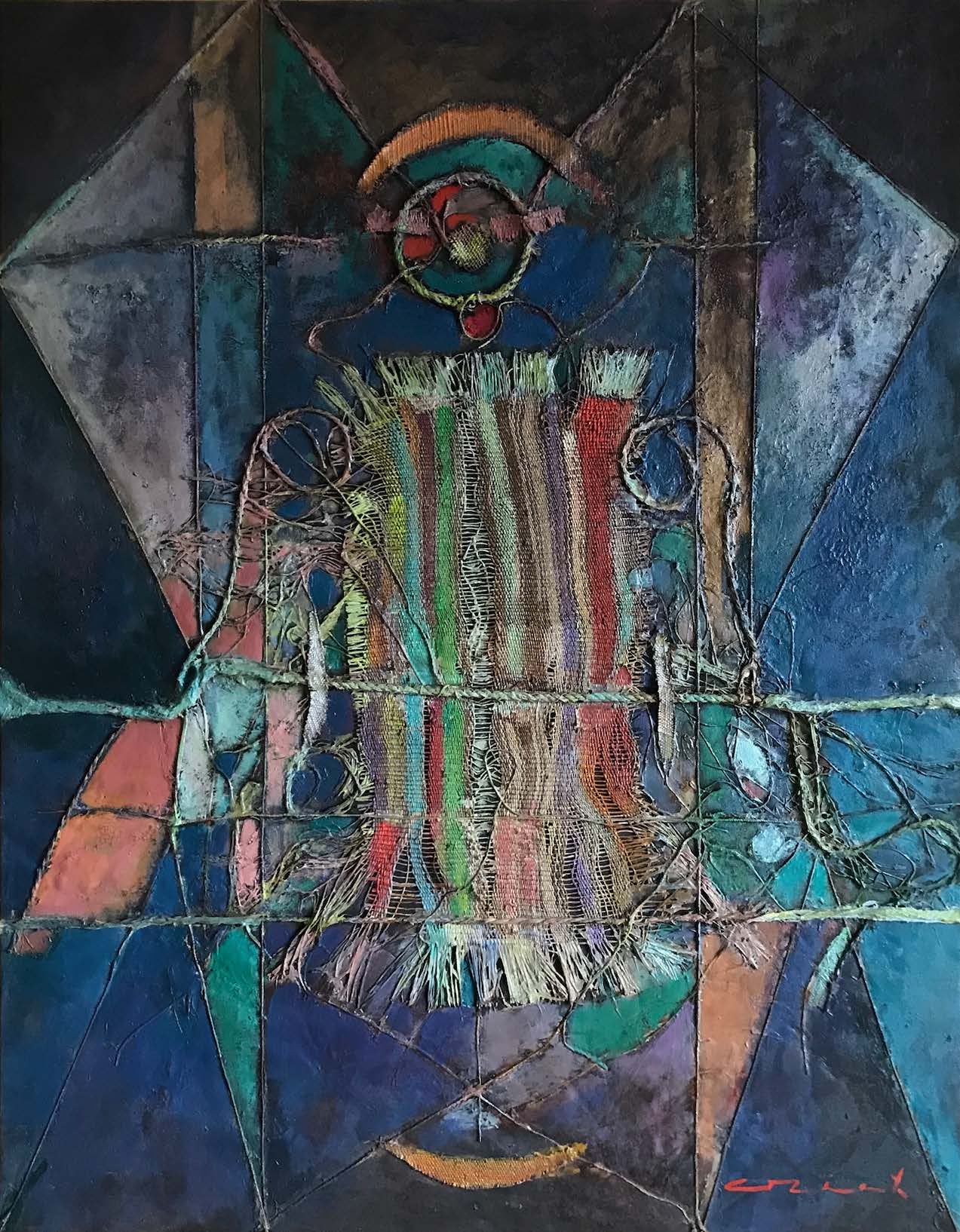
Descriptif
Rencontre du Réseau thématique international JUSTIP, du 16 au 20 mai 2022, Paris - Campus Condorcet
Justice and Indigenous Peoples Rights / Justice et droits des peuples autochtones, est un réseau soutenu par le CNRS. Irène Bellier, directrice de recherches au CNRS et membre du LAIOS/LAP, en assume la coordination scientifique et le portage en partenariat avec l’EHESS. JUSTIP s’appuie sur un partenariat avec le Canada (Réseau DIALOG, Chaire du pluralisme juridique de l’Université d’Ottawa), l’Espagne (Centre Pedro Arrupe des droits humains, Université Deusto, à Bilbao), la Norvège (Université arctique de Tromso et Center for Sami Studies). Ses activités impliquent des échanges réguliers avec les membres de ces institutions et une cinquantaine de chercheur.es et enseignant.es, engagé.es dans les études autochtones en Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Mexique. Elles se déploient en direction des recherches innovantes permettant de comprendre les évolutions que l’on observe dans les rapports entre les peuples autochtones et les États dans lesquels ils se situent.
JUSTIP engage des recherches dans 4 domaines :
1° institution du droit et institutions autochtones ; 2° mobilisations autochtones, demandes de droits ; 3° justice environnementale, climatique, cartographique ; 4° les autochtones dans la ville, l’université, les institutions culturelles.
Le présent colloque restitue les avancées de ces recherches qui impliquent les chercheur.e.s autochtones et non-autochtones dans un même dialogue.
Axe 1
L'INSTITUTION DU DROIT ET LES ORGANISATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Coordonné par Irene Bellier (CNRS-Paris) et Ghislain Otis (Université d'Ottawa, Canada)
L'objectif de cet axe de recherche était d'étudier les cadres institutionnels émergents pour
l'interaction entre les systèmes occidentaux dominants de droit et de justice et les systèmes
autochtones de droit et de justice, en ce qui concerne l'autonomie gouvernementale et l'élaboration
des lois dans les domaines intéressant les peuples autochtones. Cela concerne leur représentation
dans le champ politique, l'adéquation des structures socio-économiques et politiques, la police, la
vie familiale, les usages de l'eau, les questions foncières, etc.
Il s'est agi de saisir les défis qui consistent à faire fonctionner le pluralisme juridique au sein de (ou
avec) l'État en tant qu'arrangement efficace et légitime. Des évolutions concernent aussi des
domaines qui n'appartiennent pas strictement à l'institution de la justice comme, par exemple, les
questions de communication linguistique et d'écriture des coutumes orales. De nouveaux processus
d'institutionnalisation ont lieu à la suite d'initiatives étatiques ou en réponse à des demandes
autochtones au niveau international ou national. Quelles sont les sources et les manifestations de
ces institutions ? Quels sont les mécanismes de participation des autochtones aux processus de
délibération et de prise de décision ?
Le réseau Justip vise à observer quand et comment s'opère un changement dans le traitement
politique et juridique des peuples autochtones et ce qui change dans le fonctionnement des
institutions.
Axe 2
MOBILISATIONS AUTOCHTONES POUR LA JUSTICE
Coordonné par Jennifer Hays, Else Grete Broderstad (Université de Tromsø, Norvège) et Martin
Papillon (Université de Montréal, Canada, DIALOG).
L'objectif de cet axe était d'examiner comment les peuples autochtones se mobilisent pour obtenir
justice. Plusieurs dimensions sont à considérer. La première concerne les conditions, les contraintes
et les opportunités de l'activisme autochtone dans différents contextes. Quelles formes prend
l'activisme autochtone pour obtenir la justice ? Dans quelles circonstances les voies légales ou
institutionnelles sont-elles privilégiées ? Qu'est-ce qui explique les formes de résistance ? Nous
souhaitions nous concentrer sur les "conditions d'acceptabilité" de l'activisme autochtone et sur la
criminalisation des activistes en tant que stratégie de l'État pour diluer la résistance, ce qui établit
les questions de justice dans une perspective très différente.
La criminalisation de l'activisme autochtone a des répercussions sur la capacité de ces derniers à
obtenir justice dans le contexte d'extraction des ressources de la terre. Quelles sont les stratégies
possibles ? Des processus de collaboration et de négociation parviennent-ils à redéfinir les relations
entre les communautés autochtones, les gouvernements nationaux et les intérêts privés en ce qui
concerne, entre autres, la terre, les ressources, la sécurité alimentaire et l'éducation ?
Le rôle des sociétés multinationales et des industries extractives dans ces processus est au coeur de
ce thème. Quelle influence les intérêts privés ont-ils sur les processus politiques et juridiques des
États ? Dans quels cas le pouvoir économique des entreprises leur permet-il d'agir en dehors du
droit national et international pour faire taire les protestations des autochtones ? Quels sont les
mécanismes possibles pour exercer une pression juridique et économique sur les acteurs privés afin
d'encourager et de garantir la justice pour les peuples autochtones ? Quel est le potentiel des normes
internationales (c'est-à-dire les efforts déployés par les entreprises et les droits de l'homme au
niveau des Nations unies) ou des actions de masse des consommateurs (boycott...) à cet égard ?
Dans quelle mesure les politiques de responsabilité sociale des entreprises et les comportements
des différentes sociétés reflètent-ils ces normes et directives internationales ? Quelle est l'influence
des peuples autochtones sur les entreprises multinationales ?
Existe-t-il des cas où les processus décisionnels affectant les peuples autochtones sur le terrain ont
été transformés par la mise en oeuvre des principes internationaux des droits de l'homme ? Dans
quel sens le recours au consentement préalable libre et éclairé ouvre-t-il de nouvelles voies à cet
égard ? Ces principes représentent-ils de réelles avancées ou de "fausses solutions" qui génèrent un
sentiment d'aliénation encore plus grand chez les populations autochtones ?
Axe 3
PEUPLES AUTOCHTONES, JUSTICE SPATIALE ET ENVIONNEMENTALE
Coordonné par Brian Thom (Université de Victoria, Canada) et Jon Altman (The Australian
University)
Les objectifs de l'axe - centrés sur les questions foncières - visaient une analyse de la justice
territoriale autochtone et une étude théorique des politiques de connaissance et de reconnaissance.
D'une part, la recherche se concentre sur les conséquences sociales de la mauvaise gestion des
questions territoriales telles que : les expulsions forcées, la réinstallation et l'aliénation ; les politiques
exclusives de conservation ; la non prestation des services de citoyenneté ; et les conflits sur
l'utilisation concurrente ou incompatible des terres et des ressources. Elle vise à identifier les
raisons pour lesquelles les populations autochtones - et les jeunes en particulier - migrent ailleurs,
souvent vers les villes, ou connaissent des conditions de vie marginales sur leurs terres ancestrales.
Leur droit à l'autodétermination est violé, leurs formes de développement économique et culturel
- leur vision de la bonne vie (buen vivir) - sont limitées. Cela représente une source de conflits
politiques et entraîne l'appauvrissement des populations autochtones. Que peut-on dire de la
"relation spéciale" qui lie les peuples autochtones à leur territoire, selon la Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones et la Cour interaméricaine des droits de l'homme ?
Pouvons-nous préciser les visions autochtones de la justice spatiale, ainsi que les réponses des
peuples autochtones et des organisations de défense des droits de l'homme ?
L'idée serait de présenter différentes expériences et stratégies des peuples autochtones pour obtenir
justice et défendre leurs terres et leur autonomie, d'examiner comment les concepts de justice
spatiale se développent sur le terrain, au-delà des tribunaux. Pouvons-nous présenter quelques
résultats concernant le concept de justice climatique en examinant, par exemple, le rôle que les
populations autochtones pourraient jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre
en déployant leurs systèmes de connaissances dans la gestion de l'environnement ?
D'autre part, la recherche de la justice en ce qui concerne la relation des peuples autochtones avec
la terre, le territoire et les ressources naturelles fait appel aux politiques de la reconnaissance et de
la connaissance. Rendre les peuples autochtones "visibles" aux yeux des non-autochtones
représente un défi politique tandis que la valorisation des systèmes de connaissance, des
expériences et des relations à la terre des autochtones est un élément central de la lutte contre la
discrimination et le racisme. La cartographie est devenue un outil essentiel pour les peuples
autochtones en quête de justice spatiale, environnementale et économique.
Que pouvons-nous dire des cartes produites par, avec et pour les peuples autochtones, qui sont au
centre des consultations sur les terres et les ressources, et qui peuvent faire partie des efforts de
l'Etat pour répondre aux obligations du CPLE ? Considérant que la cartographie participative et
communautaire est un élément crucial pour la décolonisation des pratiques et des politiques de
recherche, l'idée serait de présenter ces pratiques cartographiques ainsi que certaines mesures
pratiques pour partager notre expertise et nos expériences dans la mobilisation de ces cartographies
de manière pratique avec nos collaborateurs autochtones et leurs partenaires de recherche.
Axe 4
POLITIQUE DE (RE)CONNAISSANCE ET SAVOIRS : JUSTICE DANS LA VILLE,
L'UNIVERSITÉ, LA CULTURE
Coordonné par Carole Levesque (DIALOG, INRS, Université de Montréal, Canada) et Renato
Athias (Université de Pernambouc, NEPE, Recife, Brésil)
Plusieurs questions sont apparues lors de la négociation de la Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones, qui remettent en question la position des peuples autochtones au
sein des politiques mondiales et étatiques : elles doivent faire de la place aux représentants
autochtones et à leurs propositions. Comment cela se fait-il ? Comment les propositions qui sont
faites incluent-elles des éléments de justice ? C'est sur ce point que nous souhaitions nous
concentrer.
Lorsque les questions autochtones sont prises en considération, nous observons qu'elles ont un
effet sur les structures, les programmes et les processus de recherche : notamment lorsque les
peuples autochtones deviennent visibles et commencent à parler par et pour eux-mêmes : Idle no
more, "Ne restez pas sans rien faire". Dans différents pays où les autochtones ont une voix, des
manuels d'éthique ont été écrits, qui circulent et définissent de nouvelles conditions pour faire de
la recherche : qu'ils soient considérés comme un frein pour mettre fin à la " recherche injuste ", ou
comme un moyen de faire une " recherche juste ", une évaluation doit être faite qui nécessite
l'association de chercheurs autochtones et non-autochtones. Les méthodologies collaboratives et
activistes ne contribuent pas seulement à mettre l'accent sur les questions importantes pour les
sociétés autochtones, elles enrichissent la recherche sociale par l'analyse approfondis de situations
auxquelles il est difficile d'accéder sans autorisation locale.
L'objectif de cet axe était d'établir un lien entre les recherch
es et les formes de collaboration avec les peuples autochtones dans différents domaines tels que la
gouvernance urbaine, l'éducation, l'économie sociale, le développement durable, le tourisme et l'art,
où les revendications autochtones sont réactivées à la lumière de la DNUDPA en fonction de deux
possibilités : rester sur le territoire et développer leur proposition ou être incorporé dans les
institutions occidentales (qu'elles soient publiques ou privées) et éventuellement les adapter.
Quelles expériences pouvons-nous présenter ?
Vidéos
Conférence d'ouverture
JUSTIP
Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones
Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones
Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones
Session 3 : Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones
Session 3 : Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones
Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre
Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables...
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections
Session 11 - Musée, réappropriation des savoirs, restitution des collections
Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux
Session 12 - Savoirs autochtones, savoirs occidentaux
Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone
Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés
Session 14- Co-construction des savoirs à l'université, dans les communautés