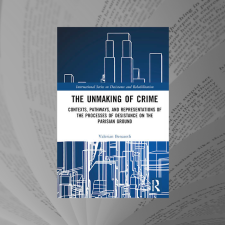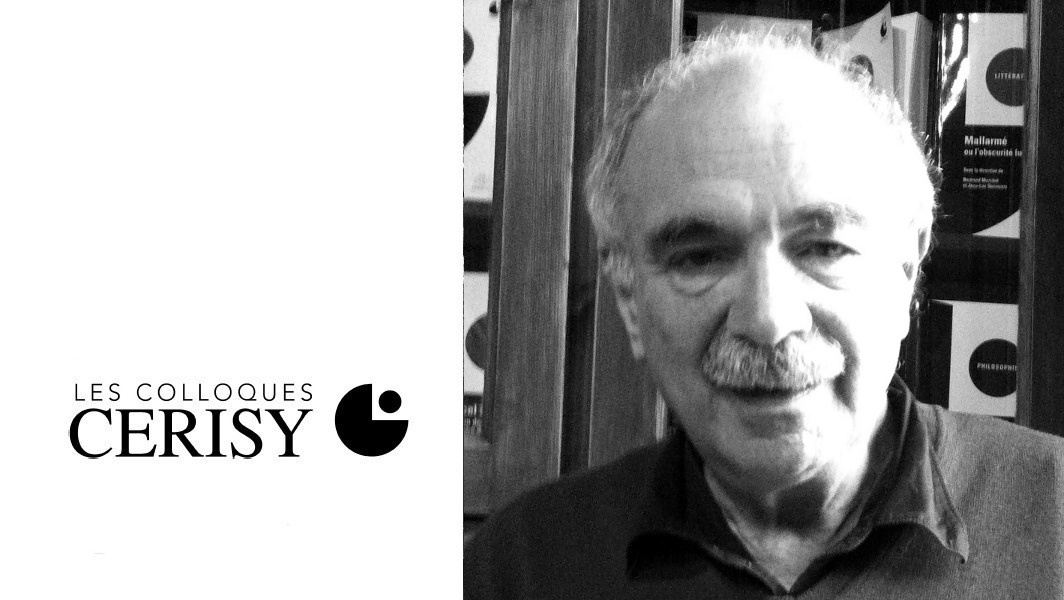Notice
Média pour la paix au service la justice transitionnelle
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque international Justice, Vérité & Résilience(s) qui s'est tenu à Caen les 23 et 24 novembre 2018. Ce colloque, porté par la MRSH, a été organisé dans le cadre du dispositif Normandie pour la Paix impulsé par la Région Normandie, avec le soutien de l’Institut Demolombe, de Caen la Mer et de l’Université de Caen et en partenariat avec l’Institut Universitaire Varenne.
Nourrir la paix durable suppose de lever le voile sur le silence qui recouvre une réalité souvent peu avouable. L’expérience de cette forme atypique de recherche de justice, nommée « justice transitionnelle », a été ouverte par Nelson Mandela, avec l’instauration des Commissions Vérités et Réconciliation en Afrique du Sud. Ce colloque international a pour ambition de réunir des acteurs clefs de commissions s’étant tenue sur divers continents. Une réflexion sera menée sur la question de la protection des défenseurs de l’environnement qui subissent des exactions à travers la planète. Sera également abordée la question du rôle des tribunaux d’opinion portés par la société civile.
Thierry Cruvellier est grand reporter, spécialiste des procès pour crimes contre l’humanité. Il a couvert de nombreuses zones de guerre et processus de réconciliation nationale à travers le monde, en particulier les procès pour crimes contre l’humanité. Il retrace ici sa carrière qui l’a mené à couvrir de grands procès (Colombie, Cambodge, Tchad) avant de développer L'hirondelle, une fondation suisse, dans la lignée de travaux précédemment menés notamment pour Reporters sans Frontières. L'idée consiste à créer des stations de radio pour aider l’organisation des camps et fournir aux auditeurs des informations fiables. Au Kinshasa, 2,5 millions de personnes ont ainsi pu bénéficier d’une source d’information reconnue par l’ensemble des parties. Au Mali, 3,5 millions de personnes ont été concernées par cette oeuvre de paix, en pouvant accéder à une information indépendante via les ondes radiophoniques. Le média justiceinfo.net est quant à lui spécifiquement dédié à la justice transitionnelle dans le monde. Fermement convaincu du fait que « la façon dont les hommes affrontent le passé est un des enjeux de paix » et partant du constat selon lequel la justice pénale internationale semble à bout de souffle, Thierry Cruvellier consacre à présent son temps au service de l’information en contexte de justice transitionnelle. Il rappelle que la Commission tunisienne a rendu en décembre 2018 son rapport. Il mentionne également l’expérience colombienne actuellement à l’oeuvre, qui est, à son avis « le plus grand programme de justice transitionnelle jamais organisé » car dotée de pouvoirs complets. Enfin, le journaliste conclut à une mutation contemporaine où justice transitionnelle et questions environnementales ont vocation à se rejoindre. Il cite de nombreux exemples, tant puisés dans le passé (l’expérience cambodgienne qui s’est soldée par une déforestation massive) que dans l'avenir (phénomènes d’accaparemment des terres et conflits liés à l’eau).
Sur le même thème
-
Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan
LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de
-
Valerian Benazeth - The Unmaking of Crime
BenazethValerianL’ouvrage documente les parcours d’anciens contrevenants qui réforment leur mode de vie et renoncent à la criminalité, analysant les capacités et limites du système pénal pour faciliter ce processus.
-
De la vulnérabilité en littérature
Je me propose d’articuler à l’anthropologie de la vulnérabilité une définition anthropologique (non formaliste) de la littérature : les œuvres littéraires représentent des situations de vulnérabilités
-
Droit et psychiatrie
Après deux ans d'application de la réforme, soignants, juges et universitaires ont tenté d'établir un bilan des avancées et des difficultés induites par le texte. De même, civilistes, pénalistes et
-
Droits et psychiatrie : conclusions
Jean-Yves CARLIER est professeur en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, à l'Université de Liège, aux Facultés universitaires Saint Louis et avocat. Il est ou a été professeur invité dans
-
La responsabilité environnementale
C'est par les prétoires que le dommage écologique vient d'être consacré en droit français. L'affaire de l'ERIKA marque ainsi de son empreinte le droit de la responsabilité pour l'avenir. Maître Huglo,
-
Au miroir des justices seigneuriales
Longtemps critiquées et déconsidérées, les justices seigneuriales bénéficient depuis quelques années d'une véritable réhabilitation de la part des historiens. Loin de l'image négative véhiculée depuis
-
La violence dans la France rurale d'Ancien Régime
L'étude de la violence dans la France moderne a donné lieu ces dernières années à des travaux importants. Il en ressort l'idée que la violence était située au cœur des relations humaines, sous des
-
La juste division du travail
Depuis sa consécration par la Constitution de l’OIT, la notion de "régime de travail réellement humain" a été interprétée comme obligation d’humaniser les conditions de travail. La justice sociale a
-
Écologie et existence. Philosophie du corps politique
Les éthiques environnementales reprochaient aux philosophies de la liberté de concevoir l’environnement comme un simple décor de l’histoire. Pourtant, elles n’ont pas su articuler l’écologie à une
-
Retour au sens — repenser l'universel
Les valeurs universelles sont depuis longtemps critiques et de façon souvent très pertinente; de quelle manière et avec quels outils conceptuels pouvons-nous les reenchanter ?
-
Justice environnementale, le défi de l'effectivité - Conférence 3
LhuilierGillesParanceBéatriceMutations économiques Modérateur : Gilles LHUILIER Intervenants : Gaël GIRAUD, Directeur de recherche au CNRS ; Michel LEPETIT, Vice-président de The Shift Project ; Un représentant de l’AFD