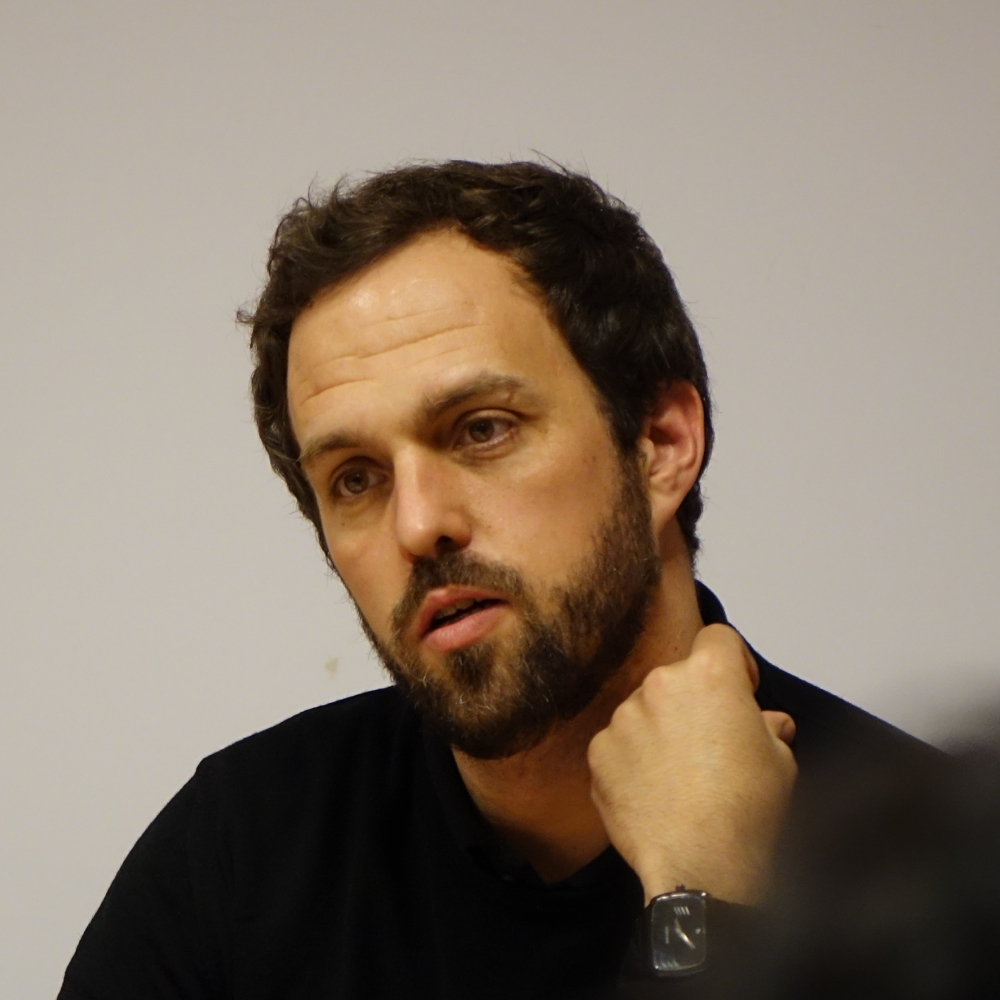Notice
Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand
Du droit de la guerre à la dérégulation de la guerre
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- Dossier
Descriptif
Ancienne élève de l’ENS Ulm, agrégée de philosophie, docteure en philosophie, Géraldine Lepan est Maîtresse de conférences HDR en philosophie politique à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle est l’auteure de nombreux travaux sur Rousseau, les contractualismes et néo-contractualismes, la guerre et la sociabilité. On peut citer notamment :
- L'amitié des citoyens, structure affective et pacte social, à paraître en 2023.
- Rousseau, Une politique de la vérité, Belin, coll. Le chemin des philosophes, 2015.
- Jean-Jacques Rousseau et le patriotisme, éd. Honoré Champion, coll. Les XVIIIe siècles, dirigée par Raymond Trousson et Antony McKenna, 2007.
- Commentaire du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Ellipses, 1998.
En résumé
L’intervention de Géraldine Lepan consiste à confronter deux théorisations de la guerre.
La première s’est diffusée au cours du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières étant considéré comme un siècle de juridicisation essentiel du droit de la guerre. La guerre devient la prérogative de l’Etat ; la violence devient le monopole de l’Etat. La tentative d’assujettir la guerre au droit et de limiter la violence des conflits, avait en effet abouti avec la tradition théologique et jusnaturaliste de la guerre juste, à l’effet inverse : stigmatiser ou criminaliser l’ennemi « injuste ». Aussi le XVIIIe siècle s’emploie-t-il à définir la guerre comme acte « normal » d’une puissance souveraine et avec Rousseau, à rechercher « les vrais principes de droit de la guerre » (en dissociant par exemple soigneusement l’homme, le citoyen et le soldat, et en réglementant en particulier le jus in bello).
La seconde partie porte sur la dérégulation de la guerre que l’on fait généralement commencer à la seconde guerre mondiale.
Ce plan en deux parties suggère qu’il y a bien eu, et de tout temps d’ailleurs, une tentative des hommes de juguler la violence, de la codifier lorsqu’elle prend place dans cet espace de « mauvais temps » dirait Hobbes, que l’on appelle la guerre. La guerre n’est pas le brigandage, le soldat sans code d’honneur est un bandit. Il n’y a pas nécessairement de contradiction, entre une entreprise de violence et de destruction, et une justification d'ordre moral et légal. On peut tenter de rendre compte de la guerre non exclusivement en termes de passions et d'intérêt, de logique de puissance et de nécessité (à la manière par exemple « réaliste » d'un art de la guerre selon Machiavel), mais en termes d'une justice dont il reste à éclairer le sens.
Mais ce plan suggère aussi que cet effort de distinguer la guerre de la barbarie, du déchaînement de violence pure et simple, achoppe depuis un siècle environ. Le droit de la guerre n’a-t-il donc jamais été qu’un discours juridico-moral sur la guerre, indispensable certes, mais sans traduction concrète sur la pratique de la guerre, voire un instrument de justification ?
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Dans la même collection
-
Le groupe de Gergovie : premier noyau de Résistance en Auvergne
PocrisArnaudArnaud Pocris présente le groupe d'étudiants strasbourgeois qui ont fondé le premier noyau de Résistance en Auvergne. Ils s'appelaient les « Gergoviotes ».
-
La redécouverte du milieu urbain dans la culture militaire occidentale depuis les années 2000
BoulangerPhilippePhilippe Boulanger aborde la ville sous l'angle des enjeux militaires : un espace longtemps incertain dans la pensée militaire occidentale, un espace difficile à maîtriser, les nouveaux défis dans la
-
Dans la guerre, la liberté ? Guerre et pensée politique en Italie à la fin du Moyen Âge
BaggioniLaurentLaurent Baggioni explore la manière dont la réflexion politique assimile l'expérience de la guerre dans l'Italie entre le milieu du XIVe et le début du XVIe siècle.
-
L'école et la nation d'une guerre à l'autre
LoubesOlivierOlivier Loubes qualifie la relation entre l’école et la nation dans la première partie du vingtième siècle.
-
De la zone rouge au camp militaire. Patrimoine mémoriel et naturel
AmatJean-PaulJean-Paul Amat met en lumière les paysages de guerre, traces mémorielles sources de richesses historiques, géographiques et biologiques, qui sont à préserver pour les générations futures.
-
Des républiques d’enfants nées sur les ruines de la guerre
GardetMathiasQuelle est la place des enfants et adolescents dans les guerres ? A partir de quand incarnent-ils la victime civile par excellence des conflits ? Mathias Gardet, historien, nous éclaire.
-
DES TRAÎTRES DANS LA RÉSISTANCE
GrenardFabriceDans ce podcast, Fabrice Grenard, auteur de « La Traque des Résistants », présente la manière dont les Allemands ont réussi à infiltrer des agents, français, dans la Résistance dès 1940.
-
Crimes de guerre
CotteBrunoBruno Cotte, haut magistrat français, qui a présidé durant plusieurs années une chambre de première instance à la Cour pénale internationale de La Haye, intervient sur la notion de « Crimes de guerre
Sur le même thème
-
Salima Tenfiche, lauréate de la meilleure thèse francophone sur le Maghreb 2023
TenficheSalimaSalima Tenfiche, lauréate du prix de la meilleure thèse francophone sur le Maghreb pour sa thèse : Glorifier les morts ou consacrer les vivants : Une histoire esthétique et politique du cinéma
-
L'Éthiopie, vue par Abrham Meareg
Meareg AmareAbrhamLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique.
-
De la zone rouge au camp militaire. Patrimoine mémoriel et naturel
AmatJean-PaulJean-Paul Amat met en lumière les paysages de guerre, traces mémorielles sources de richesses historiques, géographiques et biologiques, qui sont à préserver pour les générations futures.
-
Des républiques d’enfants nées sur les ruines de la guerre
GardetMathiasQuelle est la place des enfants et adolescents dans les guerres ? A partir de quand incarnent-ils la victime civile par excellence des conflits ? Mathias Gardet, historien, nous éclaire.
-
Crimes de guerre
CotteBrunoBruno Cotte, haut magistrat français, qui a présidé durant plusieurs années une chambre de première instance à la Cour pénale internationale de La Haye, intervient sur la notion de « Crimes de guerre
-
Le général Pellé, soldat, diplomate et artiste
Sandiford-PelléIsabelleAdjoint de Joffre au GQG en 1914-1916. Créateur de l'armée tchèque auprès de Masaryk en 1919-1921. Dessinateur et caricaturiste dès son enfance.
-
Les balkanismes par-delà le "spatial turn". Construction d'identité et tiers-espace
Dans le sillage d’Homi K. Bhabha et de son ouvrage Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale (Paris, Payot, 2007), elle a tenté de comprendre à partir de l’étude de textes de certains auteurs
-
Les diplomates et consuls français face au 18 juillet 1936 : ordre, contre-révolution et légitimati…
L’historien Eduardo González Calleja a mis récemment en évidence la stratégie d’ «encadrement culturel» déployée par les forces contrerévolutionnaires espagnoles au lendemain de la victoire du Frente
-
Soulèvements, révoltes, révolutions
Les révoltes qui secouèrent les possessions des Habsbourg d’Espagne entre les débuts du XVIe siècle et la fin du siècle suivant offrent à l’historien une moisson de témoignages émanant des révoltés
-
El impacto de la guerra en un territorio estratégico: el noroeste peninsular en la Edad Moderna
El Noroeste de la Península Ibérica, en especial el Reino de Galicia, ocupaba un espacio estratégico durante la Edad Moderna debido a su condición fronteriza con Portugal y, sobre todo, a su extensa
-
Stratégies de sortie: les alliés italiens de la France et de l’Espagne en Italie du Nord (1635-1638)
A travers l’étude du positionnement des « petits états italiens », c'est-à-dire les duchés de Parme, Mantoue, Modène, de la république de Gênes, et dans une moindre mesure de Savoie et de Toscane, la
-
Oír la guerra. El sonido de las revueltas y los enfrentamientos en la monarquía hispánica
Esta presentación describe el paisaje sonoro y el efecto de la guerra sobre distintos oyentes. Mi exposición se centrará en las campañas continuadas que afectaron a Flandes y los Países Bajos entre