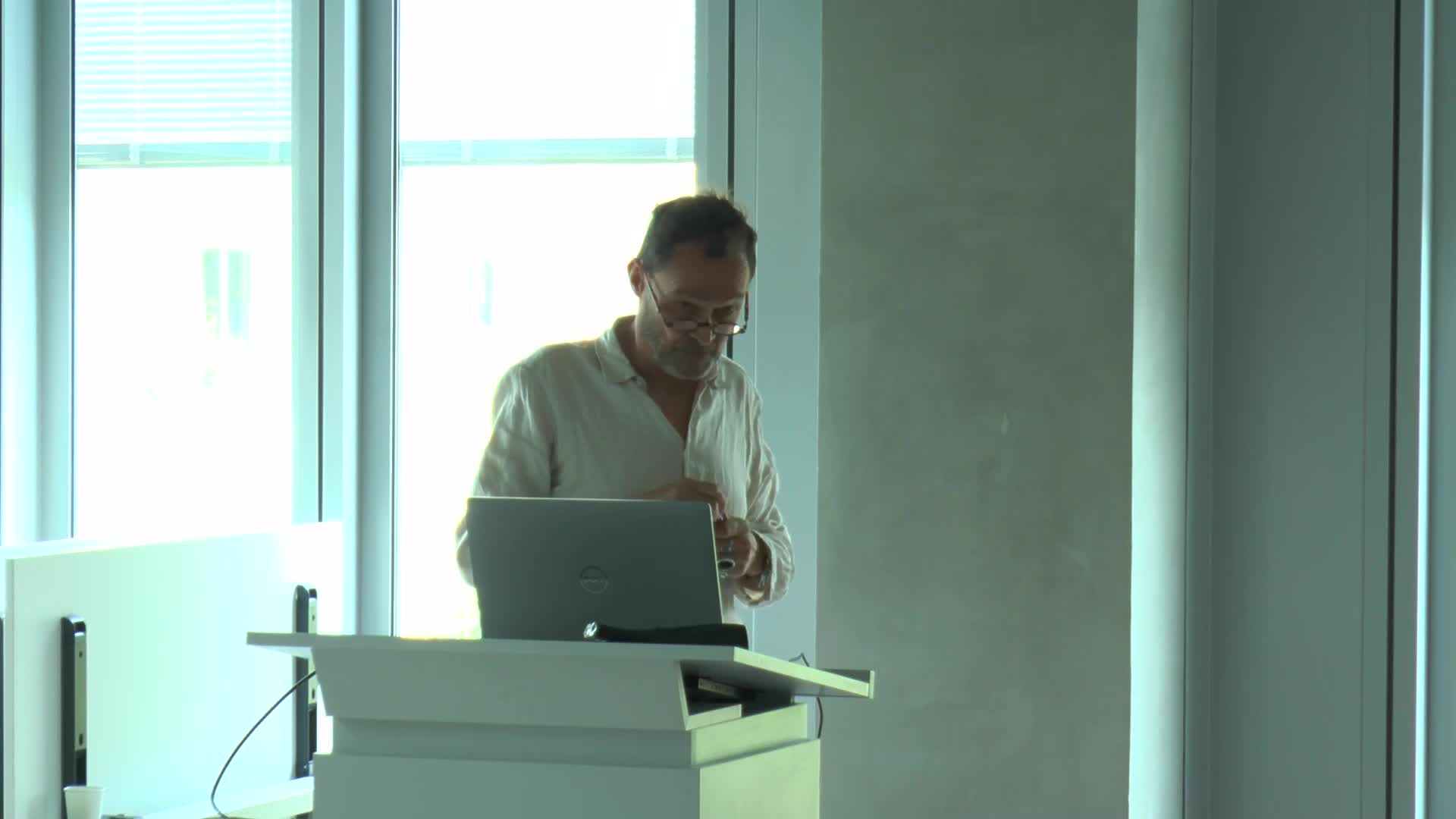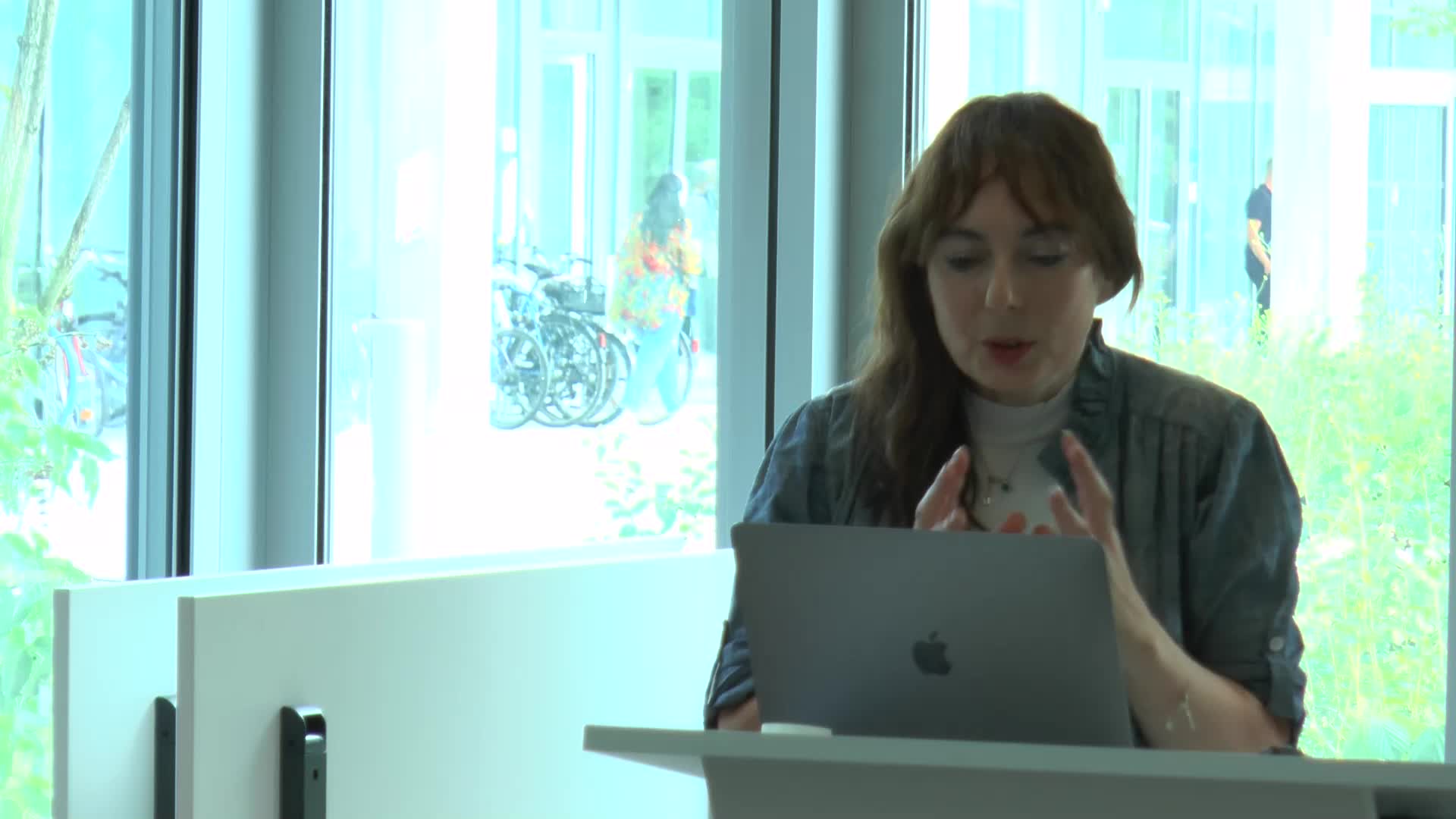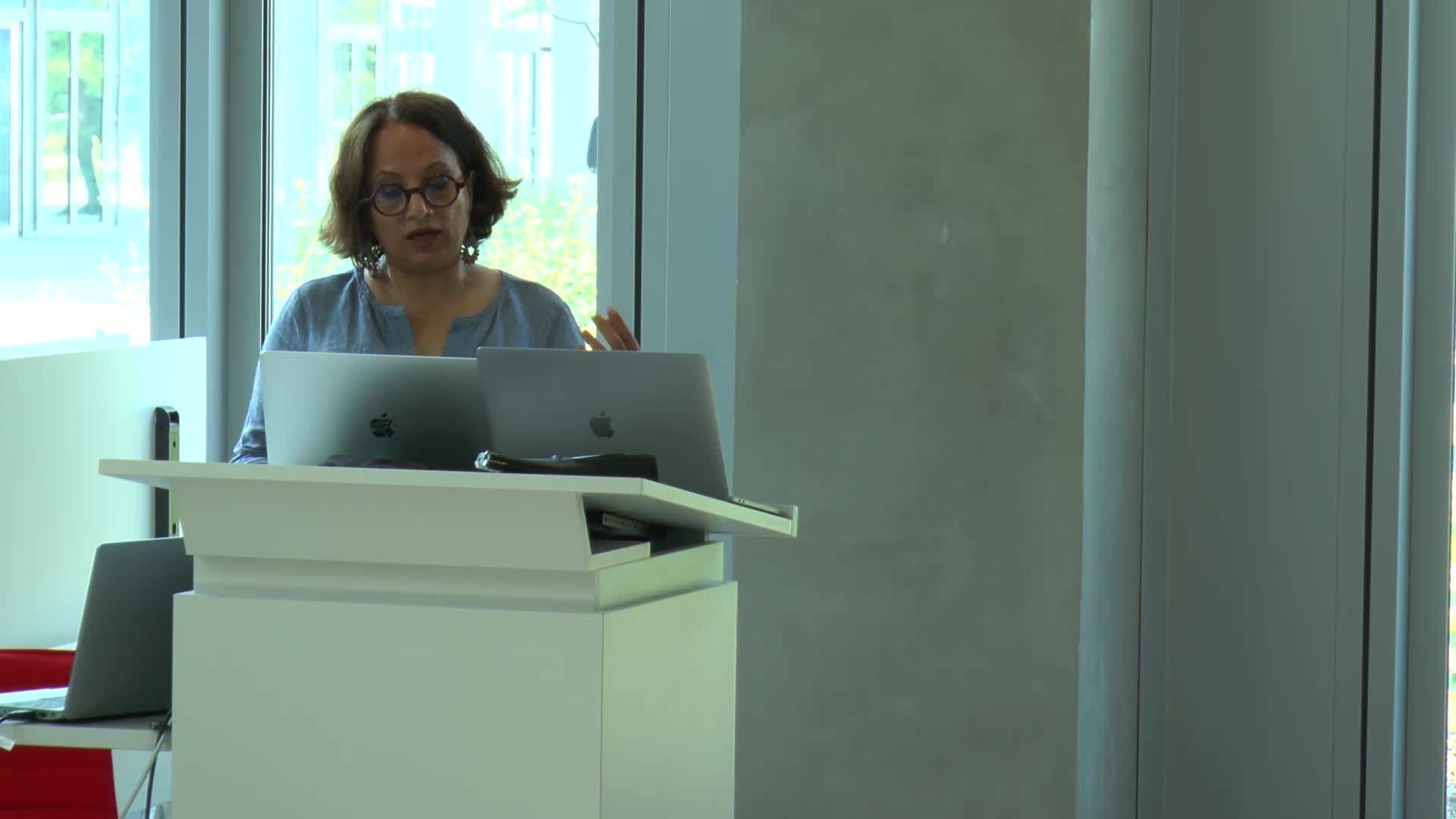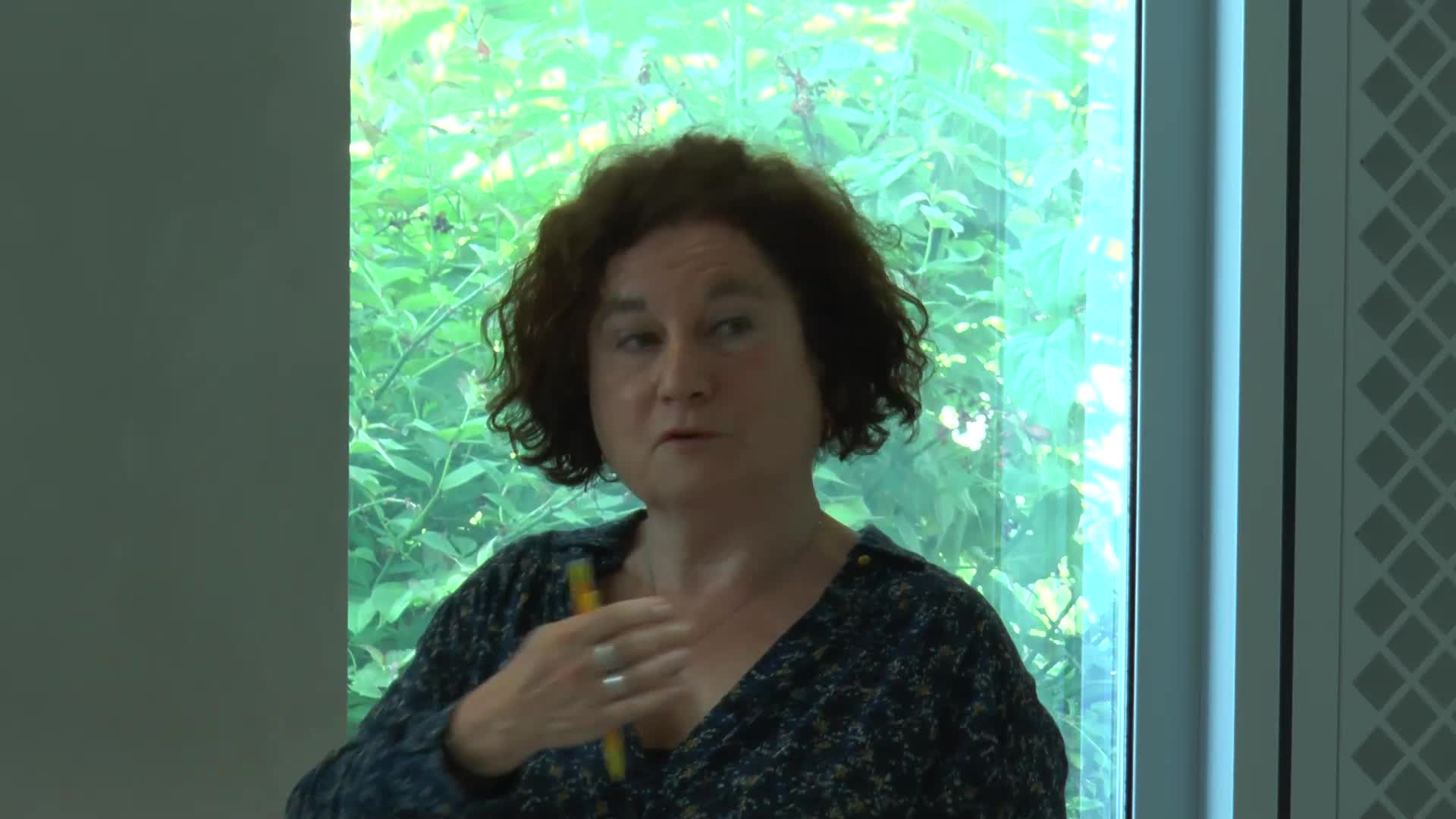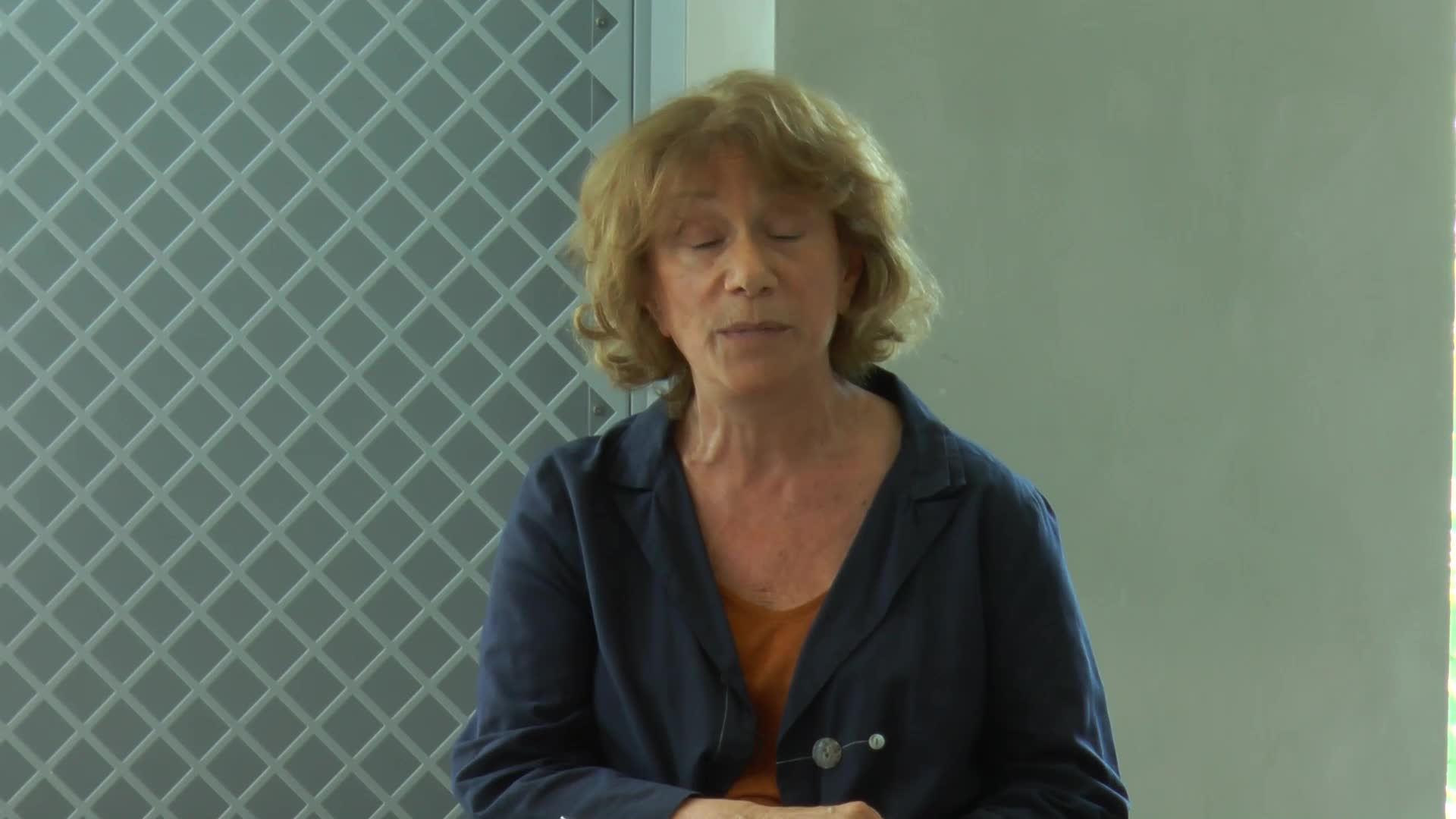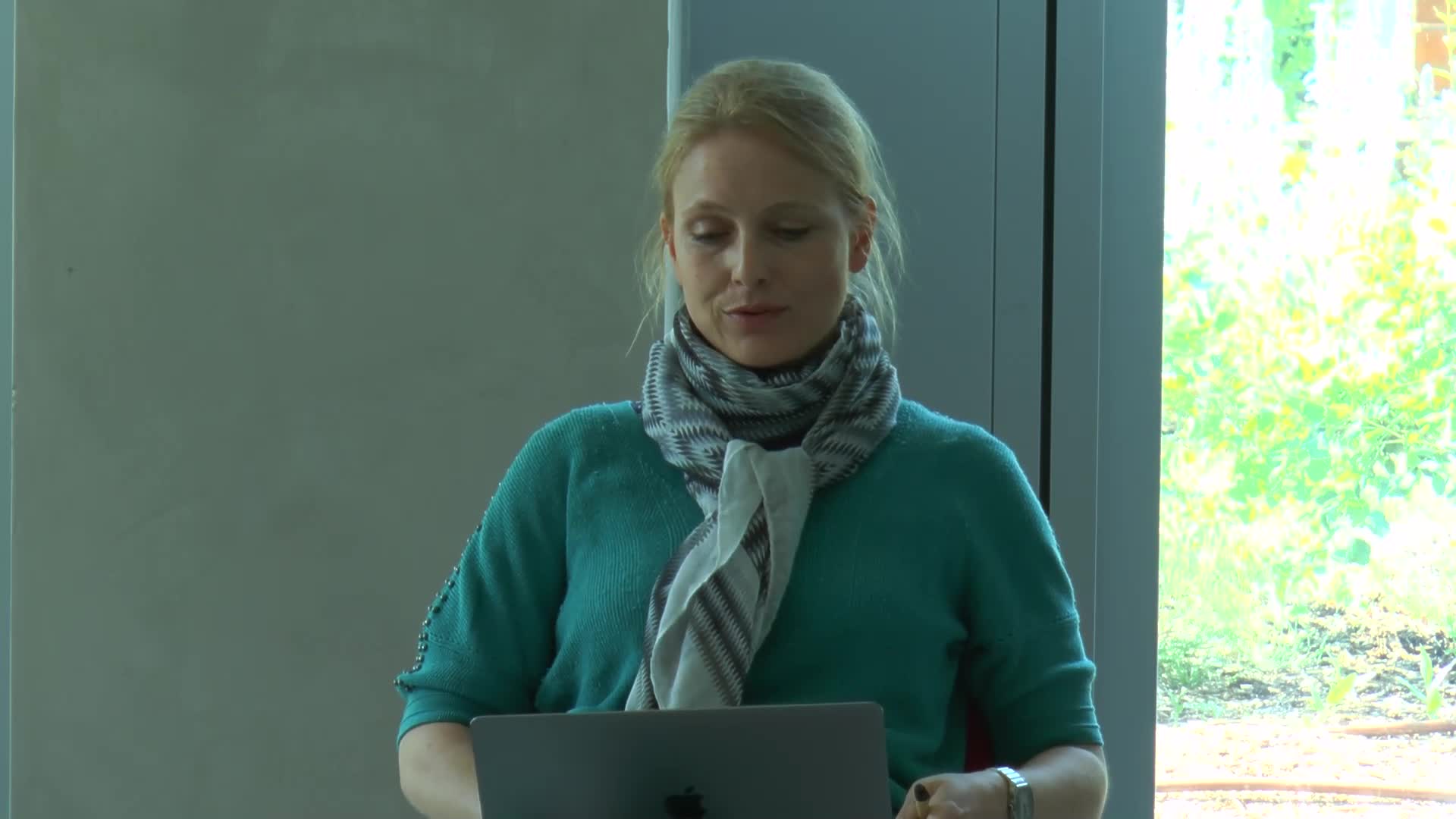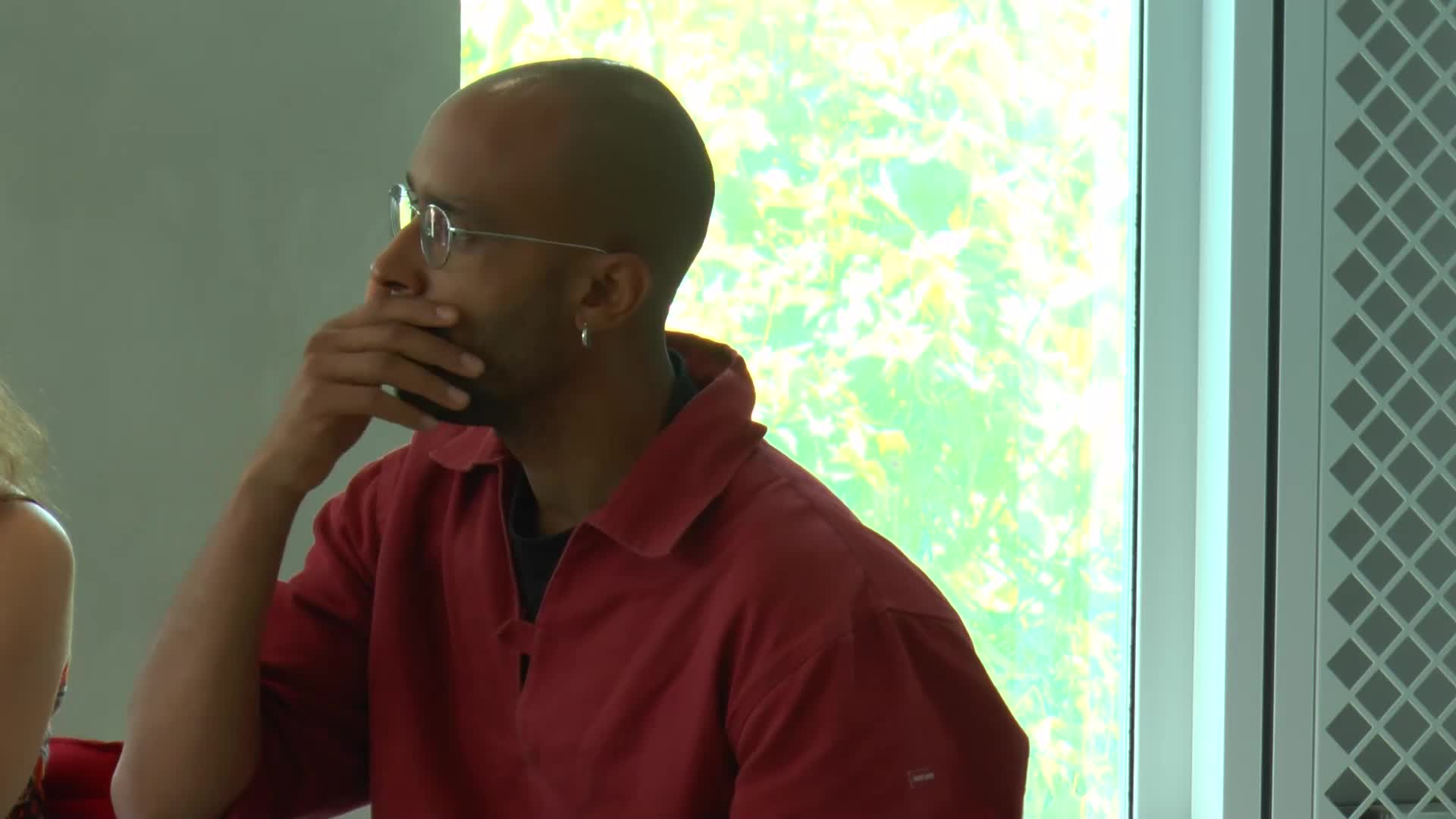Notice
Table-ronde #4 - Ethnographies féministes et queer. Entre anthropologie critique et complicités politiques
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Organisée par Elias CAILLAUD (LAP, EHESS), Paul FORIGUA CRUZ (LAP), Flavia DE FARIA (LAP), Michela FUSASCHI (LAP, Rome III), Gianfranco REBUCINI (LAP, CNRS) & Morgane TOCCO (LAP, EHESS)
Animée par Flavia DE FARIA (LAP), Michela FUSASCHI (LAP, Rome III) & Gianfranco REBUCINI (LAP, CNRS)
Depuis les années 1970, les féminismes ont posé des défis considérables à la pratique anthropologique et ont su faire émerger une critique profonde des représentations et des méthodes ethnographiques. Ces critiques ont eu des effets durables sur l’ensemble de la discipline. Participant aux développements des traditions des pensées critiques postmodernes et postcoloniale héritières du marxisme, les anthropologues féministes, dans le monde anglophone comme francophone, des Nords et des Suds, ont contribué au dévoilement des responsabilités et des rapports de pouvoir dans la recherche ethnographique, en mettant en exergue de nouvelles normes de réflexivité et de point de vue dans le travail de terrain et dans la production du savoir. Cela a permis de faire apparaître d’autres voix et d’autres images sur le terrain, d’ouvrir la voie à l’émergence de sujets silenciés jusque-là, les femmes et d’autres sujets minoritaires.
À partir des années 1990, les théories et pratiques queer sont venues enrichir la critique féministe et ont posé des défis supplémentaires à la pratique ethnographique. Pensée profondément ancrée dans une critique de l’identité, sexuelle et de genre, mais pas seulement, le queer a contribué à déstabiliser les convictions de l’anthropologie dans ses catégorisations et divisions du monde social. Portant un regard sur les transgressions et l’excès des frontières, des limites et des catégories d’analyse, le queer trouble la pratique ethnographique dans ses présupposés naturalisés concernant les corps, les affects, les individualités et les subjectivations politiques et sociales. Tissés aux mouvements politiques de justice sociale, les féminismes et les courants queer contemporains continuent d’interroger et de produire des liens critiques entre théories, méthodes, épistémologies et transformation radicale de la société.
En ce moment politique particulier de crises globales et d’émergence de nouveaux sujets politiques, ce panel se propose ainsi d’explorer les potentialités des engagements féministes et queer à partir de différents lieux politiques et espaces géographiques. Les mouvements féministes et des femmes représentent souvent des lieux de contestation de l’existant et de proposition politique forte (grèves féministes, mouvements des places, révolutions arabes), tandis que les mouvements LGBT et queer se retrouvent de plus en plus au centre des expériences politiques contemporaines de transformation radicale (Occupy, Black lives matter, ZADs, etc.).
Dans le sillage des ethnographies queer et féministes, sans s’y réduire, ce panel appelle à l’étude de possibilités d’ethnographies construites en alliance et complicité avec ces mouvements sociaux au Nord comme dans les Suds. Comment travailler « avec », plutôt que « travailler sur » eux ? Comment le travail ethnographique peut-il faire émerger et amplifier les voix de sujets et de groupes minoritaires et minorisés potentiellement vulnérables, mais souvent porteurs d’alternatives politiques et d’expériences innovantes face à un système capitaliste toujours plus violent et plus envahissant (voir le manifeste « Gens : a Feminist Manifesto for the Study of Capitalism ») ? De quelle façon les expériences et les épistémologies des féminismes et des pratiques et théories queer sont-elles capables de répondre à la crise écologique et du vivant (écoféminisme, théories du « trouble » de Haraway, écologie queer, etc.) ? Comment les critiques féministes et queer déstabilisent-elles encore la discipline, notamment dans ses conditions de violence épistémique inhérentes à la modernité coloniale ? Et surtout comment la question d’une critique décoloniale venant des Suds à partir de ces cadres analytiques féministes et queer se pose-t-elle aujourd’hui comme encore plus essentielle ?
Intervenant·es
Elias CAILLAUD (LAP, EHESS), Giovanna CAVATORTA (Rome III), Paul FORIGUA CRUZ (LAP), Noémie MERLEAU-PONTY (IRIS, CNRS) & Morgane TOCCO (LAP, EHESS).
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Dans la même collection
-
Table-ronde #10 - Rapports aux passés et agir politique
BarbeNoëlCabotRobertoCharollesValérieKokkinouMariaRibertEvelyneWateletCharlotte« Rapports aux passés et agir politique »
-
Table-ronde #9 - L’anthropologie politique à l’épreuve des migrations
DujmovicMorganeLecadetClaraPapeEliseRibertEvelyneSchieranoPaolaL'attention croissante portée aux migrations et aux frontières a certainement contribué à la transformation des objets et des pratiques d’enquête de l’anthropologie politique...
-
Table-ronde # 8 - Anthropologie politique et ethnographies plus qu’humaines
BrunoisFlorenceEllisonNicolasFoyerJeanHoudartSophieLe foisonnement des recherches autour des « non-humains » a mis en avant la nécessité de produire de nouveaux récits pour décrire notre monde abîmé et de « ré-outiller » l’anthropologie pour faire
-
Table-ronde #6 - Acter politiquement la Création. À l’angle du corps créateur, vers une anthropolog…
ChardelPierre-AntoineVillamil RojasYamilePalermoChiaraTsangFannyVadori-GauthierNadiaL’enjeu consiste à réfléchir à la Création plastique et littéraire dans la reconfiguration de ses catégories de modèles comme ses répertoires d’action, radicalement différente « dans les Nords et les
-
Table-ronde #7 - Silences meurtriers : pour une anthropologie politique de l’absence
KapilaKritiGeschierePeterSusserIdaNous interrogerons le lien social, politique, humain, tel qu’il peut s’établir dans et par l’absence, dans plusieurs contextes ethnographiques...
-
Table-ronde #3 - L’anthropologie politique contre les alternatives, tout contre
AureilleMarieCoulauxOlivierGonzalezLeonorRicaud OnetoEmmanuelleRoyMartinCiavolellaRiccardoRaulinAnneLes appels faits aux anthropologues à étudier « les alternatives » et à trouver dans leur analyse des « réponses » et des « solutions » aux crises qui font l’actualité sont aujourd’hui nombreux.
-
Table-ronde #5 - Nouvelles écritures et récits d’enquête
ViartDominiqueSantiniMaudLa CeclaFrancoLapierreNicoleBlazquezAdèleEn anthropologie, rares sont les récits rapportés du terrain qui font état des interactions entre observateur et observés, ou alors elles sont lissées, le plus souvent comme des implicites, afin de
-
Table-ronde #2 - Epistémologie multi-versaliste : quelle anthropologie politique dans le monde d’ap…
ḤammūdīʿAbd AllāhRodrigueBarry H.FlynnAlexCette table-ronde s’interroge sur les défis que pose l’élaboration d’une telle épistémologie au regard de l’ambition affichée d’une unité de l’anthropologie, autrement dit d’une discipline à l’échelle
-
Prologue - Repenser l'anthropologie politique au XXIème siècle
CiavolellaRiccardoAbélèsMarcNeveuCatherineTrémonAnne-ChristineWittersheimÉricLe nouveau Laboratoire d’Anthropologie Politique est né de l’ambition de constituer un centre d’élaboration et de diffusion d’un savoir critique sur les transformations des mondes contemporains
-
Table-ronde #1 - Anthropologie politique de(s) institution(s)
CodjiaPaulDematteoLyndaDe Faria Moreira Da SilvaFlaviaSenoransDoloresComment émergent des institutions (des formes collectives plus ou moins discrètes), qui sont loin d’être toutes étatiques/publiques, en dialogue, en confrontation ou en autonomie avec des formes