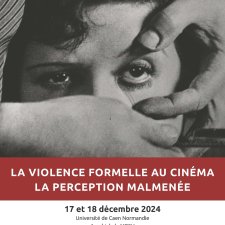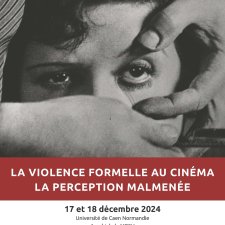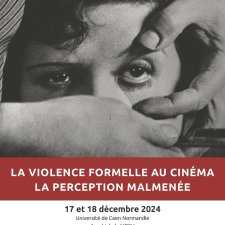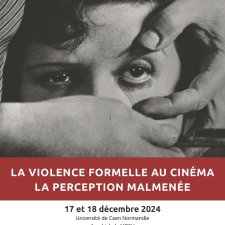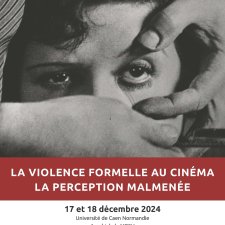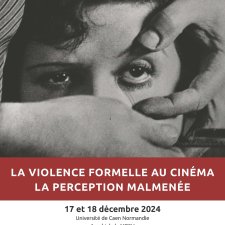La violence formelle au cinéma : la perception malmenée
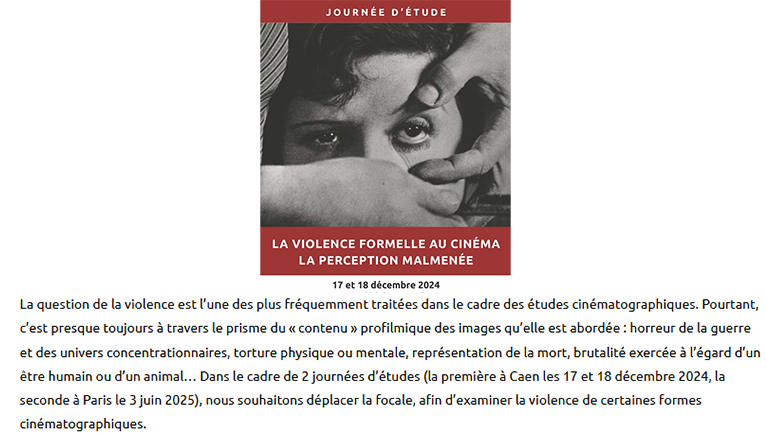
Descriptif
La question de la violence est l’une des plus fréquemment traitées dans le cadre des études cinématographiques. Pourtant, c’est presque toujours à travers le prisme du « contenu » profilmique des images qu’elle est abordée : horreur de la guerre et des univers concentrationnaires, torture physique ou mentale, représentation de la mort, brutalité exercée à l’égard d’un être humain ou d’un animal… Dans le cadre de 2 journées d’étude (la première à Caen les 17 et 18 décembre 2024, la seconde à Paris le 3 juin 2025), nous souhaitons déplacer la focale, afin d’examiner la violence de certaines formes cinématographiques. Il s’agira donc d’étudier ce que nous proposons de nommer la « violence formelle » au cinéma. Il existe en effet tout un panel de formes cinématographiques brutales, agressives, au sens où elles génèrent pour les spectateurs des stimuli sensoriels désagréables, voire douloureux : montage ultra-rapide, pulsatile, de plans hétérogènes, parfois monophotogrammatiques ; répétition ad nauseam de certains sons se caractérisant, par exemple, par leurs basses puissantes ; transformations soudaines et spectaculaires de la perspective et de la profondeur de champ ; changements brutaux et inattendus des échelles de plan ; images au cadre extrêmement tressautant ; absence volontaire de raccord et « saut » d’un plan à un autre ; usage de lumières aveuglantes ou de couleurs saturées… Des formes violentes sont mobilisées, bien qu’à divers degrés, tant par le cinéma mainstream (Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Sam Peckinpah…) que par le cinéma « de genre » (films d’horreur, avec notamment les slashers, qui inscrivent le motif de la taillade dans le style filmique lui-même) et le cinéma d’avant-garde (Sergueï Eisenstein ; Peter Kubelka ; le cinéma dit « structurel », avec notamment Paul Sharits, Ernie Gehr, Michael Snow, Tony Conrad, Ken Jacobs…). À travers des corpus variés, ces journées d’étude tenteront donc de cerner la nature de la violence formelle au cinéma, et les fonctions qu’elle peut y assumer.
Organisation : Baptiste VILLENAVE (Université de Caen Normandie) et Massimo OLIVERO (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Comité scientifique : Vincent DEVILLE (Université Paul Valéry Montpellier 3), Antoine GAUDIN (Université Sorbonne-Nouvelle), Aurélie LEDOUX (Université Paris-Nanterre), Sarah LEPERCHEY (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), José MOURE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Hélène VALMARY (Université de Caen Normandie)
Vidéos
Introduction générale aux journées d’étude « La violence formelle au cinéma. La perception malmenée
Existe-t-il, au cinéma, une violence spécifiquement générée par la forme filmique ? Si oui, quelle en est la nature, et quelles peuvent en être les fonctions ? Telles sont les interrogations qui
L’expérience kinesthésique de l’Exploding Plastic Inevitable : flicker de projection et flicker de …
L’Exploding Plastic Inevitable (1966) est un spectacle multimédia qui prend place le 13 janvier 1966 dans une discothèque de l’East Village à New York. Il s’agit d’une installation mise en scène par
Une déchirure anticoloniale : sur l’emploi du flicker dans On Africa (1970) de Skip Norman
On Africa, du cinéaste afro-américain Skip Norman (1933-2015), est une œuvre qui mobilise des stratégies de violence formelle afin de perturber la règle dominante de la logique et de l’imagerie
Les prouesses de Ken Jacobs, ou la violence du dispositif comme plaisir formel
À la fin des années 1960, aux États-Unis, le cinéaste Ken Jacobs entame ses expériences perceptives sur des films des premiers temps à l’aide d’un projecteur analytique lui permettant de faire des
Sifflement, raucité, rythme. Structures acoustiques dans les films du réalisateur Vladimir Kobrin
Le collage acoustique, dans les films de Vladimir Kobrin, constitue une critique du texte scientifique et une tentative de distance ironique.
Noirs et blancs. Violences audio-visuelles par la négative
Il existe une violence d’autant plus insidieuse et pernicieuse qu’elle s’exprime par son absence même, ou son propre envers. Comme le silence serait une violence faite au son, l’absence d’image
Agressions du regard dans trois films de sabre japonais des années 1960 : des tentatives pour mettr…
Un cadre bringuebalé et un objectif éclaboussé par les soubresauts d’une course acharnée dans les eaux d’une rizière que traverse un assassin dans Le Grand Attentat (Eiichi Kudō, 1964) ; une image
The Walking Dead : violence formelle, violence reçue. Mordre ou être mordu. Une étude de la relatio…
S’il est initialement acquis, du fait du genre de l’œuvre (drame horrifique post-apocalyptique) que la série fraye avec le funeste sang noir, comment d’une part parvient-elle malgré tout à nouer un
Du Mal (originel ?) des transports
Plusieurs films relevant du found footage horrifique (Cloverfield de Matt Reeves (2008), Rec de Jaume Balaguero et Paco Piazza (2007)) ont été identifiés comme provoquant chez les spectateurs les