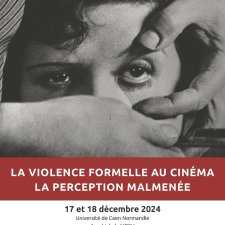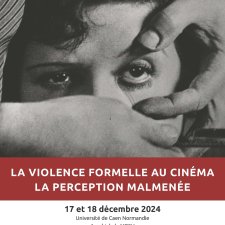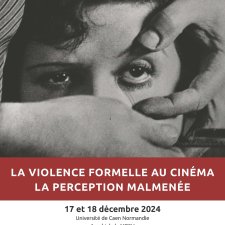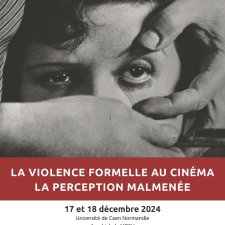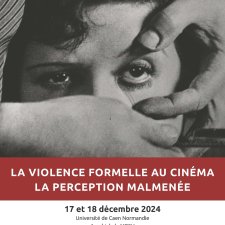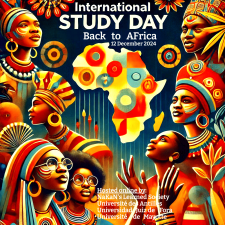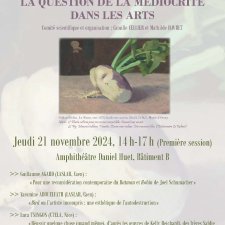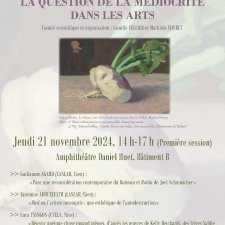Notice
Agressions du regard dans trois films de sabre japonais des années 1960 : des tentatives pour mettre à mal la place privilégiée du spectateur de cinéma ?
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Résumé de la communication : Un cadre bringuebalé et un objectif éclaboussé par les soubresauts d’une course acharnée dans les eaux d’une rizière que traverse un assassin dans Le Grand Attentat (Eiichi Kudō, 1964) ; une image recouverte d’un sang noir projeté par la carotide d’un seigneur brutalement décapité dans Samouraï (Kihachi Okamoto, 1965) ; l’idéogramme « Fin » en surimpression sur l’image floutée par le mouvement soudainement figé d’un corps de sabreur déchaîné dont le coup de katana semble déchirer l’écran dans Le Sabre du mal (Kihachi Okamoto, 1966) : trois exemples d’agression du regard ponctuant des fleurons du second âge d’or du chanbara. Alors que le Japon est agité par de profondes révoltes ouvrières, étudiantes et bientôt paysannes en cette décennie des années 1960, le film de sabre japonais renoue avec son héritage esthétique et thématique, celui du hangyaku jidai-geki (drame historique de la rébellion) s’épanouissant du milieu des années 1920 à celui des années 1930 avant d’être mis sous le boisseau par une décennie de militarisme puis une autre d’occupation américaine. Au-delà des enjeux thématiques, historiques ou esthétiques, il s’agira de se demander si ces agressions des sens et en particulier de la vue qui traduisent le désordre des combats des trois films ne cherchent pas surtout à bousculer la place privilégiée du spectateur.
Biographie de l'auteur : Simon Daniellou est maître de conférences à l’université Rennes 2 et membre de l’unité de recherche « Arts : pratiques et poétiques » (EA 3208).
Dans la même collection
-
Les prouesses de Ken Jacobs, ou la violence du dispositif comme plaisir formel
À la fin des années 1960, aux États-Unis, le cinéaste Ken Jacobs entame ses expériences perceptives sur des films des premiers temps à l’aide d’un projecteur analytique lui permettant de faire des
-
Une déchirure anticoloniale : sur l’emploi du flicker dans On Africa (1970) de Skip Norman
On Africa, du cinéaste afro-américain Skip Norman (1933-2015), est une œuvre qui mobilise des stratégies de violence formelle afin de perturber la règle dominante de la logique et de l’imagerie
-
Du Mal (originel ?) des transports
Plusieurs films relevant du found footage horrifique (Cloverfield de Matt Reeves (2008), Rec de Jaume Balaguero et Paco Piazza (2007)) ont été identifiés comme provoquant chez les spectateurs les
-
Noirs et blancs. Violences audio-visuelles par la négative
Il existe une violence d’autant plus insidieuse et pernicieuse qu’elle s’exprime par son absence même, ou son propre envers. Comme le silence serait une violence faite au son, l’absence d’image
-
Introduction générale aux journées d’étude « La violence formelle au cinéma. La perception malmenée
Existe-t-il, au cinéma, une violence spécifiquement générée par la forme filmique ? Si oui, quelle en est la nature, et quelles peuvent en être les fonctions ? Telles sont les interrogations qui
-
Sifflement, raucité, rythme. Structures acoustiques dans les films du réalisateur Vladimir Kobrin
Le collage acoustique, dans les films de Vladimir Kobrin, constitue une critique du texte scientifique et une tentative de distance ironique.
-
The Walking Dead : violence formelle, violence reçue. Mordre ou être mordu. Une étude de la relatio…
S’il est initialement acquis, du fait du genre de l’œuvre (drame horrifique post-apocalyptique) que la série fraye avec le funeste sang noir, comment d’une part parvient-elle malgré tout à nouer un
-
L’expérience kinesthésique de l’Exploding Plastic Inevitable : flicker de projection et flicker de …
L’Exploding Plastic Inevitable (1966) est un spectacle multimédia qui prend place le 13 janvier 1966 dans une discothèque de l’East Village à New York. Il s’agit d’une installation mise en scène par
Sur le même thème
-
Les prouesses de Ken Jacobs, ou la violence du dispositif comme plaisir formel
À la fin des années 1960, aux États-Unis, le cinéaste Ken Jacobs entame ses expériences perceptives sur des films des premiers temps à l’aide d’un projecteur analytique lui permettant de faire des
-
Une déchirure anticoloniale : sur l’emploi du flicker dans On Africa (1970) de Skip Norman
On Africa, du cinéaste afro-américain Skip Norman (1933-2015), est une œuvre qui mobilise des stratégies de violence formelle afin de perturber la règle dominante de la logique et de l’imagerie
-
Du Mal (originel ?) des transports
Plusieurs films relevant du found footage horrifique (Cloverfield de Matt Reeves (2008), Rec de Jaume Balaguero et Paco Piazza (2007)) ont été identifiés comme provoquant chez les spectateurs les
-
Noirs et blancs. Violences audio-visuelles par la négative
Il existe une violence d’autant plus insidieuse et pernicieuse qu’elle s’exprime par son absence même, ou son propre envers. Comme le silence serait une violence faite au son, l’absence d’image
-
Introduction générale aux journées d’étude « La violence formelle au cinéma. La perception malmenée
Existe-t-il, au cinéma, une violence spécifiquement générée par la forme filmique ? Si oui, quelle en est la nature, et quelles peuvent en être les fonctions ? Telles sont les interrogations qui
-
Sifflement, raucité, rythme. Structures acoustiques dans les films du réalisateur Vladimir Kobrin
Le collage acoustique, dans les films de Vladimir Kobrin, constitue une critique du texte scientifique et une tentative de distance ironique.
-
The Walking Dead : violence formelle, violence reçue. Mordre ou être mordu. Une étude de la relatio…
S’il est initialement acquis, du fait du genre de l’œuvre (drame horrifique post-apocalyptique) que la série fraye avec le funeste sang noir, comment d’une part parvient-elle malgré tout à nouer un
-
L’expérience kinesthésique de l’Exploding Plastic Inevitable : flicker de projection et flicker de …
L’Exploding Plastic Inevitable (1966) est un spectacle multimédia qui prend place le 13 janvier 1966 dans une discothèque de l’East Village à New York. Il s’agit d’une installation mise en scène par
-
BACK TO AFRICA: NaKaN's International Study Day
LefrançoisFrédéricDésertGéraldBundu MalelaBuataMingote Ferreira de ÁzaraMichelPuigStèveKalyAlain PascalWenkRafaelaPrematChristopheMarcelBalogounCarienMinakshîJournée d'étude internationale coproduite par la Société Savante NaKaN, l'Université des Antilles, l'Université de Mayotte, la Universidad Juiz de Fora (Brésil).
-
Bird (1988) ou l’artiste maudit : une esthétique de l’autodestruction
Notre intervenante analyse un cas particulier de personnage de loser, à savoir, la figure de l’artiste maudit, dont le génie semble paradoxalement précipiter la chute.
-
Pour une reconsidération contemporaine du Batman et Robin de Joel Schumacher
Dans le cadre de ce séminaire ,il plaide « pour une reconsidération contemporaine du Batman et Robin de Joel Schumacher » (1997).
-
Ciné-dialogues Afrique - Séance inaugurale - Sambizanga (1972) de Sarah Maldoror
Andrade deAnnouchkaCallonnecLaurentBruzzoneAnnaCiné-dialogues Afrique - Séance inaugurale - Sambizanga (1972) de Sarah Maldoror