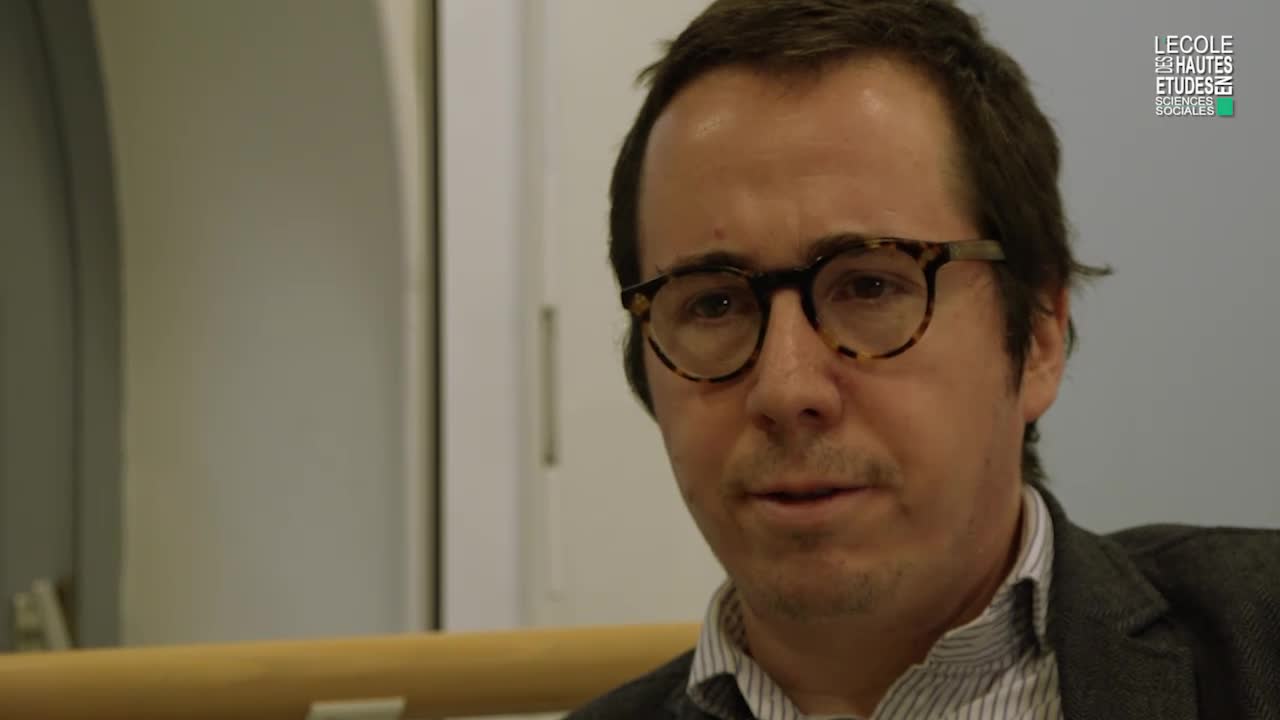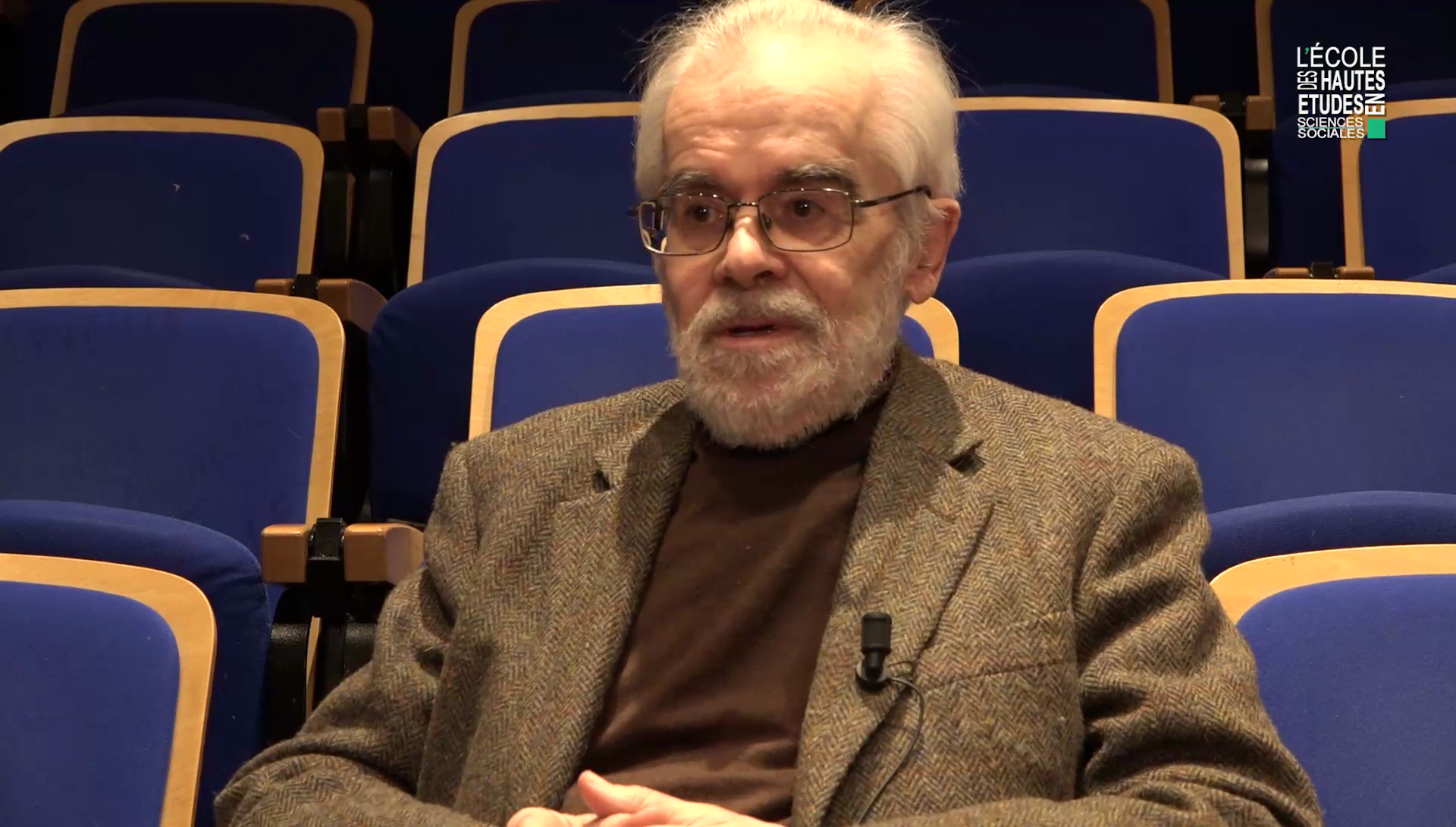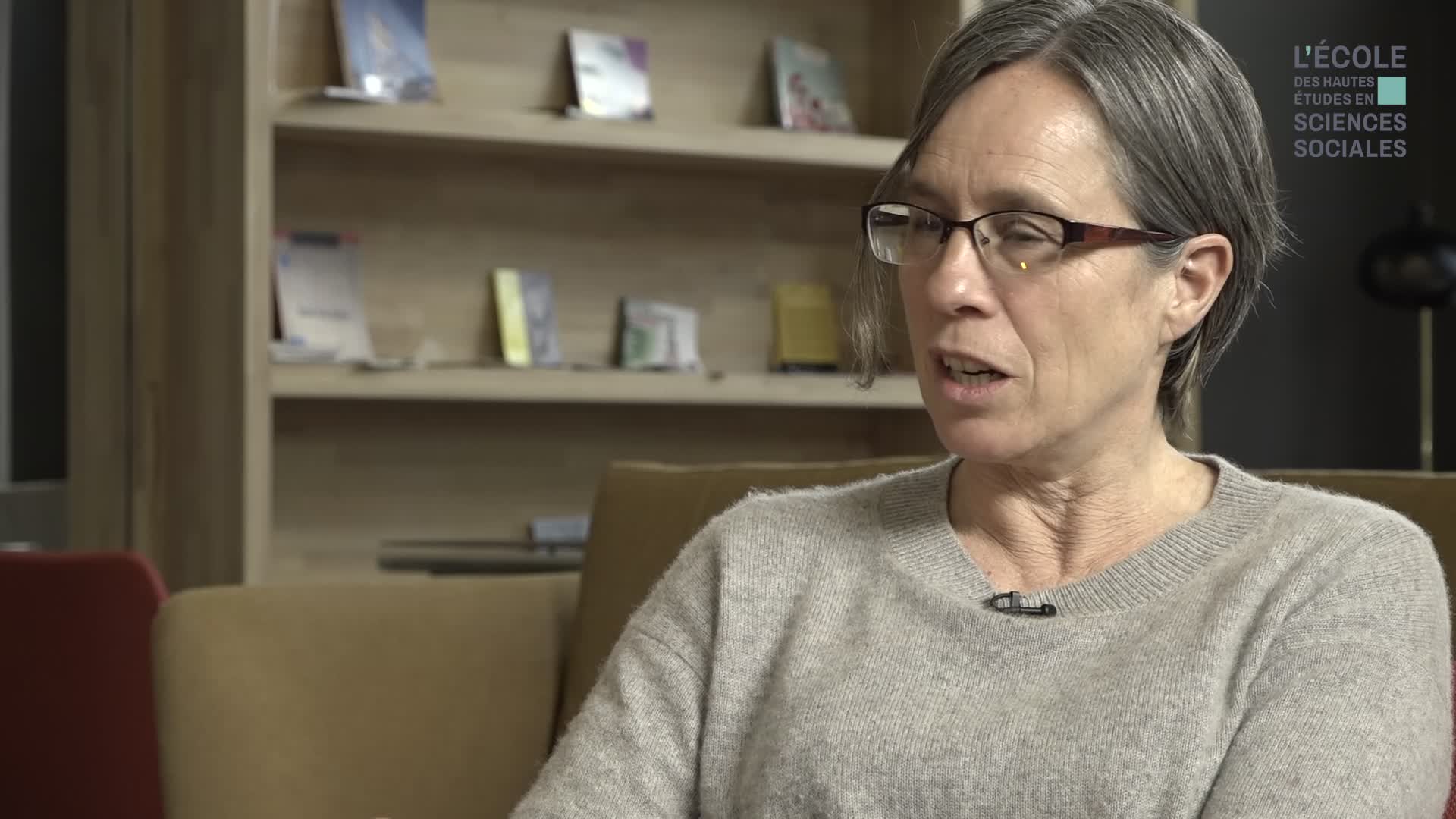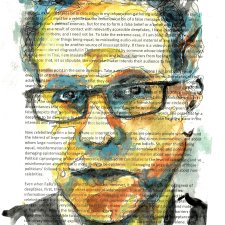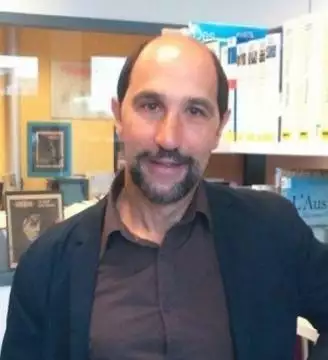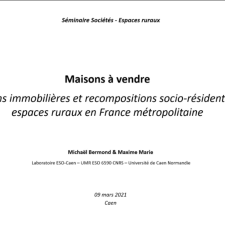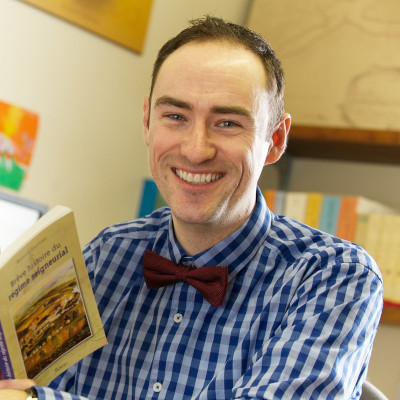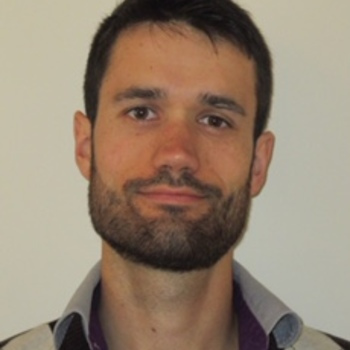Chapitres
Notice
De la propriété privée au commun : Entretien avec Pierre Crétois
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Entretien conduit par Luc Foisneau
L’esprit propriétaire perd du terrain aujourd’hui comme le prouve le développement de l’économie des fonctionnalités ou l’économie du partage. Il semblerait que le sujet contemporain cherche moins à s’approprier les choses elles-mêmes que certains droits sur elles, droits qui permettent de jouir des expériences et des formes d’épanouissement dont elles sont vectrices. Cela met-il en crise l’ « individualisme possessif » qui affirme, comme essentielle au mode d’existence du sujet, sa souveraineté sur le monde matériel ? L’individualisme possessif dont Macpherson fixe la naissance au XVIIe siècle contient en son cœur l’idée que l’homme serait propriétaire de lui-même et des choses qu’il a produites et ne serait pas, pour cela, redevable à qui que ce soit. Contestant le point de vue de l’individualisme possessif, il s’agirait alors de renouer avec le geste de « renversement de l’individualisme possessif » (Balibar) posé respectivement par Hobbes et par Rousseau, en particulier, et prolongé par les solidaristes. Les solidaristes, penseurs de l’Etat social français à la fin du XIXe siècle, considèrent, en effet, que comme nous dépendons des ressources naturelles et de la coopération sociale pour être ce que nous sommes et avoir ce que nous avons, il y aurait donc une part sociale, voire une part naturelle, dans le phénomène de l’avoir. Les développements contemporains dans l’évolution des droits de propriété permettent d’aller plus loin à travers l’idée selon laquelle la propriété n’est pas un droit absolu et exclusif mais un faisceau de droits relatifs et partiels permettant d’organiser les relations sociales quant aux choses. De ce fait, les différentes formes d’appropriation peuvent de moins en moins être pensées comme des droits souverains de l’individu et des droits de se séparer des autres. On peut, au contraire, de plus en plus, les penser comme des modalités du commun.
Intervention / Responsable scientifique
Dans la même collection
-
Egalitarianism and Consequentialism : Interview with Samuel Scheffler
SchefflerSamuelSamuel Scheffler is University Professor in the Department of Philosophy and the School of Law at New York University. He received his B.A. from Harvard and his Ph.D. from Princeton. He taught at
-
The anthority of the state: from Joseph Raz to Thomas Hobbes - Interview with Luciano Venezia
FoisneauLucVeneziaLucianoLuciano Venezia completed his PhD in Political Philosophy at the University of Buenos Aires and the École des hautes études en sciences sociales. He is research fellow at the the National
-
Où est le conservatisme (dans la théorie politique contemporaine) ? Entretien avec Raphaëlle Thery …
FoisneauLucThéryRaphaëlleNéronPierre-YvesLes philosophes politiques contemporains qui œuvrent dans le champ des théories de la justice et de l’égalité ont tendance à associer la droite philosophique au seul libertarisme.
-
La démocratie sans « demos » : avant et après - Entretien avec Catherine Colliot-Thélène
FoisneauLucColliot-ThélèneCatherineEntretien mené par Luc FoisneauQuel parcours a conduit Catherine Colliot-Thélène à consacrer une grande partie de ses travaux à l’œuvre de Max Weber ? Quelle place occupe dans ce parcours le livre qu
-
Habermas et la démocratie radicale : Entretien avec Clotilde Nouët
FoisneauLucNouëtClotildeEntretien mené par Luc Foisneau Dans cet entretien consacré à la pensée politique de Jürgen Habermas, Luc Foisneau et Clotilde Nouët explorent quatre thèmes.
-
Sovereign debt and default : Interview with Gabriel Wollner
FoisneauLucWollnerGabrielInterview conducted by Luc Foisneau - Sovereign debt and default : a political philosophical perspective
-
State power and normative power: the state as coercive teacher - Interview with Tom Pink
FoisneauLucPinkThomasEntretien réalisé par Luc Foisneau, Directeur de recherche CNRS, dans le cadre du séminaire dispensé par Tom Pink (King’s College London)
-
Le procès des droits de l'homme : Entretien avec Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère
FoisneauLucLacroixJustinePranchèreJean-YvesDénonciation du narcissisme de l’individu épris de ses seuls droits, crainte d’une spirale de revendications infinie, rappel des exigences de la communauté familiale, sociale ou politique :
-
Républicanismes et néorépublicanismes : Entretien avec Christopher Hamel
ManinBernardFoisneauLucHamelChristopherEntretien mené par Luc Foisneau et Bernard Manin
-
Autour de la souveraineté : Entretien avec Vincent Descombes
UrfalinoPhilippeDescombesVincentFoisneauLucVincent Descombes est directeur d'études à l'EHESS. Ses recherches portent sur l’ensemble de la philosophie pratique dans ses deux composantes descriptive et normative. La partie descriptive consiste
-
Entretien avec Isabelle Delpla : "Philosophie politique et justice internationale"
DelpaIsabelleProfesseure de philosophie à l’Université Jean Moulin - Lyon 3
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Le droit comme philosophie (avec Hegel, Schmitt et quelques autres). Entretien avec Jean-François K…
FoisneauLucKervéganJean-FrançoisL’intérêt de Jean-François Kervégan pour la philosophie du droit (qu’il importe selon lui de bien distinguer de la philosophie politique) est né de sa fréquentation assidue de la philosophie classique
-
De la laïcité à la française à la théorie normative de la religion
FoisneauLucLabordeCécileAprès avoir étudié à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux et à l’université d’Oxford, Cécile Laborde a occupé divers postes à l’université d’Exeter, au King’s College de Londres, et, en théorie
-
Philosophie politique normative, histoire de la philosophie, et leurs relations
FoisneauLucSorellTomTom Sorell (Warwick University). Entretien réalisé par Luc Foisneau (CNRS, CESPRA)
-
The anthority of the state: from Joseph Raz to Thomas Hobbes - Interview with Luciano Venezia
FoisneauLucVeneziaLucianoLuciano Venezia completed his PhD in Political Philosophy at the University of Buenos Aires and the École des hautes études en sciences sociales. He is research fellow at the the National
-
Où est le conservatisme (dans la théorie politique contemporaine) ? Entretien avec Raphaëlle Thery …
FoisneauLucThéryRaphaëlleNéronPierre-YvesLes philosophes politiques contemporains qui œuvrent dans le champ des théories de la justice et de l’égalité ont tendance à associer la droite philosophique au seul libertarisme.
-
La démocratie sans « demos » : avant et après - Entretien avec Catherine Colliot-Thélène
FoisneauLucColliot-ThélèneCatherineEntretien mené par Luc FoisneauQuel parcours a conduit Catherine Colliot-Thélène à consacrer une grande partie de ses travaux à l’œuvre de Max Weber ? Quelle place occupe dans ce parcours le livre qu
-
Sovereign debt and default : Interview with Gabriel Wollner
FoisneauLucWollnerGabrielInterview conducted by Luc Foisneau - Sovereign debt and default : a political philosophical perspective
-
Habermas et la démocratie radicale : Entretien avec Clotilde Nouët
FoisneauLucNouëtClotildeEntretien mené par Luc Foisneau Dans cet entretien consacré à la pensée politique de Jürgen Habermas, Luc Foisneau et Clotilde Nouët explorent quatre thèmes.
-
State power and normative power: the state as coercive teacher - Interview with Tom Pink
FoisneauLucPinkThomasEntretien réalisé par Luc Foisneau, Directeur de recherche CNRS, dans le cadre du séminaire dispensé par Tom Pink (King’s College London)
-
Le procès des droits de l'homme : Entretien avec Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère
FoisneauLucLacroixJustinePranchèreJean-YvesDénonciation du narcissisme de l’individu épris de ses seuls droits, crainte d’une spirale de revendications infinie, rappel des exigences de la communauté familiale, sociale ou politique :
-
Républicanismes et néorépublicanismes : Entretien avec Christopher Hamel
ManinBernardFoisneauLucHamelChristopherEntretien mené par Luc Foisneau et Bernard Manin
-
Autour de la souveraineté : Entretien avec Vincent Descombes
UrfalinoPhilippeDescombesVincentFoisneauLucVincent Descombes est directeur d'études à l'EHESS. Ses recherches portent sur l’ensemble de la philosophie pratique dans ses deux composantes descriptive et normative. La partie descriptive consiste
Sur le même thème
-
Le rebond de Celles, village abandonné sur les rives du Lac du Salagou
GoudalJoëlleDumoulinClémentMaryJulienValegeasFrancoisL'étude porte sur le projet de réhabilitation du village de Selle et la création d'une "Maison des possibles", un lieu de réflexion et d'échanges, impliquant les habitants, les chercheurs et les
-
Du droit de déambuler. Repenser la liberté d'aller et venir à l'âge de l'anthropocène | Sarah Vanux…
VanuxemSarahConférence de Sarah Vanuxem dans le cadre du cycle "Avenue centrale. Rendez-vous en sciences humaines".
-
Du gigantesque au minuscule, de l'individu à la société
La ville, comme tout espace social, se situe dans une tension entre partage et partages : entre commun et particulier, entre solidarités et égoïsmes, entre normes collectivement justifiées et triomphe
-
Maisons à vendre. Transactions immobilières et recompositions socio-résidentielles des espaces rura…
Si il est aujourd’hui admis que le fonctionnement contemporain des marchés immobiliers joue un rôle grandissant dans les processus de fragmentation territoriale, que nous apprennent alors les
-
Propriété et propriétaires… La gouvernance foncière à l’épreuve des logiques privatives
Plus ou moins fructueuse selon les périodes, la recherche sur le foncier concerne peu ou prou en France toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Très souvent sous-jacente aux
-
Persistances seigneuriales au Québec
Avec la collaboration de l’historienne et chargée de cours Stéphanie Lanthier et des professeurs Alain Laberge (Université Laval), Jean-René Thuot (Université du Québec à Rimouski) et Léon Robichaud
-
Les implications paysagères des transformations foncières agricoles : approche comparative dans les…
Si de nouvelles « fonctionnalités » sont désormais reconnues aux paysages de bocage (prévention du ruissellement érosif, maintien d’une certaine biodiversité, production énergétique…), les mécanismes
-
Terres nourricières ? La gestion de l’accès au foncier agricole face aux demandes de relocalisation…
A rebours de la tendance à la globalisation des systèmes alimentaires, des initiatives de relocalisation visent à rapprocher producteurs et consommateurs sur les plans spatiaux et sociaux. Parmi les
-
Des petites républiques ordonnées autour de Communs. Du Haut Atlas au Massif Central
Les sections de communes désignent des fractions communales ayant la propriété de biens distincts de ceux des communes dont elles font partie. Ces biens de section ou sectionaux peuvent consister en
-
Avoir des convictions : Quel impact sur la gestion de patrimoine aujourd’hui ? Fabienne Labelle, M…
Regard de l'enseigant-chercheur Le Financement familial de l'innovation entrepreneuriale par Fabienne Labelle, Maître de conférence en droit privé à l'Université de Tours.
-
Avoir des convictions : Quel impact sur la gestion de patrimoine aujourd’hui ? M.Bailly
Gestion de patrimoine et sauvetage des biens communs : Paroles d'experts La loi Malraux par Marc BAILLY, Dirigeant du cabinet Cardea Patrimoine, Paris
-
The anthority of the state: from Joseph Raz to Thomas Hobbes - Interview with Luciano Venezia
FoisneauLucVeneziaLucianoLuciano Venezia completed his PhD in Political Philosophy at the University of Buenos Aires and the École des hautes études en sciences sociales. He is research fellow at the the National