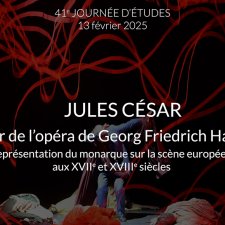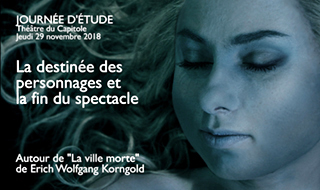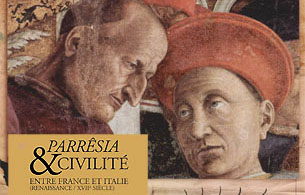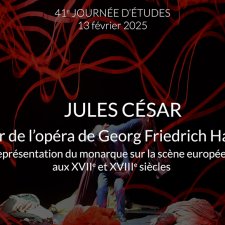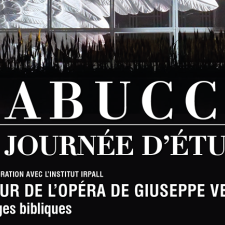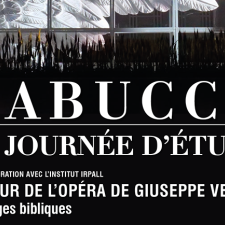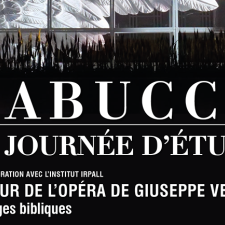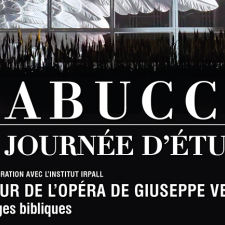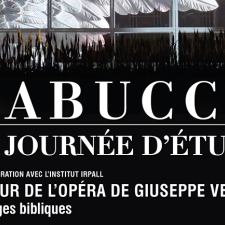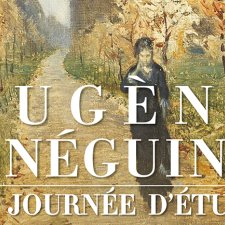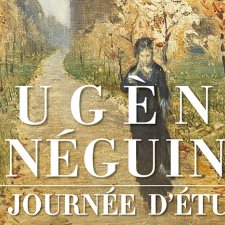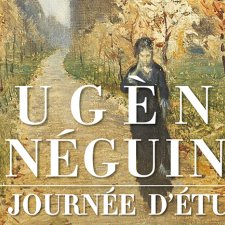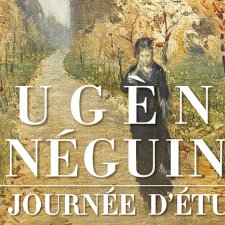Chapitres
Notice
"Platée" : un écho du Grand siècle ou une œuvre moderne ? / Yann Mahé
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Platée : un écho du Grand siècle ou une œuvre moderne ? / Yann Mahé, in "Platée de Rameau : antiquité et comédie au XVIIIe siècle", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 17 mars 2022.
* En raison d'un dysfonctionnement du défilement des diaporamas sur Canal-U, un pdf du diaporama est disponible dans l'onglet "Documentation".
Donné en 1745 à la cour du roi louis XV, Platée offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui-même un cadre de nature philosophique qui interroge la place du rire dans les arts de la scène et le langage musical, un rire qui demeure lié à l’idée de civilisation et que l’opéra de Rameau porte de façon exemplaire à travers son argument de comédie mythologique. Le modèle de l’opéra italien, ayant fait la part des choses entre le genre seria et buffa, est à l’origine de la célèbre « Querelle des Bouffons » qui éclate en 1752, et sème le trouble dans le Paris musical : les Anciens, tenants de la tradition tragique issue de Lully, s’opposent aux Modernes, charmés par les muses italiennes. Rameau ayant été un jouet ballotté à son insu entre les deux camps, son Platée comprend des caractéristiques esthétiques qui permettent d’éclairer la position personnelle du musicien dans ce débat si parisien. Au cœur de cette journée d’étude, la nature même du rire au mitan du XVIIIe siècle sera étudiée. De quoi aime-ton rire à cette époque ? Quels sont les procédés favoris des auteurs, des comédiens et des musiciens pour provoquer le rire ? Y a-t-il un rire à la française qui se distinguerait du rire italien ? La Commedia dell’arte, le théâtre de Molière exercent-ils encore leur influence ? Et l’Antiquité tant liée à la tragédie classique a-t-elle tout le ressort nécessaire pour porter une comédie au XVIIIe siècle ?
Mots clés : Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Platée (opéra, 1745), comédie-ballet, comédie lyrique, opéras-comiques, réception, opéra--18e siècle, opéra (France), Jean-Baptiste Lully (1632-1687), ariettes
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Extraits musicaux
RAMEAU, Jean-Philippe, Platée : Prologue, par Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, Paris, Palais Garnier, février 2002 (sur YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=FqQgCK2J7fY
RAMEAU, Jean-Philippe, Platée : Acte 1 Scène 4, "Dis donc, dis donc pourquoi? Quoi?", interprété par Paul Agnew (Platée, haute-contre) et Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, Paris, Palais Garnier, février 2002 (sur YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=_YepYKiMlXg
RAMEAU, Jean-Philippe, Platée : Acte II, Scène 4, "Essayons du brillant", sous dir. de Teodor Currentzis, MusicAeterna, 2014 (sur YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=EVHFcxMemv0
RAMEAU, Jean-Philippe, Platée : Prologue, Scène 1, Ariette "Charmant Bacchus", interprété par Cyril Auvity et Les Arts Florissants dirigés par William Christie. Harmonia mundi, 2021. [En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=g2n7wpK4FzM].
Bibliographie
Albert de Luynes, Charles-Philippe d' (1861). Mémoires du Duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758). T. 6. Paris, Firmin Didot Frères Libraires. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206431p].
Mercure de France, mars 1754. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3814487b?rk=536483;2].
Mercure de France, juillet 1749. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63564721?rk=171674;4].
Mercure de France, mars 1749. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3747817k?rk=450646;0].
RAMEAU, Jean-Philippe (1749). Platée, comédie-ballet, mise en musique par M. Rameau et donnée par l'Académie Royale de musique par le carnaval de 1749, le 4 février de la même année [partition], Paris, Édition Boivain, Leclair. [En ligne : ark:/12148/bpt6k4500054j ].
FUZELIER, Louis (1731). Discours à l’occasion d’un discours de M. de La Motte sur les Parodies. Paris, Édition Briasson, 12 p. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311812p?rk=21459;2].
Dans la même collection
-
Peut-on rire en musique sous les Lumières ? / Julien Garde
GardeJulienDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, "Platée" offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui
-
Platée buffo : miroir de l’italianité dans la comédie lyrique de Le Valois d’Orville et Rameau / Je…
LattaricoJean-FrançoisLehmannMichelDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui
-
Une Antiquité rêvée entre parodie et satire : les exemples de 'Platée' et 'Arlequin Thésée' (1745) …
François-GarelliMarie-HélèneDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui
-
D’un rire galant, ou cruel ? Comédie, burlesque et persiflage dans "Platée" / Fabrice Chassot
ChassotJean-FabriceDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, "Platée" offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle
MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d
-
Le tragique au Grand Siècle depuis les tragédies en musique de Lully / Yann Mahé
MahéYannDe la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice
-
Le franc-parler de Médée chez les deux Corneille et Charpentier : parole risquée ou parole vengeres…
LibralFlorentMahéYannLe franc-parler de Médée chez les deux Corneille et Charpentier : parole risquée ou parole vengeresse ? Florent Libral, Yann Mahé
Sur le même thème
-
Rois et reines dans le dramma per musica italien, des origines à l’orée du XVIIIe siècle
EouzanFannyUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d
-
Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle
MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d
-
La musique du « Va pensiero » : pastiche biblique, imaginaire patriotique, apax de choeur d’opéra
LehmannMichelLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Nul n’est prophète en son pays : Rossini, du Mosè napolitain (1818) au Moïse parisien (1827)
AstorDorianLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
La Bible dans la peinture italienne du XIXe siècle
NardoneJean-LucLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Nabucco et la Bible : entre source d’inspiration et écarts
CourtrayRégisLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
Le Nabucco de Verdi, actualisation miraculeuse de clichés bibliques
GaudardFrançois-CharlesLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période
-
« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi
LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Défenses d’aimer. Les obstacles à l’amour dans le drame wagnérien
ImperialiChristopheDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Le malheur de s’appeler Eugène. Du roman en vers de Pouchkine (1833) à l’opéra de Tchaïkovski (1879…
ZidaričWalterDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
Des Souffrances du jeune Werther (1774) aux souffrances de Charlotte dans l’opéra Werther (1892) : …
MalkaniFabriceDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une
-
L’aveu de Phèdre à Hippolyte : un défi pour l’opéra (1733-1821, de Paris à Milan)
GrosperrinJean-PhilippeDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une