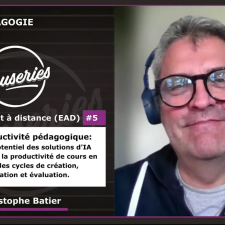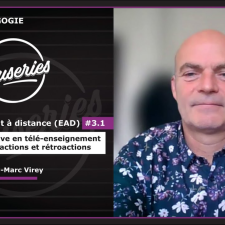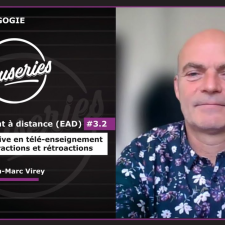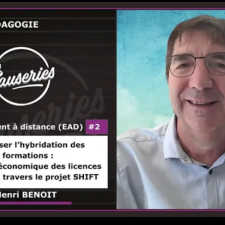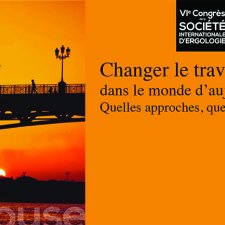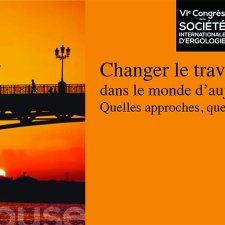Chapitres
Notice
FIED : intervention sur la formation à distance à l'international
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Antoine Rauzy est co-directeur de la FOAD de l’université Pierre et Marie Curie, etresponsable du groupe de travail « relations internationales » ausein de la FIED. Il nous donne sa vision de l'enseignement supérieur des universités françaises à distance à l'international.
Consulter le site de la FIED - Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à distance
Découvrir Formasup, le portail de l'offre de formation à distance des établissements publics
Thème
Documentation
Transcription
Antoine Rauzy est co-directeur de la FOAD de l’université Pierre et Marie Curie, et responsable du groupe de travail « relations internationales » au sein de la FIED.
Peut-on parler de marché pour l’enseignement supérieur à l’international ?
Est-ce qu’on doit parler de marché ou pas ? Il y a un moment où je réfléchissais en termes de marché, mais je crois qu’il y a en même temps un piège, c’est-à-dire l’air du temps, c’est de parler en termes économiques parce que ça fait décideur de parler en termes économiques. Face à ça, on est quand même des universitaires, or les universitaires ne parlent pas en termes économiques. Je pense que parler uniquement en termes universitaires, de diplôme, etc, on ne répond pas au problème, mais que d’un autre côté si on commence à parler comme une banque, on perd notre légitimité. Donc il y a un moment où l’on va parler de concurrence, de marché parce qu’il y a des réalités économiques, mais si on se fait prendre à ce piège-là, on ne va plus proposer des formations, mais des marchandises. Je pense que c’est très largement un piège dans lequel sont tombés les Anglais aujourd’hui. Piège qui satisfait probablement des responsables d’universités, parce que les universités sont riches, elles peuvent proposer des choses qui sont de bonne qualité à un public choisi, mais qui nationalement pose le problème de la formation de la jeunesse, au niveau universitaire. On s’aperçoit que beaucoup d’étudiants (les chiffres ne sont pas très clairs), une partie de la jeunesse anglaise a renoncé à faire des études supérieures parce que le coût était trop élevé, malgré un niveau académique, ou intellectuel qui leur permettait de les suivre. On n’est pas prêt à passer à ça dans l’esprit français, Ce que j’ai vu dans la façon de penser allemande, dans la façon de penser polonaise, je soupçonnerai la même chose en Espagne et en Italie.
On n’est pas dans l’optimisation d’un profit. Si l’on cherche ça, on perd son âme, je pense, pour une université.
Avec les pays du sud peut-on parler de coopération ou d’aide au développement ?
Je ne parlerais pas d’aide, je parlerais de coopération, parce qu’on n’est plus dans une demande d’aide, c’est très bien comme ça.
Ces coopérations avec le Maghreb, elles existent, elles sont bien implantées, je dirais qu’on n’est pas loin de l’Europe du point de vue coopération, on n’est pas dans une zone intégrée, mais les deux rives de la Méditerranée se connaissent bien. Souvent il y a des binationaux, etc. il n’y a pas beaucoup de difficultés contextuelles on va dire.
Si on prend les pays très pauvres, où l’on n’aura pas Internet, où l’électricité n’est pas là tout le temps, etc., on se retrouve avec problèmes qui ne sont plus des problèmes auxquels on est habitués, qui demandent une contextualisation bien supérieure, et dans certains pays on ne va pas être dans un questionnement de former des universitaires, mais plus de former des instituteurs, de former des professeurs de collèges, de lycée, avant de se trouver dans une problématique de faire fonctionner une université. Ca ne veut pas dire là encore qu’on n’est pas dans une relation d’égal à égal. Si je prends l’impression que j’ai en prenant le Ministre de l’éducation du Niger, quand j’ai entendu cette dame qui parlait, on n’était pas dans une relation néocoloniale : une femme remarquable, qui sait exactement ce qu’elle veut et comment elle va le faire, et qui sait aussi qu’elle est dans un pays aux ressources épouvantablement limitées.
Quand je dis qu’on ne fait pas d’aide, c’est vrai. Mais en même temps, à l’échelon local, il y a un moment où ça peut s’apparenter à de l’aide, mais ce n’est pas de l’aide entre deux institutions : si jamais il n’y a pas de livres dans une bibliothèque, et que parce qu’on a un accès et qu’on permet l’accès de revues en ligne, sur ce point précis, on aura tendance à avoir un discours d’aide. Ce qui ne va pas, c’est si le projet est un projet d’aide, et pas un projet de coopération. On me reprendrait peut-être sur le mot « aide », mais je pense que c’est vrai. On est dans une demande de coopération, et pas dans une demande d’aide qui va très vite glisser vers des choses qui ne sont pas au point.
Quelle est la place des formations à distance ?
Entre l’aide au développement et le néo colonialisme, la frontière est parfois ténue. Il n’empêche qu’il y a une énorme demande de formation dans la zone francophone, ou plutôt en Afrique on va dire, que cette demande de formation ne sera pas satisfaite par les institutions locales, qu’il y aura une proposition d’offre de formation des institutions américaines, canadiennes, chinoises, françaises, et anglaises naturellement. Parfois, si on parle d’Asie du sud-est, australiennes, de Hong-Kong ou Singapour. Cette offre de formation externe, elle va exister. La question qu’on doit se poser c’est : « Comment y répond-on ? », avec immédiatement le corolaire, qui est : « Si on fait venir des étudiants africains en France, on a des problèmes de visa insolubles. »
Les Anglais ont eu exactement la même chose, c’est-à-dire que la conjoncture politique interdit aujourd’hui d’ouvrir complètement l’accès à la zone Schengen, l’espace national tant qu’on n’est pas sûr que ce sont des étudiants excellents, ou qu’ils sont là uniquement ou principalement pour les études.
On peut dire c’est bien, ce n’est pas bien etc, pour moi c’est un peu une donnée. L’idée c’est quand même d’essayer de maintenir les étudiants, jusqu’au moment où l’on peut garantir que ce sont des étudiants excellents, de les maintenir dans le pays d’origine ou de ne pas les laisser dans un pays où cela va créer un conflit politique.
Je pense que [l'enseignement] la distance est la clef de tout ça.
Certaines structures plus élaborées vont être adaptées à la distance pure, d’autres vont demander une présence, mais une présence limitée parce qu’on aura des techniques de communication, ou d’enseignement à travers des technologies qui seront bien meilleures.
Il n’y a pas de réponse « distance totale » mais cela permet à l‘heure actuelle, dans à peu près toutes les situations, de diminuer considérablement le nombre des déplacements, leur nombre ou leur fréquence.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La FIED : intervention sur les MOOC's
RauzyAntoineAntoine Rauzy parle du phénomène des MOOC's, et de son utilisation possible pour les chercheurs. Consulter le site de la FIED - Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à distance
-
La FIED, Fédération Inter-universitaire de l'Enseignement à Distance
RauzyAntoineAntoine Rauzy, co-directeur de la FOAD de l’Université Pierre et Marie Curie, Maître de conférences en mathématiques et membre de la FIED, nous décrit les missions de la FIED. Consulter le site de la
Sur le même thème
-
Causeries Pédagogie - Enseignement à distance #5 - IA et productivité pédagogique
PorlierChristopheBatierChristopheCauseries Pédagogie - Enseignement à distance #5 - IA et productivité pédagogique
-
-
Enseignement à distance (EAD) #3 - Pédagogie active en télé-enseignement - Partie 1
VireyJean-MarcPorlierChristopheEnseignement à distance (EAD) #3 - Pédagogie active en télé-enseignement - Partie 1
-
Enseignement à distance (EAD) #3 - Pédagogie active en télé-enseignement - Partie 2
VireyJean-MarcPorlierChristopheEnseignement à distance (EAD) #3 - Pédagogie active en télé-enseignement - Partie 2
-
Enseignement à distance (EAD) #2 - Optimiser l'hybridation des formations
PorlierChristopheBenoîtHenriEnseignement à distance (EAD) #2 - Optimiser l'hybridation des formations
-
Enseignement à distance (EAD) #1 - La licence SHIFT - le sur mesure accessible à tous
PorlierChristopheBenoîtHenriEnseignement à distance (EAD) #1 - La licence SHIFT - le sur mesure accessible à tous
-
O trabalho docente frente à pandemia de COVID-19 : vivências, dramáticas dos usos-de-si e desenvolv…
CunhaDaisy MoreiraA pesquisa de doutoramento em curso intitulada “A atividade de trabalho docente no ensino fundamental frente à pandemia de COVID-19 : uma análise à luz da ergologia”, propõe realizar uma análise
-
Atividade humana e ergológica dos docentes de odontologia em uma Universidade no Brasil : o ensino …
Nunes de Azevedo RomanowskiFrancielleO exercício dos docentes de odontologia se transformou com o advento do Covid-19, surgindo a necessidade de se repensar a educação em suas diferentes possibilidades. Coube a eles não cessar a formação
-
EIFAD - Atelier du 29 novembre 2023 - L'évolution des métiers - Production et appropriation des res…
Padoani DavidGracielaBruillardÉricPerayaDanielEIFAD - Atelier du 29 novembre 2023 - L'évolution des métiers - Production et appropriation des ressources éducatives par les enseignants
-
Autisme et numérique : enjeux pour l'enseignement en ligne
MonthubertBertrandAutisme et numérique : enjeux pour l'enseignement en ligne avec Bertrand Monthubert, Directeur d'Atypie-Friendly, président du Conseil National de l'Information Géolocalisée, d'Ekitia et OPenIG
-
L'hybridation dans l'enseignement supérieur : injonction ou besoin ?
El HoyekNadyChampionChristopheConférence organisée par le Collège sciences et technologies de l'Université de Bordeaux - 9 novembre 2023
-
RGPD et EAD
TessierJean-LucRGPD et EAD avec Jean-Luc Tessier, délégué à la protection des données, Université de Lille