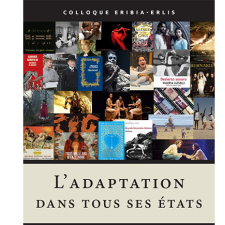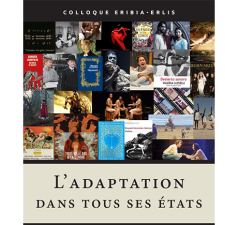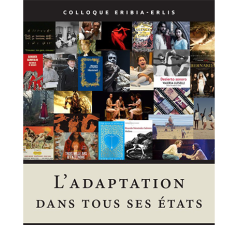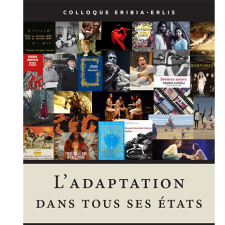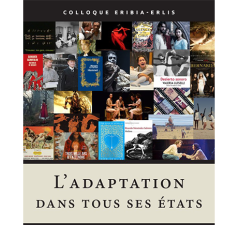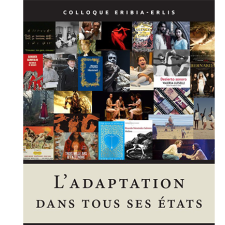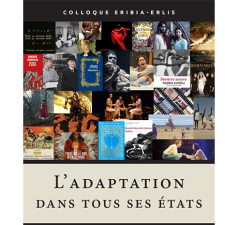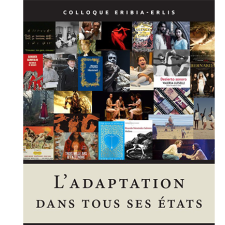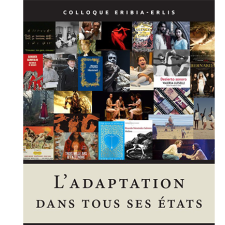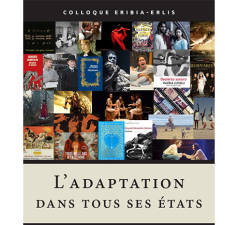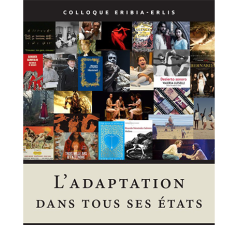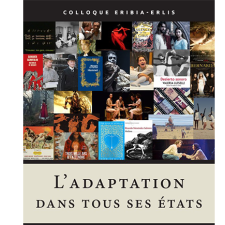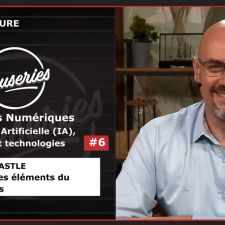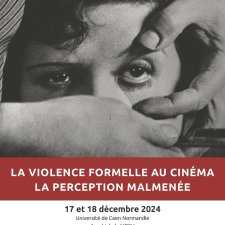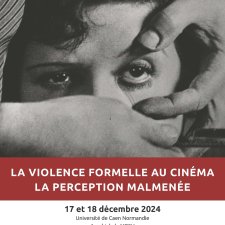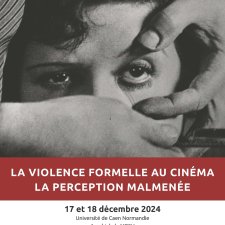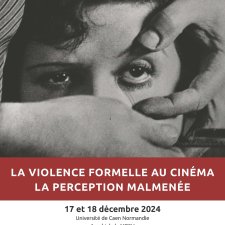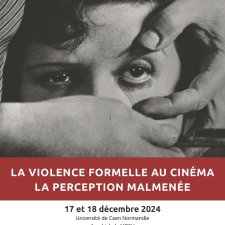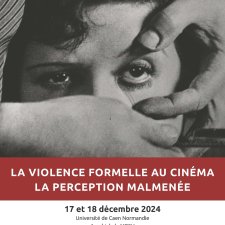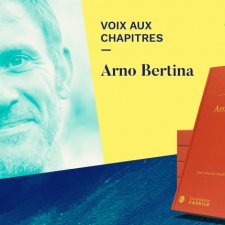Notice
De l'écofiction littéraire au thriller psychologique. Adaptation cinématographique de Distancia de Rescate (2014) : tension, distension ou rupture du fil écologique ?
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Résumé de la communication :
Distancia de rescate (2014) de l’Argentine Claudia Schweblin, paru en France sous le titre Toxique (2017), est un roman court qui plonge immédiatement le lecteur dans une atmosphère où se mêlent thriller, fantastique et drame intimiste, sur fond d’apocalypse environnementale imminente. Le roman a été traduit en quatorze langues. Il a été porté au cinéma en 2021 par la réalisatrice péruvienne Claudia Llosa, et diffusé internationalement sous le titre de Fever dream.
Dans le roman, la voix dominante est celle d’une jeune femme, Amanda, mère d’une petite fille de sept ans, l’adorable Nina. Au moment où s’ouvre le récit, Amanda est en train de mourir. Une seconde voix, celle d’un garçon de neuf ans, David, petit aruspice effrayant, donne à son agonie le sens d’une quête implacable vers la compréhension de « ce qui importe ». De ce récit à deux voix émerge l’histoire de la singularité de David, dont la mère, Clara, double inversé d’Amanda, s’est détachée : elle se méfie de lui, lui attribue d’obscurs pouvoirs maléfiques. Cette mère torturée par le souvenir de ce que fut son enfant, désormais dénaturé, entretient avec Amanda des rapports de fascination réciproque traversés de brefs moments de répulsion. Elle voudrait, comme Amanda, posséder « sa propre Nina ». Les émotions violentes et complexes dominent le récit. Elles accaparent l’attention du lecteur, mobilisent sa sensibilité, le condamnent à se polariser sur les drames personnels, lui occultant ainsi la tragédie en cours, qui se joue à une tout autre échelle : l’empoisonnement des humains et des non humains, conséquence de l’agriculture agroindustrielle basée sur l’application intensive de pesticides. L’épicentre de cet «immobile fléau sur le point de s’abattre » se situe dans un territoire périphérique de la province de Buenos Aires, non nommé, mais les derniers mots du récit, tels une alarme stridente qui se déclenche, étendent leur rayon d’action jusqu’à la capitale argentine, et au-delà, jusque dans le monde réel et concret habité par chaque lecteur aux quatre coins de la planète. Celui-ci prend alors la juste mesure du leitmotiv porté par David, le mentor inflexible, dépourvu d’âme en apparence. Il est invité à comprendre – et à ce titre, l’acte de lecture constitue une expérience initiatique – que « ce qui importe », dans un contexte global d’effondrement de la biodiversité, est de pratiquer le relativisme perceptif. Amanda passe son temps à calculer « la distance de secours » à parcourir au cas où Nina serait menacée, mais sans varier jamais la distance focale, d’où un champ de vision étroit, limité, sans perspective. En nous initiant, avec les armes qui sont les siennes, à l’apprentissage du relativisme perceptif et aux enjeux liés à cette pratique salutaire, la littérature contribue à nous rendre plus combattifs vis-à-vis des responsables (en l’occurrence, le secteur agro-industriel) des catastrophes écologiques et sanitaires en cours et à venir, trop souvent invisibilisés.
La question que l’on peut se poser – qui motive la présente proposition de communication – est de savoir si cette dimension initiatique à vocation écologique est préservée par l’adaptation cinématographique du roman et quelles sont les mutations qu’elle subit.
Biographie de l'auteure :
Agrégée d’espagnol, Anouck Linck a suivi un cursus de lettres modernes, puis s’est spécialisée en littérature comparée à l’Université Paris III. Elle a soutenu en 2010 une thèse portant sur les résonances de la pensée scientifique dans le récit fantastique du XIXe et du XXe siècle. Depuis 2011, elle est MCF à l'université de Caen, où elle enseigne la littérature hispano-américaine, et membre du LASLAR. Elle a publié divers articles explorant le rapport science et fiction, ainsi qu’un ouvrage sur l’écrivain colombien Andrés Caicedo. Elle travaille actuellement sur les écofictions non dystopiques et les romans contemporains écrits par des femmes, majoritairement argentines et mexicaines.
Intervention / Responsable scientifique
Dans la même collection
-
‘Ni homme ni femme, rien qu’un entre-deux’ : Albert Nobbs et ses adaptations, de George Moore à Gle…
CardinBertrandCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
« Fragmentation, adaptation et expérience migrante dans Desierto Sonoro (2019) de Valeria Luiselli »
Ce colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
« Ondine : du conte romantique (Frédéric de la Motte-Fouqué) au cinéma contemporain (Christian Petz…
Ce colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Pourquoi ré-écrire l'Iliade au XXIème siècle ? Les exemples de The Song of Achilles (Madeline Mille…
RoblinIsabelleCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Le Petit Chaperon rouge dans tous ses états ? La réinterprétation d’un personnage mythique dans la …
Jarl IremanAnnelieCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Shakespeare romancé : le succès en demi-teinte de la maison Hogarth
Ce colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
De la vache aux jonglages : quels défis d’adaptation le XXIe siècle lance-t-il aux œuvres cunnin…
GrangerCarolineCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Tales from the Loop (Prime, 2020), où adapter l’internet
Ce colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Du roman à la scène théâtrale. L’adaptation de Medusa de Ricardo Menéndez Salmón et le défi de la …
MollardNicolasCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
L’autre muséification du flamenco
CordobaPedroCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
De La Casa de Bernarda Alba (1936) à Bernarda (2018) : le drame des femmes revisité
Aït BachirNadiaCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
-
Les enjeux de la transposition audiovisuelle de La Catedral del Mar (2006)
MenaCarolineCe colloque se propose d’explorer toutes formes d’adaptations sur différents supports ou dans différents genres littéraires, audiovisuels etc. pour mettre en lumière la spécificité du phénomène d
Sur le même thème
-
Entretien avec Jean-Gérard BOSIO, 2/2. La fin du dernier Mandat
BosioJean GérardRiffardClaireEntretien avec Jean-Gérard BOSIO (Historien, diplomate et collectionneur, conseiller culturel de Léopold Sedar Senghor de 1972-1981)
-
Humanités Numériques – Intelligence Artificielle (IA), littérature et technologies #6 – Saga Tom Ca…
PorlierChristopheBertaniNicolaHumanités Numériques – Intelligence Artificielle (IA), littérature et technologies #6 – Saga Tom Castle – Focus sur des éléments du second opus
-
Les prouesses de Ken Jacobs, ou la violence du dispositif comme plaisir formel
À la fin des années 1960, aux États-Unis, le cinéaste Ken Jacobs entame ses expériences perceptives sur des films des premiers temps à l’aide d’un projecteur analytique lui permettant de faire des
-
Agressions du regard dans trois films de sabre japonais des années 1960 : des tentatives pour mettr…
Un cadre bringuebalé et un objectif éclaboussé par les soubresauts d’une course acharnée dans les eaux d’une rizière que traverse un assassin dans Le Grand Attentat (Eiichi Kudō, 1964) ; une image
-
Une déchirure anticoloniale : sur l’emploi du flicker dans On Africa (1970) de Skip Norman
On Africa, du cinéaste afro-américain Skip Norman (1933-2015), est une œuvre qui mobilise des stratégies de violence formelle afin de perturber la règle dominante de la logique et de l’imagerie
-
Du Mal (originel ?) des transports
Plusieurs films relevant du found footage horrifique (Cloverfield de Matt Reeves (2008), Rec de Jaume Balaguero et Paco Piazza (2007)) ont été identifiés comme provoquant chez les spectateurs les
-
Noirs et blancs. Violences audio-visuelles par la négative
Il existe une violence d’autant plus insidieuse et pernicieuse qu’elle s’exprime par son absence même, ou son propre envers. Comme le silence serait une violence faite au son, l’absence d’image
-
Introduction générale aux journées d’étude « La violence formelle au cinéma. La perception malmenée
Existe-t-il, au cinéma, une violence spécifiquement générée par la forme filmique ? Si oui, quelle en est la nature, et quelles peuvent en être les fonctions ? Telles sont les interrogations qui
-
Sifflement, raucité, rythme. Structures acoustiques dans les films du réalisateur Vladimir Kobrin
Le collage acoustique, dans les films de Vladimir Kobrin, constitue une critique du texte scientifique et une tentative de distance ironique.
-
The Walking Dead : violence formelle, violence reçue. Mordre ou être mordu. Une étude de la relatio…
S’il est initialement acquis, du fait du genre de l’œuvre (drame horrifique post-apocalyptique) que la série fraye avec le funeste sang noir, comment d’une part parvient-elle malgré tout à nouer un
-
L’expérience kinesthésique de l’Exploding Plastic Inevitable : flicker de projection et flicker de …
L’Exploding Plastic Inevitable (1966) est un spectacle multimédia qui prend place le 13 janvier 1966 dans une discothèque de l’East Village à New York. Il s’agit d’une installation mise en scène par
-
Voix aux chapitres #5 : autour des ouvrages d'Arno Bertina
HuretRomainSapiroGisèleLafontAnneBertinaArnoBarthélémyPascale ClaireKiesowRainer MariaLa cinquième séance de Voix aux chapitres est consacrée aux ouvrages Ceux qui trop supportent (Gallimard 2021), Des châteaux qui brûlent (Gallimard, 2017), Des lions comme des danseuses (La Contre